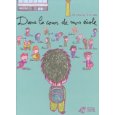Cherub, vol. 1: Cent jours en enfer
Robert Muchamore
Traduit (anglais) par Antoine Pinchot
Casterman, 2011
Petit manuel de machiavelisme pour les enfants
Par Anne-Marie Mercier
 Le premier tome de la série « culte » de Cherub est publié en poche… Enfin, direz-vous ? Hélas, plutôt… Bien sûr, ce sont des romans d’action bien menés ; bien sûr le jeune héros, James, petit délinquant qui ne pense qu’à jouer à la PlayStation et à regarder la télé et qui est sauvé par l’ »organisation » Cherub peut séduire certains.
Le premier tome de la série « culte » de Cherub est publié en poche… Enfin, direz-vous ? Hélas, plutôt… Bien sûr, ce sont des romans d’action bien menés ; bien sûr le jeune héros, James, petit délinquant qui ne pense qu’à jouer à la PlayStation et à regarder la télé et qui est sauvé par l’ »organisation » Cherub peut séduire certains.
Mais l’école de Cherub ressemble beaucoup à un camp d’entraînement (le titre, « 100 jours en enfer », désigne le programme d’entraînement intensif des futurs agents-espions), la discipline est menée à coup de punitions humiliantes, l’enseignement présenté comme un enseignement d’élite pour une élite (10 élèves par classe).
Enfin, sur le terrain, les jeunes gens ont une activité d’espions : mensonge, dissimulation et trahison sont leur domaine. Le seul interdit (« ne pas nuire à des innocents ») est hardiment franchi au prétexte que « on ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs ». La volonté d’entrer dans la complexité est intéressante, mais…
Le succès de la série montre-t-il que le nouveau rêve des adolescents n’est plus d’être un hardi policier, ou sorcier, ou voleur, mais d’être un enfant soldat ? que l’école dont ils rêvent est un pensionnat-prison militaire ? ou bien est-ce juste pour se faire peur ?
Le prétexte est que ces héros eux aussi « sauvent le monde », mais au bénéfice de qui ? Dans ce premier volume c’est au bénéfice des compagnies pétrolières contre les hippies et les écologistes. Bien sûr, les uns agissent en toute légalité et les autres pas… mais si la littérature pour adolescents se met à donner la primauté au Droit contre la Justice, il y de quoi s’interroger.
Enfin, que je sache, les écologistes – fussent-ils terroristes (?) – n’ont jamais commis d’attentats sanglants. Que le livre fasse croire le contraire n’est pas innocent.
Quant à l’écriture, elle est d’une platitude sans nom.
Pour aller plus loin, lisez la chronique- coup de gueule parue sur le blog de Patrice Favaro.
Et lisez plutôt Grande école du mal et de la ruse de M. Walden (oui, les héros sont des affreux jojo délinquants, mais au moins c’est drôle) ou Jimmy Coates de Joe Craig, A comme Association de Bottero et L’Homme (surtout les deux premiers), éventuellement Spy High (série, pas excellente, mais moins inquiétante, pour ce que j’en ai vu). Et, pourquoi pas, les Langelot (Lieutenant X/ Vladimir Volkoff), romans d’espionnage pour la jeunesse bien conservateurs mais écrits avec style.

 Une lune, des animaux, un arbre, tous en pâte à modeler brune (la couleur qui finit par dominer quand on a trop mélangé les couleurs), un fond de ciel bleu orangé, la tombée de la nuit. C’est le moment où les animaux se rassemblent, parlent à la lune et l’écoutent.
Une lune, des animaux, un arbre, tous en pâte à modeler brune (la couleur qui finit par dominer quand on a trop mélangé les couleurs), un fond de ciel bleu orangé, la tombée de la nuit. C’est le moment où les animaux se rassemblent, parlent à la lune et l’écoutent.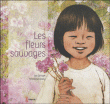
 Mina aime la nuit, et aussi les mots. Elle les utilise en toute liberté, au grand dam de son institutrice, ignorant les règles et la logique ordinaire. Elle écrit son journal avec sa fantaisie, mêlant réflexions et notations prosaïques, questions et rêveries. Elle raconte aussi son histoire qui a fait qu’elle a été retirée de l’école, pour comportement trop « bizarre », la scène de terreur qui a tout déclenché, l’ombre d’un père disparu, son passage par un établissement spécialisé.
Mina aime la nuit, et aussi les mots. Elle les utilise en toute liberté, au grand dam de son institutrice, ignorant les règles et la logique ordinaire. Elle écrit son journal avec sa fantaisie, mêlant réflexions et notations prosaïques, questions et rêveries. Elle raconte aussi son histoire qui a fait qu’elle a été retirée de l’école, pour comportement trop « bizarre », la scène de terreur qui a tout déclenché, l’ombre d’un père disparu, son passage par un établissement spécialisé.