Écoute battre mon cœur
Nathalie Le Gendre
Flammarion, Émotions, 2012
Nouvelle Star
Par Caroline Scandale
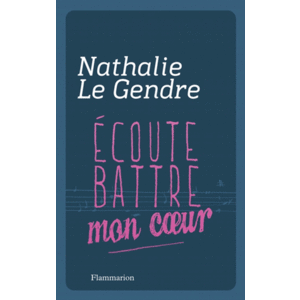 De plus en plus, la littérature jeunesse puise ses influences dans la musique. On pense notamment aux romans de l’excellente collection Exprim’. Comme elle, mais en moins radicale, la collection Émotions s’approprie quelques uns des codes actuels en matière de romans pour jeunes adultes. Le dernier opus littéraire de cette collection, Écoute battre mon cœur, débute par une playlist que les lecteurs peuvent facilement se constituer sur Deezer, service d’écoute de musique à la demande (en « streaming »). Cette bande son est censée refléter la rythmique et l’ambiance du roman. Elle donne une dimension supplémentaire à l’histoire, en entremêlant réalité et fiction…
De plus en plus, la littérature jeunesse puise ses influences dans la musique. On pense notamment aux romans de l’excellente collection Exprim’. Comme elle, mais en moins radicale, la collection Émotions s’approprie quelques uns des codes actuels en matière de romans pour jeunes adultes. Le dernier opus littéraire de cette collection, Écoute battre mon cœur, débute par une playlist que les lecteurs peuvent facilement se constituer sur Deezer, service d’écoute de musique à la demande (en « streaming »). Cette bande son est censée refléter la rythmique et l’ambiance du roman. Elle donne une dimension supplémentaire à l’histoire, en entremêlant réalité et fiction…
Lula l’héroïne de ce roman et son grand frère Phil vibrent et respirent musique, comme leur papa professeur de musique. Comme lui, ils sont muselés par une mère angoissée et tyrannique. Phil déjà majeur, est le premier à se libérer de ses chaînes et à partir vivre de sa passion, le rock, à Paris… Reste Lula, 17 ans, lycéenne brillante et musicienne virtuose, obéissante mais aussi pleine de fougue et d’envies… Depuis le départ brutal de ce frère aîné quelques années plus tôt, sa mère s’oppose plus que jamais à ce que sa fille, pourtant si douée, devienne artiste…
Heureusement, la vie est bien faite… Elle autorise enfin Lula à partir seule chez sa meilleure amie, à Paris, lors de vacances scolaires. A cette occasion, elle découvre avec enchantement la vie d’artiste « underground » grâce à son grand frère et elle fait la connaissance de Mathias, jeune violoncelliste virtuose et passionné comme elle… Goûter à la liberté et à l’amour provoque un tsunami dans la vie de la trop sage Lula… Le retour au bercail n’en est que plus douloureux.
Ce roman devrait beaucoup plaire aux ados pour qui la musique est un refuge car l’auteure ne cesse de convoquer au fil des pages, des morceaux ou des artistes reconnus. Elle s’est d’ailleurs très certainement inspirée d’Izia, fille de Jacques Higelin, jeune et géniale rockeuse, pour créer son héroïne.
L’écriture est fluide et rythmée. La psychologie des personnages est intéressante, notamment celle de la mère. Même si sa personnalité extrême dérange, elle reflète avec justesse l’attitude mortifère de certaines mères névrosées. Petit bémol tout de même autour d’un paradoxe majeur… La raison est incarnée par une maman qui déraisonne et la passion par une ado trop sage. En effet, Lula est à mon goût (de trentenaire fan de Virginie Despentes et D’Antoine Dole… ) un peu trop raisonnable et soumise et le « happy end » final un peu inattendu, mais n’est-ce pas ce qu’on attend d’un gentil roman de littérature jeunesse?


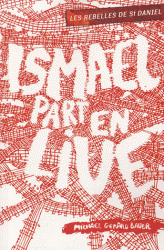

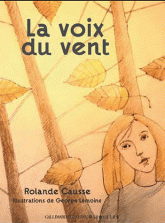
 Il y a un peu du Slumdog millionnaire dans le roman de Claire Ubac (le livre, pas le film, qui n’avait pour lui que son rythme formidable) : dans l’Inde d’aujourd’hui, une fille et un garçon voyagent, à pied, en voiture, en train… Ils sont poursuivis, enfermés, s’évadent, se perdent, mais continuent leur quête, coûte que coûte, et s’entraident, s’aiment. A travers eux, on découvre l’Inde : villages, villes (Madurai, Bangalore, Bombay…), bidonvilles, usines, ateliers et métiers. Les bruits, les odeurs et les saveurs donnent
Il y a un peu du Slumdog millionnaire dans le roman de Claire Ubac (le livre, pas le film, qui n’avait pour lui que son rythme formidable) : dans l’Inde d’aujourd’hui, une fille et un garçon voyagent, à pied, en voiture, en train… Ils sont poursuivis, enfermés, s’évadent, se perdent, mais continuent leur quête, coûte que coûte, et s’entraident, s’aiment. A travers eux, on découvre l’Inde : villages, villes (Madurai, Bangalore, Bombay…), bidonvilles, usines, ateliers et métiers. Les bruits, les odeurs et les saveurs donnent
 K-cendres est le nom de scène d’Alexandra, rappeuse, mais aussi devineresse à la manière de Cassandre : celle qui prédit des malheurs et ne peut les empêcher. C’est pourtant un roman absolument réaliste dans son cadre et dans ses principaux enjeux. Il décrypte les milieux et stratégies du show-biz, non seulement à travers l’héroïne mais aussi de nombreux personnages : patron de label, attachée de presse, garde du corps, médecin… chacun est caractéristique, aucun n’est caricatural, tous sont humains, trop humains. Au contraire, Alexandra et Marcus, son garde du corps, sont porteurs chacun à sa manière d’une certaine pureté.
K-cendres est le nom de scène d’Alexandra, rappeuse, mais aussi devineresse à la manière de Cassandre : celle qui prédit des malheurs et ne peut les empêcher. C’est pourtant un roman absolument réaliste dans son cadre et dans ses principaux enjeux. Il décrypte les milieux et stratégies du show-biz, non seulement à travers l’héroïne mais aussi de nombreux personnages : patron de label, attachée de presse, garde du corps, médecin… chacun est caractéristique, aucun n’est caricatural, tous sont humains, trop humains. Au contraire, Alexandra et Marcus, son garde du corps, sont porteurs chacun à sa manière d’une certaine pureté. Claude Clément a encore frappé et bien ! A nouveau, la musique l’inspire, comme elle le note en dédicace : « A mon compagnon, Serge Delbouis, qui fait vibrer l’âme des pianos, à Geneviève Stahl qui éclaira sa vocation, à Belline pour que résonne son piano intérieur… ».
Claude Clément a encore frappé et bien ! A nouveau, la musique l’inspire, comme elle le note en dédicace : « A mon compagnon, Serge Delbouis, qui fait vibrer l’âme des pianos, à Geneviève Stahl qui éclaira sa vocation, à Belline pour que résonne son piano intérieur… ».