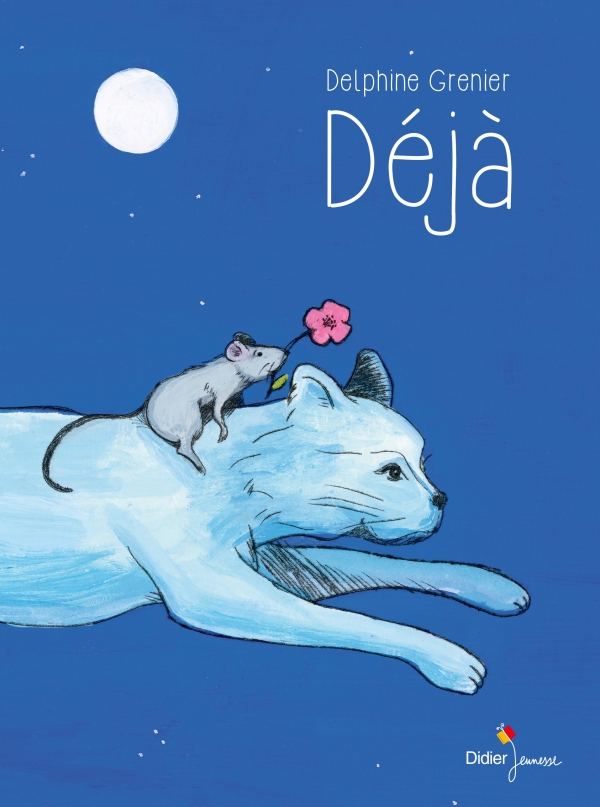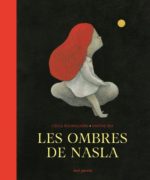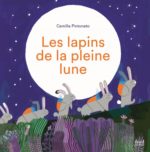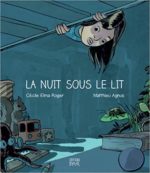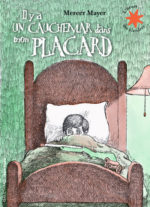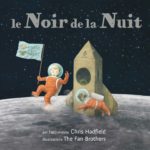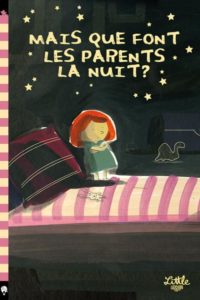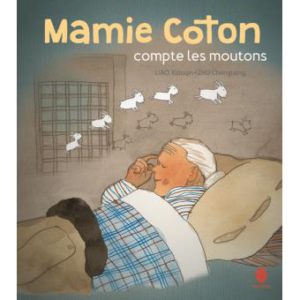Nuit blanche
Alice Brière-Haquet – Raphaële Enjary
(Les Grandes Personnes) 2021
Une histoire de chat et de souris
Par Michel Driol
 C’est la nuit. Le chat se glisse hors de la chambre de son ami pour pourchasser la souris. Comme il neige, elle peut se cacher. Le chat rentre. La souris – la petite souris – prend la dent de l’ami du chat et dépose une pièce d’or tandis que le soleil se lève.
C’est la nuit. Le chat se glisse hors de la chambre de son ami pour pourchasser la souris. Comme il neige, elle peut se cacher. Le chat rentre. La souris – la petite souris – prend la dent de l’ami du chat et dépose une pièce d’or tandis que le soleil se lève.
Sur ce synopsis minimaliste, voici un album somptueux grâce à son graphisme et à l’ingéniosité des couleurs. On le sait, la nuit, tous les chats sont gris, gris souris. L’album conjugue les couleurs essentielles, le noir de la nuit, le gris du chat, le blanc de la neige et de la souris, avec quelques taches de jaune : étoile, yeux du chat, pièce d’or et soleil. Pour l’essentiel, on baigne dans une atmosphère monochrome pleine de poésie que renforce le texte, simple commentaire de l’image, invitant à la contempler en silence. L’album est un appel à l’imaginaire : une découpe de quatre carrés, et voici une fenêtre blanche puis, une fois la page tournée, noire. Deux étoiles, et voici les yeux du chat dès que l’on a tourné la page… Une découpe de souris, visible sur le fond noir de la nuit, invisible sur le fond blanc de la neige… Dans ce décor nocturne et urbain, plein de charme, les deux personnages jouent un jeu éternel, celui du chat et de la souris, jusqu’au retour attendu de la lumière du soleil qui introduit à une nouvelle atmosphère, jaune et lumineuse.
Un album plein de trouvailles poétiques pour évoquer les mystères de la nuit quand les enfants dorment, la magie de la neige qui remplace le noir par le blanc.