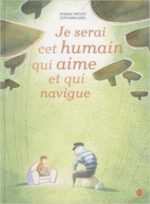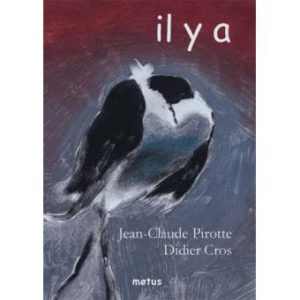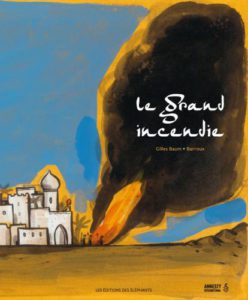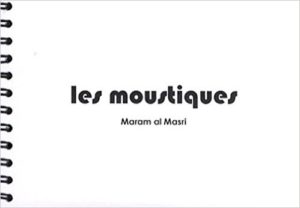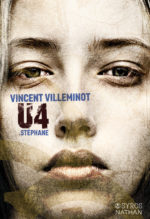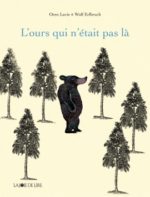Le Livre des petits étonnements du sage Tao LiFu
Jean-Pierre Siméon
Cheyne éditeur
La Grande Muraille n’arrête pas la fourmi
Par Michel Driol
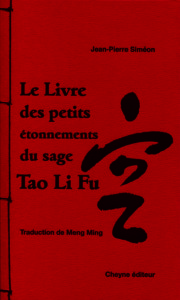 Ce recueil commence par un avertissement de l’auteur : Tao Li Fu aurait vécu « entre deux siècles », était illettré et aurait énoncé ces sentences « frappantes et mystérieuses » à ses contemporains. Qui se les seraient transmises jusqu’à ce qu’au siècle dernier un lettré les transcrive. Des mille feuillets collectés alors n’en sont conservés qu’une poignée, celles qu’on va lire…
Ce recueil commence par un avertissement de l’auteur : Tao Li Fu aurait vécu « entre deux siècles », était illettré et aurait énoncé ces sentences « frappantes et mystérieuses » à ses contemporains. Qui se les seraient transmises jusqu’à ce qu’au siècle dernier un lettré les transcrive. Des mille feuillets collectés alors n’en sont conservés qu’une poignée, celles qu’on va lire…
Suivent alors une soixantaine d’aphorismes, précédés de leur traduction en chinois. Il s’agit de formes brèves, entre une et trois lignes, qui prennent parfois la forme de constations :
Le plus puissant dragon
n’a jamais attrapé un oiseau
Parfois il s’agit de consignes ou de conseils :
Pose une pierre sur ton ombre
et pars en courant
d’hypothèses ;
Si tu regardes le ciel longtemps, il entre.
de rapprochements inattendus :
La caresse et la gifle ont la même main.
La nature y est omniprésente : animaux familiers, astres, nuages, montagnes, arbres, étangs…, et, au sein de cette nature, l’homme bien sûr, ainsi que l’enfant. Si le lecteur adulte se sent parfois proche de Pascal dans ces formes brèves, ces poèmes évoquent bien sûr toutes les formes d’expression d’une sagesse populaire et curieuse du monde, des proverbes non dénués d’humour, en particulier dans les rapprochements effectués entre des réalités différentes :
L’ombre de l’éléphant
et l’ombre du coquelicot
ont le même poids.
L’ouvrage apparait donc comme une leçon : apprendre à s’étonner à partir de la perception de ce qui soudain, par la force des mots, devient une évidence, mais à quoi on n’avait pas, auparavant, prêté attention. Chacun des poèmes devient alors comme une métaphore, dont il reste à découvrir la signification en le laissant résonner en soi. Le recueil n’entend pas enfermer le lecteur dans une interprétation, et c’est ce qui fait sa richesse. Jouant sur les contraires, il montre que la fragilité apparente est une force, que la vitesse n’est pas forcément la valeur suprême, et que la violence détruit celui qui la prône.
Petits étonnements, comme autant de petits concentrés d’humanité, à consommer sans modération, tout en admirant les calligraphes qui le rythment.