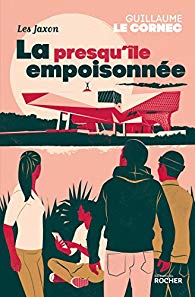Les Jaxon, t. 2: La presqu’île empoisonnée
Guillaume Le Cornec
Editions du Rocher, 2017
Les Jaxon, t. 1: L’île aux panthères
Guillaume Le Cornec
Editions du Rocher, 2017
Comment décoiffer le club des cinq
Par Christine Moulin
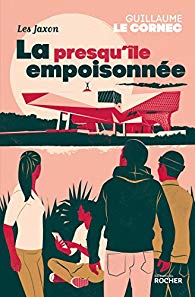 La quatrième de couverture de l’opus 1 l’indique clairement: « Signant le renouveau du polar de clan, en version 2.0, L’île aux panthères jette cinq adolescents au destin singulier dans les sous-sols obscurs d’un monde contemporain dangereux et réaliste ». De fait, ce roman, tout comme le second, met en scène une bande de collégiens dotés de pouvoirs extraordinaires mais pas surnaturels (l’un est un hacker surdoué, l’autre est hypermnésique, etc.). Et elle les plonge dans des complots qui leur font affronter la mafia calabraise, les Triades chinoises, des trafiquants en tout genre, des spéculateurs immobiliers, j’en passe et des meilleurs.
La quatrième de couverture de l’opus 1 l’indique clairement: « Signant le renouveau du polar de clan, en version 2.0, L’île aux panthères jette cinq adolescents au destin singulier dans les sous-sols obscurs d’un monde contemporain dangereux et réaliste ». De fait, ce roman, tout comme le second, met en scène une bande de collégiens dotés de pouvoirs extraordinaires mais pas surnaturels (l’un est un hacker surdoué, l’autre est hypermnésique, etc.). Et elle les plonge dans des complots qui leur font affronter la mafia calabraise, les Triades chinoises, des trafiquants en tout genre, des spéculateurs immobiliers, j’en passe et des meilleurs.
Le premier tome se déroule à Nantes, le deuxième à Lyon : les deux villes sont mises à l’honneur et jouent un grand rôle dans l’intrigue. Pour ceux qui les connaissent bien, il est très réjouissant de voir comment l’auteur en fait le cadre de luttes souterraines et impitoyables. D’une manière générale, les deux histoires sont en prise directe avec le réel et évoquent, sans faux semblant et avec une grande précision, nombre de problèmes politiques contemporains (notamment l’environnement: le désherbant Cleanfields, au cœur du problème à résoudre dans La Presqu’île empoisonnée, cache mal sa ressemblance avec le Roundup, par exemple). Cela dit, ces deux romans restent des romans car nos cinq héros, malgré leur âge, accomplissent des exploits que ne renierait pas un agent aguerri du FBI et la vraisemblance est sans cesse oubliée: l’une des héroïnes n’est-elle pas engagée dans un combat « visant à abattre le système de prédation financière et écologique imposé par certaines multinationales »? Et en gros, elle revient pour le goûter…
L’invraisemblance ne touche pas, toutefois, les relations entre les membre du groupe qui sont finement décrites et ressemblent, finalement, à ce que vivent des jeunes « normaux ». Ce qui fait qu’on s’attache aux héros et que la lecture est très agréable, voire, par moments, addictive, du moins celle du tome 2 car l’intrigue du premier ouvrage est un peu embrouillée.
Mais surtout, surtout, c’est le style qui est remarquable (là encore, sans doute plus nettement dans le second opus): il y a de l’humour, beaucoup d’humour, fondé notamment sur des formules surprenantes (exemple: « Xavier l’attendait porte ouverte avec, sur le visage, un air qu’Oscar ne lui avait jamais vu. Une boule de papier journal chiffonnée qui essaierait de sourire était ce qui s’en rapprochait le plus »). Mais il y aussi des descriptions fortes et frappantes, comme dans cette évocation de Lyon: « Et autour de tout ça, la main invisible et puissante de l’argent toxique et l’énergie brute des quartiers sous pression dont la rage pulsait dans la ville comme des vibrations sorties d’un caisson de basses. Lyon était opulente, baroque, géniale, vulgaire, industrieuse, moderne, expansive, gourmande, explosive et dangereuse ». Il y a souvent, enfin, des passages d’écriture quasi fragmentaire particulièrement bien venus: « Lucas avait appris cette histoire par hasard – porte mal fermée, mère tourmentée « ce n’est pas cet homme que j’ai épousé », lui réveillé… ».
Bref, si l’auteur s’en était tenu au premier volume, on aurait pu penser qu’il s’était contenté de revisiter (avec talent) le club des cinq, en ciblant, il est vrai, un lectorat plus âgé. Mais le deuxième volume, à l’intrigue épurée, séduit par son rythme et par son écriture et acquiert une tout autre dimension : vivement la parution des Jaxon 3!
 Lorsque la Métropole de Lyon décide en 2015 de démolir un grand ensemble construit dans les années 1950, l’émotion est grande chez les habitants, qui, tout en constatant que l’ambiance des débuts n’ y est plus et que les combats pour la drogue ont remplacé l’entraide, se demandent où ils vont aller. Cet album, mais aussi des expositions, animations dans les écoles (Anatole France), lycées (option théâtre, Bron), recueils d’interview, etc. ont été créés pour accompagner cet événement et tenter d’en diminuer la part traumatique.
Lorsque la Métropole de Lyon décide en 2015 de démolir un grand ensemble construit dans les années 1950, l’émotion est grande chez les habitants, qui, tout en constatant que l’ambiance des débuts n’ y est plus et que les combats pour la drogue ont remplacé l’entraide, se demandent où ils vont aller. Cet album, mais aussi des expositions, animations dans les écoles (Anatole France), lycées (option théâtre, Bron), recueils d’interview, etc. ont été créés pour accompagner cet événement et tenter d’en diminuer la part traumatique.