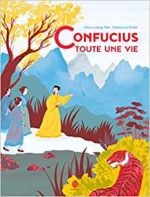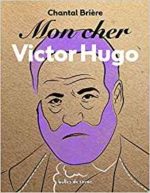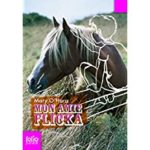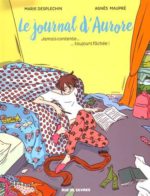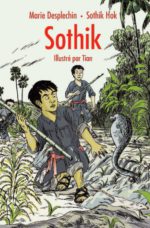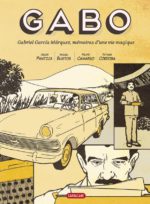Robêêrt (Mêêmoires)
Jean-Luc Fromental
Hélium, 2017
La condition animale vue par Robêêrt (ou Mémoires d’un mouton)
Par Anne-Marie Mercier
« Mouton, en principe, ce n’est pas un métier. Pas comme chien. On peut être chien de chasse, chien d’avalanche, chien d’aveugle, de berger, de cirque, de traineau, chien des douanes ou chien policier, une multitude de carrières s’offre à vous quand vous êtes chien.
Mais mouton…
Certes, nous sommes utiles en tant qu’espèce : couvertures, chaussettes, cache-nez, vestes de tweed et pull douillets, tout ça vient de nous… Ce n’est pas pour rien qu’on appelle « moutons » les petits tas de poussières qui trainent sous les meubles des maisons mal tenues.
Déjà, sans me vanter, il est rare qu’un mouton ait un nom. Tout le monde ou presque a un nom, quand on y réfléchit. Les chiens et les chats ont des noms, les poissons rouges en ont, une tortue peut s’appeler Janine ou Esmeralda, même votre ours en peluche jouit d’un patronyme.
Mais les moutons… »
 Sans se vanter, avec une belle simplicité, Robêêrt nous raconte son histoire : comment, simple agneau, il a appris à parler chien auprès de celui qui assurait la garde du troupeau, puis cheval, puis humain… comment il a appris divers métiers : d’abord chien de berger, avec un certain succès, mais dans une grande solitude (les moutons n’aiment pas que l’un de leurs pareils « monte » en hiérarchie et donne des ordres) ; puis animal domestique dans la « Grande Maison », auprès de petites filles qui jouent avec lui, puis animal de compagnie d’un cheval de course un peu fou, et enfin chômeur en quête d’un travail à sa mesure (mais en dehors de la filière « laine-viande »…).
Sans se vanter, avec une belle simplicité, Robêêrt nous raconte son histoire : comment, simple agneau, il a appris à parler chien auprès de celui qui assurait la garde du troupeau, puis cheval, puis humain… comment il a appris divers métiers : d’abord chien de berger, avec un certain succès, mais dans une grande solitude (les moutons n’aiment pas que l’un de leurs pareils « monte » en hiérarchie et donne des ordres) ; puis animal domestique dans la « Grande Maison », auprès de petites filles qui jouent avec lui, puis animal de compagnie d’un cheval de course un peu fou, et enfin chômeur en quête d’un travail à sa mesure (mais en dehors de la filière « laine-viande »…).
Au passage, on apprend beaucoup de choses sur le milieu hippique, les règles des courses et leurs coulisses : rencontres de propriétaires, jockeys, entrainements, déplacements en Angleterre ou ailleurs (Etats-Unis et Japon), sur la tricherie et les paris.
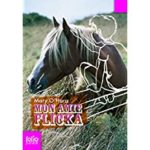 C’est très drôle, surtout à cause du petit ton sérieux utilisé par le narrateur pour raconter son histoire, et dans le détail de nombreux épisodes (comme le récit des techniques qu’il utilise pour calmer son cheval, et l’évocation des lectures qu’il lui fait – toutes sur le thème du cheval avec notamment la série des Flicka…). Les situations sont variées, c’est intéressant, avec un zeste d’aventure policière, un soupçon d’amour (tout le monde, chevaux et moutons, se marie à la fin), et une pointe de féminisme.
C’est très drôle, surtout à cause du petit ton sérieux utilisé par le narrateur pour raconter son histoire, et dans le détail de nombreux épisodes (comme le récit des techniques qu’il utilise pour calmer son cheval, et l’évocation des lectures qu’il lui fait – toutes sur le thème du cheval avec notamment la série des Flicka…). Les situations sont variées, c’est intéressant, avec un zeste d’aventure policière, un soupçon d’amour (tout le monde, chevaux et moutons, se marie à la fin), et une pointe de féminisme.
Les dialogues sont spirituels, tout comme le style qui emprunte souvent au thème lexical du mouton ou plus généralement de l’animal et ne craint pas de jouer avec les formes de l’autobiographie, comme dans le récit du voyage au Japon où concourent les chevaux :
« A l’arrivée à Tokyo nous étions déjà copains comme cochons. […] Je ne garde de cette nuit dans le « monde flottant », comme les poètes appelaient l’ancien Tokyo, qu’un souvenir très flou zébré d’images brutales, de la même matière que ces rêves qui vous secouent toute la nuit pour vous lâcher pantelant au réveil. Je me revois dans une rue bondée, stridente de bruits et de néons, j’entends des applaudissements, on crie sur notre passage, une forêt de smartphones se dresse, les flashes nous éclaboussent de leurs glorieux halos… »
Les jeunes lecteurs, que Robêêrt ne prend pas pour des agneaux de la dernière pluie, ne seront pas rebutés par le le style, tantôt original, tantôt recourant aux clichés, on peut en faire le pari : l’histoire de ce sympathique personnage les portera, comme son ton et son écriture.
Voir un article dans Libération, par Frédérique Roussel, intitulé « Robêêrt, le vaillant petit mouton », qui classe avec justesse ce roman dans les romans initiatiques.
On connaît bien les éditions Hélium pour leurs albums, on oublie parfois qu’ils ont aussi une belle collection de romans et de romans illustrés (ici par Thomas Baas).
 Billie H. c’est Eleanora Holiday, pas encore devenue la Billie Holiday que l’on connait ; elle ne le devient qu’à la fin du livre, repérée dans un club par celui qui lui fait enregistrer son premier disque pour la Columbia, John Hammond. Le récit de Louis Atanga, fondé sur des biographies de la chanteuse retrace l’enfance d’une adolescente noire et pauvre, à Baltimore, puis New York, en lui donnant un fil conducteur classique en littérature de jeunesse, la quête du père : musicien, il les a abandonnées et a « refait » sa vie après avoir goûté à la liberté à Paris, pendant la guerre de 14-18.
Billie H. c’est Eleanora Holiday, pas encore devenue la Billie Holiday que l’on connait ; elle ne le devient qu’à la fin du livre, repérée dans un club par celui qui lui fait enregistrer son premier disque pour la Columbia, John Hammond. Le récit de Louis Atanga, fondé sur des biographies de la chanteuse retrace l’enfance d’une adolescente noire et pauvre, à Baltimore, puis New York, en lui donnant un fil conducteur classique en littérature de jeunesse, la quête du père : musicien, il les a abandonnées et a « refait » sa vie après avoir goûté à la liberté à Paris, pendant la guerre de 14-18.