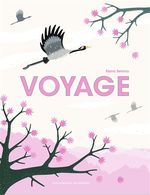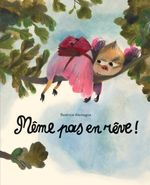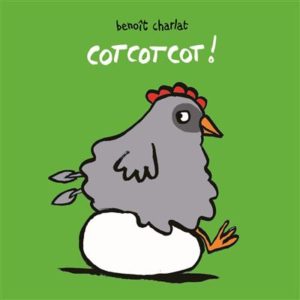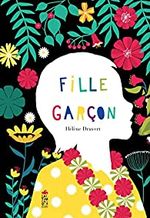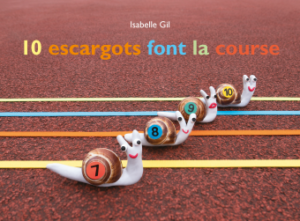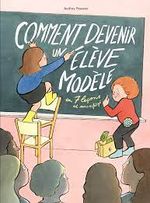C’est obligé que les petits cochons se fassent manger par le loup?
Marie-Agnès Gaudrat, Marie Mignot (ill.)
Casterman, 2021
Questions (pas vraiment) existentielles, quoique…
Par Christine Moulin
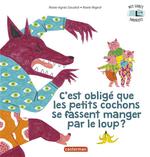 L’album repose sur des recettes éprouvées: les pages cartonnées tout-terrain qui permettent même que l’on dévore le livre, les rabats, des illustrations très colorées et expressives, la formule récurrente « c’est obligé que » qui invite à la participation et les rimes. A cela s’ajoute un répertoire de personnages dont le succès est indestructible: le loup, le chat, la sorcière, l’ogre, les cauchemars, plaisamment représentés sous forme de monstres sympathiques. Rien de surprenant. Il est évident que « ce n’est pas obligé » et que le faible l’emportera toujours sur le fort, qui se retrouve toujours en mauvaise posture. Ce qui l’est peut-être davantage, c’est la chute. Alors qu’on croyait assister à une déconstruction des stéréotypes (d’autant que l’illustration qui accompagne la question sur les « grands méchants » représente UNE grande méchante), on quitte le terrain de la littérature ou de la psychologie, pour assister finalement à une glorification de l’intelligence et du savoir: le slogan « On n’est pas bêtes, on a plein d’idées dans nos têtes » est renforcé par des images de livres, de formules mathématiques et d’encyclopédies. C’est ce qu’il y a de plus original dans l’album.
L’album repose sur des recettes éprouvées: les pages cartonnées tout-terrain qui permettent même que l’on dévore le livre, les rabats, des illustrations très colorées et expressives, la formule récurrente « c’est obligé que » qui invite à la participation et les rimes. A cela s’ajoute un répertoire de personnages dont le succès est indestructible: le loup, le chat, la sorcière, l’ogre, les cauchemars, plaisamment représentés sous forme de monstres sympathiques. Rien de surprenant. Il est évident que « ce n’est pas obligé » et que le faible l’emportera toujours sur le fort, qui se retrouve toujours en mauvaise posture. Ce qui l’est peut-être davantage, c’est la chute. Alors qu’on croyait assister à une déconstruction des stéréotypes (d’autant que l’illustration qui accompagne la question sur les « grands méchants » représente UNE grande méchante), on quitte le terrain de la littérature ou de la psychologie, pour assister finalement à une glorification de l’intelligence et du savoir: le slogan « On n’est pas bêtes, on a plein d’idées dans nos têtes » est renforcé par des images de livres, de formules mathématiques et d’encyclopédies. C’est ce qu’il y a de plus original dans l’album.