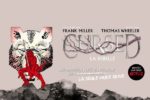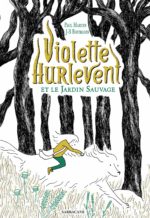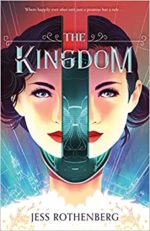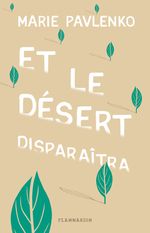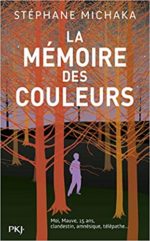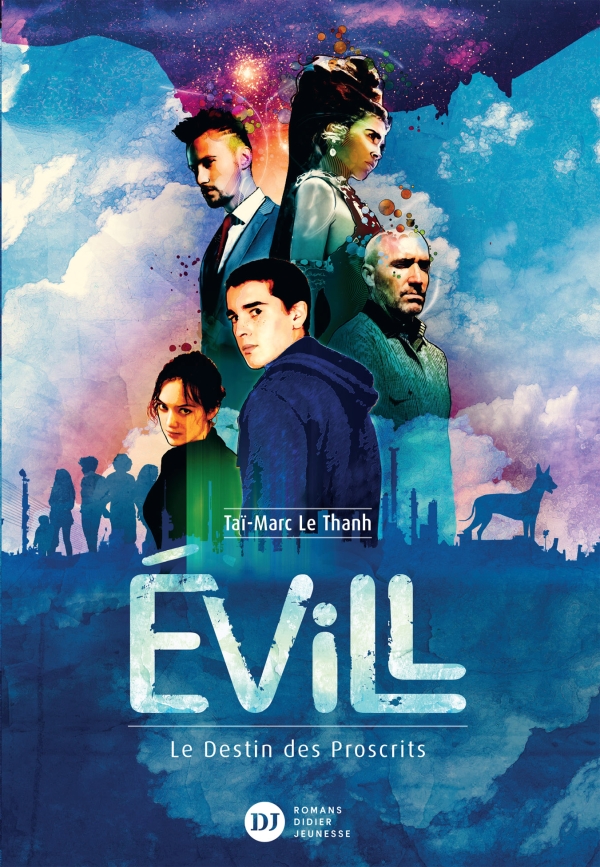Phalaina
Alice Brière-Haquet
Rouergue, 2020écologie
Thriller écologique : le dépassement de Darwin
Par Anne-Marie Mercier
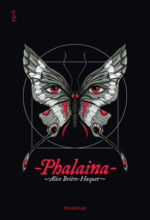 Le début de Phalaina a des allures de « dormeur du val » : une gracieuse enfant marche seule dans une belle lumière d’automne, mais petit à petit des indices d’une catastrophe récente et d’un danger proche émergent et voilà un engrenage implacable lancé. Des assassinats violents se succèdent, générant autant de fuites de la fillette. On est donc dans un thriller, et celui-ci est très réussi : le suspens est permanent, très efficace, et les rebondissements de l’intrigue sont souvent inattendus.
Le début de Phalaina a des allures de « dormeur du val » : une gracieuse enfant marche seule dans une belle lumière d’automne, mais petit à petit des indices d’une catastrophe récente et d’un danger proche émergent et voilà un engrenage implacable lancé. Des assassinats violents se succèdent, générant autant de fuites de la fillette. On est donc dans un thriller, et celui-ci est très réussi : le suspens est permanent, très efficace, et les rebondissements de l’intrigue sont souvent inattendus.
La petite fille, orpheline et muette, a des allures d’Oliver Twist. Il est question de détournement d’héritage, de savants un peu fous… La fillette se cache et est enfermée dans divers lieux, dont un horrible orphelinat dirigé par des religieuses. Elle y endure de nombreuses souffrances et apprend qu’elle ne peut se fier à personne ou presque : l’amitié et la bienveillance qui finissent par émerger dans cette noirceur sont incarnées par de magnifiques et étranges personnages, autre originalité du livre. Enfin, on découvrira seulement à la fin du roman, comme il se doit, de qui elle est la fille.
Enfin, l’arrière-plan du roman et sa thèse est celle d’une réflexion sur la cohabitation des humains avec les animaux et d’une condamnation de la prédation générale menée par l’humanité. Des métamorphoses, l’idée de l’existence d’une espèce intermédiaire entre l’homme et l’animal, d’une hybridation possible, ouvre ce beau roman sur la voie du fantastique et de la poésie.
Le récit est entrecoupé de lettres que le savant (dont on a découvert le corps assassiné au premier chapitre) avait écrites à son ami Darwin, qu’il avait accompagné dans son voyage à bord du Beagle. Chacune de ces lettres est une invitation à la réflexion :
« Chaque espèce, chaque race, possède son propre système de survie adapté à son environnement. Certains choisissent l’attaque et deviennent des prédateurs. […] D’autres espèces préfèrent s’économiser et adoptent un comportement défensif. Ils sont a priori plus fragiles, mais la nature leur propose d’autre armes. Le camouflage, par exemple ».
Ainsi en va-t-il du phalène, papillon de nuit qui donne son titre au roman. La réflexion sur l’animal débouche sur une réflexion large sur la « sélection naturelle » théorisée par Darwin appliquée aux humains. La société est devenue l’environnement naturel des humains, au point que la mode peut y jouer le rôle du camouflage ou de son inverse : « la sélection est devenue culturelle. Elle n’en est pas moins impitoyable ».