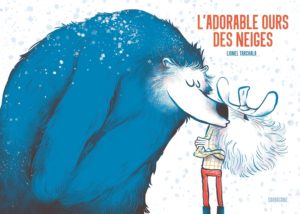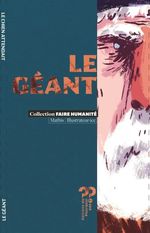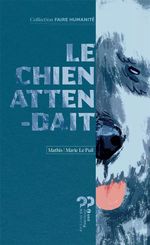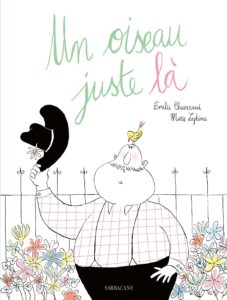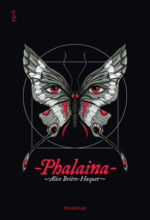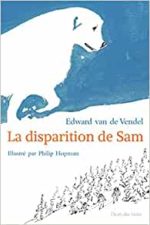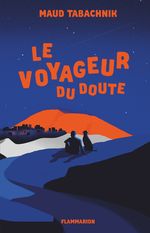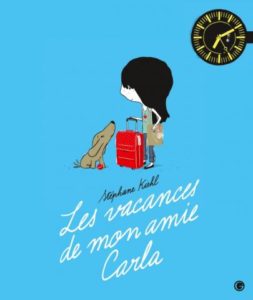Le Voyageur du doute
Maud Tabachnik
Flammarion 2019
Sombre road trip…
Par Michel Driol
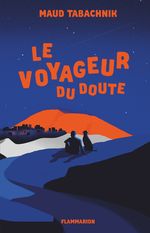 C’est d’abord l’histoire d’un homme, Simon, et de son chien Black, deux amis, désabusés et pessimistes. Lorsque leur route croise 5 jeunes qui vivent de mauvais coups et de cambriolages, Simon ne peut s’empêcher de vouloir les aider, malgré le désaccord de Black. Et lorsque la route des 7 croise celle de Konk et d’autres malfrats, cela devient de plus en plus dangereux pour tout le monde.
C’est d’abord l’histoire d’un homme, Simon, et de son chien Black, deux amis, désabusés et pessimistes. Lorsque leur route croise 5 jeunes qui vivent de mauvais coups et de cambriolages, Simon ne peut s’empêcher de vouloir les aider, malgré le désaccord de Black. Et lorsque la route des 7 croise celle de Konk et d’autres malfrats, cela devient de plus en plus dangereux pour tout le monde.
Le Voyageur du doute laisse aussi le lecteur en plein doute. Publié en jeunesse, avec la mention de la loi de 1949, il permet de mesurer à quel point les conceptions de la littérature jeunesse ont évolué. Car voici un polar sanglant, faisant parfois l’apologie de la marginalité, du vol, et montrant une société future dystopique. Certes, on retrouve l’amitié entre l’homme et l’animal, l’animal qui sauve les hommes, mais le roman cultive les ambigüités : que veut exactement Simon ? Tout à la fois vivre avec d’autres marginaux, agir par amour pour Sonate et les empêcher de se salir encore plus les mains en agissant à leur place… Ces ambiguïtés ne sont pas une faiblesse du roman, mais sa force, car il oblige le lecteur à réfléchir, à se positionner, à se questionner.
Le roman s’inscrit dans un futur particulièrement sombre : si, politiquement, l’Europe semble unie et prête à se désigner un président, la pollution est omniprésente (l’eau du robinet n’est plus potable), et les tensions entre communautés ont atteint un paroxysme. Politiciens et truands sont de mèche (c’est l’un des ressorts de nombreux polars…). Dans cette société inhumaine, se marginaliser et vivre hors la loi devient pratiquement une preuve d’humanité. Du passé de Simon, on ne sait pas grand-chose, mais ce qu’on en sait le présente comme un individu qui a fait de la prison – sans que l’on sache pourquoi. Les 5 jeunes gens sont tous plus ou moins issus de « bonnes »familles, et ont rompu avec elles. Reste donc la route, qu’ils parcourent en moto, façon Easy Rider…, les plages et les chambres d’hôtel. Se marginaliser, c’est vouloir être libre, mais quel est le prix à payer pour cette liberté ?
Le roman pose aussi une relation particulière entre un homme et un chien, philosophes désabusés tous les deux. Ils conversent, et le chien a un point de vue sur le monde, une capacité à réfléchir mais aussi à agir. L’auteure a la subtilité de ne pas faire « parler » le chien. Mais l’écriture montre qu’ils se comprennent, et rend compte des positions du chien, à travers ce que Simon comprend, ou ce que les autres perçoivent de cette relation. Et par bien des aspects, le chien se révèle plus humain que nombre de personnages…
Ce roman vaut enfin par son écriture, qui, paradoxalement, dans un polar où l’action prime, joue abondamment de l’imparfait. C’est dire que l’arrière-plan – la société, les pensées des personnages – passe souvent au premier plan. Il y a là un ton particulier, une langue particulière, qui installent une distance propre à la réflexion du lecteur.
Un polar qui ne laissera pas indifférent, et qui pose de nombreux problèmes liés à notre monde.
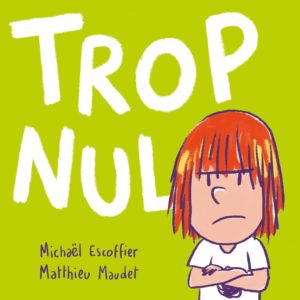 Tous les parents font un jour l’expérience du désir des enfants d’avoir un animal. Beaucoup découvrent que bien souvent l’animal choisi déçoit et, rapidement, ne suffit plus : « trop nul », le poisson, la tortue, le chat, le chien, puis le poney, etc. jusqu’au dernier vœu : un dinosaure. On sait combien les enfants les adorent, mais les dinosaures adorent-ils les enfants ? Celui-là vengera tous les animaux ! La chute est drôle et édifiante…
Tous les parents font un jour l’expérience du désir des enfants d’avoir un animal. Beaucoup découvrent que bien souvent l’animal choisi déçoit et, rapidement, ne suffit plus : « trop nul », le poisson, la tortue, le chat, le chien, puis le poney, etc. jusqu’au dernier vœu : un dinosaure. On sait combien les enfants les adorent, mais les dinosaures adorent-ils les enfants ? Celui-là vengera tous les animaux ! La chute est drôle et édifiante…