Sauvages
Nathalie Bernard
Thierry Magnier 2024
Chasse à l’enfant…
Par Michel Driol
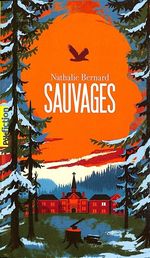 Encore deux mois et Jonas, « numéro 5 », aura 16 ans, et pourra partir de ce pensionnat religieux canadien où l’on tente, de force, de tuer l’indien en chaque enfant. Silencieux, solitaire, fort et musclé, il supporte les brimades, et est employé à bûcheronner avec un autre adolescent de son âge, moins solide que lui, Gabriel, sous la conduite de Samson, le seul adulte un peu sympathique envers eux. La mort de Lucie, qui avait demandé son aide pour lutter contre le prêtre surnommé La Vipère est le déclencheur d’une série d’évènements, et de sa fuite, en compagnie de Gabriel, en pleine débâcle de fin d’hiver. Poursuivis par quatre chasseurs racistes, brutaux et sanguinaires, parviendront-ils à rejoindre la ligne de chemin de fer ?
Encore deux mois et Jonas, « numéro 5 », aura 16 ans, et pourra partir de ce pensionnat religieux canadien où l’on tente, de force, de tuer l’indien en chaque enfant. Silencieux, solitaire, fort et musclé, il supporte les brimades, et est employé à bûcheronner avec un autre adolescent de son âge, moins solide que lui, Gabriel, sous la conduite de Samson, le seul adulte un peu sympathique envers eux. La mort de Lucie, qui avait demandé son aide pour lutter contre le prêtre surnommé La Vipère est le déclencheur d’une série d’évènements, et de sa fuite, en compagnie de Gabriel, en pleine débâcle de fin d’hiver. Poursuivis par quatre chasseurs racistes, brutaux et sanguinaires, parviendront-ils à rejoindre la ligne de chemin de fer ?
Le roman, dont l’action se situe dans les années 50, montre ce que fut l’enfer de ces pensionnats dans lesquels les autorités canadiennes, ou l’Eglise, enfermaient les jeunes Inuits, Chris, afin de les éduquer, en les coupant de leurs racines, de leur familles. Terreur, violence, brimades, et morts fréquentes, abus sexuels, absence de tendresse ou de compassion… Avec réalisme, le roman raconte la vie de ces enfants, auxquels il était interdit de parler leur langue, et qui étaient réduits à un numéro. Le narrateur, Jonas, entremêle le récit de son présent des souvenirs de son enfance avec sa mère, rendant encore plus odieuse la tentative de déculturation à laquelle se livrent les blancs. Après la fuite, le roman, jusqu’alors réaliste et historique, prend des allures de thriller, au milieu du Grand Nord canadien, au sein de la forêt, élément que connaissent bien les deux fugitifs qui vont tirer profit de tout ce qu’ils n’ont pas oublié de leurs cultures, de leurs traditions. L’écriture du roman est fluide, et campe des personnages dont on découvre petit à petit les motivations profondes, et leur façon d’avoir survécu à l’atmosphère infernale du pensionnat. Elle signe ici un cheminement vers la liberté, qui ne pourra être acquise qu’après avoir surmonté de nombreuses épreuves dans un univers hostile où la mort n’est jamais loin.
D’abord édité en 2018, ce roman aide à ne pas oublier ce que fut la colonisation du Canada, la tentative d’éradication des Nations Premières (une note historique finale revient sur ce contexte). Un roman qui sait jouer sur l’émotion, le suspense, et qui touchera profondément ses lectrices et ses lecteurs.





