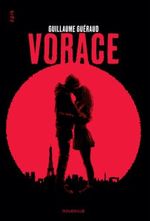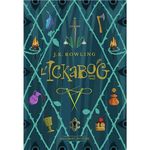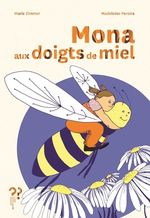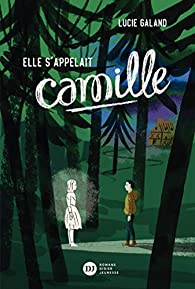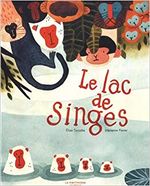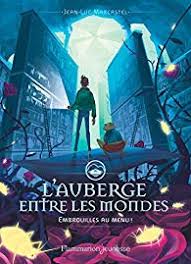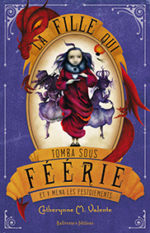Villa Anima
Mathilde Maras
Gulf stream 2021
Pour que vienne l’ère du changement
Par Michel Driol
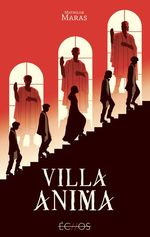 Dans le monde où vit Magda, il y a ceux qui n’ont pas d’écharpes, le peuple, et ceux qui ont des écharpes de couleur, acquises essentiellement par hérédité, qui leur confèrent différents grades dans la société. Quatre couleurs qui donnent des droits, depuis celui d’avorter ou d’être infirmière, jusqu’à la prestigieuse écharpe rouge, celle du pouvoir, dont l’unique détenteur est l’empereur. Dans le monde où vit Magda, il y a une organisation, la Main, qui régit tout, assigne à chacun une place et un rôle. Magda doit subir les moqueries car elle vient du Sud, est brune et bronzée, alors que dans son village tous sont blonds et blancs. A seize ans, elle se retrouve enceinte de son compagnon, Abel et, pour avoir le droit d’avorter, se décide à passer les épreuves de l’Esprit, dans la redoutable Villa Anima, afin de gagner la première écharpe. Mais s’arrêtera-telle à cette écharpe verte ? Jusqu’où osera-t-elle défier le maitre de cette villa, le doucereux et violent Reyne Degraive ?
Dans le monde où vit Magda, il y a ceux qui n’ont pas d’écharpes, le peuple, et ceux qui ont des écharpes de couleur, acquises essentiellement par hérédité, qui leur confèrent différents grades dans la société. Quatre couleurs qui donnent des droits, depuis celui d’avorter ou d’être infirmière, jusqu’à la prestigieuse écharpe rouge, celle du pouvoir, dont l’unique détenteur est l’empereur. Dans le monde où vit Magda, il y a une organisation, la Main, qui régit tout, assigne à chacun une place et un rôle. Magda doit subir les moqueries car elle vient du Sud, est brune et bronzée, alors que dans son village tous sont blonds et blancs. A seize ans, elle se retrouve enceinte de son compagnon, Abel et, pour avoir le droit d’avorter, se décide à passer les épreuves de l’Esprit, dans la redoutable Villa Anima, afin de gagner la première écharpe. Mais s’arrêtera-telle à cette écharpe verte ? Jusqu’où osera-t-elle défier le maitre de cette villa, le doucereux et violent Reyne Degraive ?
Difficile de dater l’époque de la fiction, qui convoque à la fois des éléments du Moyen Age et d’autres du XIXème siècle, façon de dire que ce n’est pas important, et que les codes du fantastique et de la dystopie sont là pour permettre d’aborder par l’imaginaire des problématiques féministes contemporaines. Il y est question bien sûr des droits, comme le droit à l’avortement, des relations hommes femmes, de la place et du rôle des femmes dans la société. Les discours patriarcaux et machistes sont assenés avec force par la plupart des puissants du roman, qui redoutent de voir une femme s’élever dans la société. Mais le roman ne s’arrête pas là. Sur quoi repose la domination d’une classe sur l’autre ? Ceux qui dirigent possèdent l’Esprit, et les épreuves de la Villa Anima sont censées révéler cette possession. Magda s’aperçoit que tout ceci n’est que mensonge et illusion, que le monde n’est qu’un théâtre où chacun doit jouer son rôle. C’est parce qu’elle est déterminée à changer ces règles, à se battre pour une société plus juste qu’elle va jusqu’au bout d’elle-même et des épreuves. Alors qu’elle n’était entrée que pour conquérir l’écharpe verte, la voilà décidée à se battre pour autre chose que son droit personnel à l’avortement, pour avoir le pouvoir de faire changer les choses. Le roman décrit ce qu’il faut de courage à une jeune fille pour s’émanciper, envisager pour elle et sa famille un autre futur.
Pour autant, le fantastique, voire l’épouvante, ne sont pas absents du livre. La Villa Anima est le lieu de phénomènes étranges dont est témoin et victime Magda, phénomènes surnaturels qui la mettent en danger, et la conduisent à s’interroger sur ce qu’est l’Esprit. N’est-il qu’illusion idéologique, ou certains hommes détiennent-ils des pouvoirs leur permettant de mettre en œuvre des forces maléfiques ? Ainsi la Villa constitue un huis clos angoissant mettant à l’épreuve la volonté de la jeune fille, et les nerfs du lecteur, même si les lois du genre le persuadent que tout cela va bien finir.
C’est enfin un roman d’amour qui bouleverse et subvertit les codes du genre. Il n’y a ni Cendrillon, ni Prince Charmant. Que devient l’amour de Magda pour Abel, qui la soutient fidèlement tout au long des épreuves ? On se doute bien que cet amour de jeunesse ne résistera pas au temps, qu’entre la force de Magda et une certaine fragilité d’Abel, les dés sont quelque peu pipés. C’est avec un autre amour que s’épanouira Magda, tout en restant l’amie d’Abel qui mènera sa vie autrement. C’est ce personnage de femme forte qui est finalement intéressant dans le roman, façon de montrer à toutes qu’il faut de la détermination pour gagner sa liberté et changer le monde, mais que cela reste possible, même si les changements prennent du temps. Ce en quoi le roman est bien réaliste !
Un roman mêlant dystopie et fantastique, action et discours, dans une écriture pleine d’allant et de force.