Les Enfants des Feuillantines
Celia Garino
Sarbacane (« X’ »), 2020
Pavé d’été
Par Anne-Marie Mercier
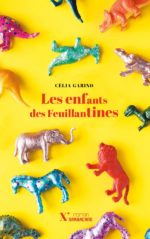 C’est un gros livre : 468 pages ! Mais c’est qu’il y a beaucoup d’enfants dans la maison des Feuillantines (rien à voir avec Victor Hugo, à part le nom). L’ainée de cette tribu de 8 cousins a 24 ans, les autres ont entre deux ans et seize ans, ce sont cinq filles et trois garçons, certains sont jumeaux, l’une est métis. Chacun d’eux a une vie compliquée, et est l’enfant d’une mère compliquée et disparue, le petit-enfant de grands parents morts trop tôt et le descendant d’une arrière-grand-mère centenaire occupant elle-aussi une pièce de la maison. Et puis il y a des animaux, dont un perroquet aigre, un petit cochon plein d’énergie, un lapin fragile…
C’est un gros livre : 468 pages ! Mais c’est qu’il y a beaucoup d’enfants dans la maison des Feuillantines (rien à voir avec Victor Hugo, à part le nom). L’ainée de cette tribu de 8 cousins a 24 ans, les autres ont entre deux ans et seize ans, ce sont cinq filles et trois garçons, certains sont jumeaux, l’une est métis. Chacun d’eux a une vie compliquée, et est l’enfant d’une mère compliquée et disparue, le petit-enfant de grands parents morts trop tôt et le descendant d’une arrière-grand-mère centenaire occupant elle-aussi une pièce de la maison. Et puis il y a des animaux, dont un perroquet aigre, un petit cochon plein d’énergie, un lapin fragile…
Quant aux mères des enfants, trois sœurs, elles ont quitté le navire: l’une s’est suicidée par amour, une autre est partie voyager et n’est pas revenue, la troisième est internée pour soigner sa folie et sa dépendance à l’alcoolisme et à diverses drogues. Ici, on pense aux nombreuses familles catastrophiques dont la littérature de jeunesse est friande (comme dans Oh Boy ! de Marie-Aude Murail, une autre histoire de fratrie à l’abandon).
On pense aussi à Quatre sœurs de Malika Ferdjoukh, qui montrait une fratrie dirigée par l’ainée qui comme Désirée, l’aînée des Feuillantines, jonglait avec les difficultés financières, l’approvisionnement, la solitude, et tentait de répondre aux besoins de chacun. À la fois comiques et tragiques, les enfants, selon leur âge et leur caractère, affrontent la situation :: l’une est à la fois victime et auteure de harcèlement au collège, un autre vit avec un ami imaginaire, les plus jeunes cherchent leur mère où ils peuvent, certains sont amoureux ou amoureuses, un autre cherche un compagnon à Désirée, tous sont un peu perdus mais la maison vibre d’une belle énergie.
On se prend au jeu peu à peu, on rit de leurs explosions, et des jurons de Désirée, on a envie de les suivre, de les écouter, et d’entendre avec eux le bruit de la mer du côté du phare. Et guetter avec eux l’arrivée d’une mère, d’un ami, d’un amour, qu’on espère pour tous ces enfants fracassés (mais n’y comptez pas trop du côté de la mère!).


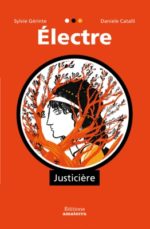





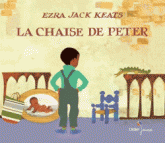

 Les éditions Mijade ont fait un très beau choix en publiant une version française du célèbre roman de l’auteur autrichienne Christine Nöstlinger, prix Andersen (1984) et première lauréate du prix Astrid Lindgren (2003, avec Maurice Sendak). Jusqu’ici, de nombreux autres titres avaient été traduits, mais pas Die Ilse Ist Weg (1991), nouvelle édition sous le titre du film (1976) qui a été tiré de Ilse Janda,14(1974). C’est un classique de la littérature internationale souvent cité dans les ouvrages sur la littérature pour adolescents.
Les éditions Mijade ont fait un très beau choix en publiant une version française du célèbre roman de l’auteur autrichienne Christine Nöstlinger, prix Andersen (1984) et première lauréate du prix Astrid Lindgren (2003, avec Maurice Sendak). Jusqu’ici, de nombreux autres titres avaient été traduits, mais pas Die Ilse Ist Weg (1991), nouvelle édition sous le titre du film (1976) qui a été tiré de Ilse Janda,14(1974). C’est un classique de la littérature internationale souvent cité dans les ouvrages sur la littérature pour adolescents. C’est un très beau livre, très pudique, sur un sujet difficile. Ilse, 14 ans, est partie, c’est sa jeune sœur Erika qui raconte. Complice, elle donne le contexte de la fugue, avec ce qu’elle croit savoir, ses raisons apparentes, comme le divorce des parents, l’éducation trop sévère et trop distante donnée par la mère, les préjugés sociaux… Mais le lecteur comprend progressivement, et un peu plus vite que la narratrice, qu’Ilse a menti à sa sœur et qu’il y a d’autres causes plus profondes, liées à sa personnalité. Il devine aussi rapidement où Ilse s’en est allée, avec qui, et le danger qu’elle court. Au contraire, Erika devra faire toute une enquête, lentement, d’indice en interrogatoire, de preuve en hypothèses, à la façon d’un détective, avant de trouver des réponses à ses questions. Chacune des sœurs fait du chemin, et celui d’Erika la mène vers une maturité qui semble inaccessible à l’aînée.
C’est un très beau livre, très pudique, sur un sujet difficile. Ilse, 14 ans, est partie, c’est sa jeune sœur Erika qui raconte. Complice, elle donne le contexte de la fugue, avec ce qu’elle croit savoir, ses raisons apparentes, comme le divorce des parents, l’éducation trop sévère et trop distante donnée par la mère, les préjugés sociaux… Mais le lecteur comprend progressivement, et un peu plus vite que la narratrice, qu’Ilse a menti à sa sœur et qu’il y a d’autres causes plus profondes, liées à sa personnalité. Il devine aussi rapidement où Ilse s’en est allée, avec qui, et le danger qu’elle court. Au contraire, Erika devra faire toute une enquête, lentement, d’indice en interrogatoire, de preuve en hypothèses, à la façon d’un détective, avant de trouver des réponses à ses questions. Chacune des sœurs fait du chemin, et celui d’Erika la mène vers une maturité qui semble inaccessible à l’aînée. Marie a une soeur, Rose, dont on comprend qu’elle est droguée: à cause de cela, toute la famille est perdue, brisée, anéantie. L’originalité de ce roman, outre de donner le point de vue de la « soeur de la droguée », réside dans une narration non chronologique car, selon la narratrice, les autres cherchent toujours à reconstituer l’ordre de l’histoire afin de trouver une explication mais Julia Jacob-Coeur, qui livre son premier roman jeunesse, s’y refuse. Ce n’est pas tant Rose qui l’intéresse (on entendra sa voix une unique fois dans l’oeuvre) que Marie, plus jeune, en colère, qui cherche à sauver sa peau et ne veut pas comprendre celle qui lui a gâché la vie depuis si longtemps.
Marie a une soeur, Rose, dont on comprend qu’elle est droguée: à cause de cela, toute la famille est perdue, brisée, anéantie. L’originalité de ce roman, outre de donner le point de vue de la « soeur de la droguée », réside dans une narration non chronologique car, selon la narratrice, les autres cherchent toujours à reconstituer l’ordre de l’histoire afin de trouver une explication mais Julia Jacob-Coeur, qui livre son premier roman jeunesse, s’y refuse. Ce n’est pas tant Rose qui l’intéresse (on entendra sa voix une unique fois dans l’oeuvre) que Marie, plus jeune, en colère, qui cherche à sauver sa peau et ne veut pas comprendre celle qui lui a gâché la vie depuis si longtemps.