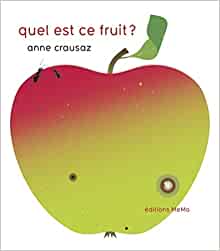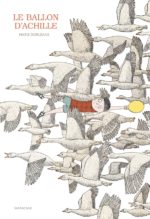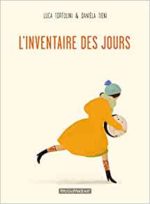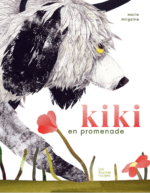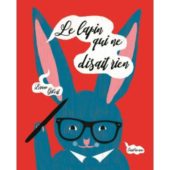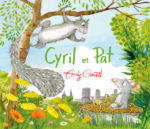La cachette
Andrée Prigent
Didier Jeunesse, 2019
Coucou caché félin
Par Christine Moulin
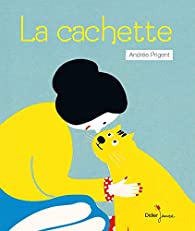 La scénographie, minimale, se révèle diablement efficace. La double page présente une boîte, tel un castelet, dans laquelle on voit, jamais en entier, Yvette qui, comme son nom ne l’indique pas, est un chat, enfin, une chatte. Le décor autour de cette boîte évoque, de façon très épurée, un salon décoré de quelques plantes vertes et d’un coussin rouge à pois blancs. Tout l’intérêt réside dans le mouvement qui nous fait pénétrer dans la pièce grâce à un savant travelling: sur la poignée de la porte se pose une main. On aperçoit alors un chemisier rouge à pois blancs qui, en faisant écho au coussin, aspire le lecteur vers la boîte mystérieuse. Progressivement, l’espace va être envahi par cette présence humaine. Parallèlement, Yvette se cache, se montre, bref, fait le chat, sans jamais quitter son refuge. Le texte rythme le jeu (« Yvette, je vois tes oreilles », « Yvette, je vois ton dos »), jusqu’au silence, qui inquiète délicieusement: « Yvette, je n’entends plus rien. Tu dors? » Le carton disparaît pour laisser place à la belle révélation finale qui explique la réticence d’Yvette à sortir de sa cachette. Tout est doux, serein, naturel : la complicité entre l’homme et l’animal (qu’on devine dès la couverture), la joie de la naissance. Les illustrations rappellent, par leur lisibilité et leur charme, celles de Nathalie Parain (dont le premier ouvrage s’intitulait d’ailleurs Mon chat): la filiation est flatteuse!
La scénographie, minimale, se révèle diablement efficace. La double page présente une boîte, tel un castelet, dans laquelle on voit, jamais en entier, Yvette qui, comme son nom ne l’indique pas, est un chat, enfin, une chatte. Le décor autour de cette boîte évoque, de façon très épurée, un salon décoré de quelques plantes vertes et d’un coussin rouge à pois blancs. Tout l’intérêt réside dans le mouvement qui nous fait pénétrer dans la pièce grâce à un savant travelling: sur la poignée de la porte se pose une main. On aperçoit alors un chemisier rouge à pois blancs qui, en faisant écho au coussin, aspire le lecteur vers la boîte mystérieuse. Progressivement, l’espace va être envahi par cette présence humaine. Parallèlement, Yvette se cache, se montre, bref, fait le chat, sans jamais quitter son refuge. Le texte rythme le jeu (« Yvette, je vois tes oreilles », « Yvette, je vois ton dos »), jusqu’au silence, qui inquiète délicieusement: « Yvette, je n’entends plus rien. Tu dors? » Le carton disparaît pour laisser place à la belle révélation finale qui explique la réticence d’Yvette à sortir de sa cachette. Tout est doux, serein, naturel : la complicité entre l’homme et l’animal (qu’on devine dès la couverture), la joie de la naissance. Les illustrations rappellent, par leur lisibilité et leur charme, celles de Nathalie Parain (dont le premier ouvrage s’intitulait d’ailleurs Mon chat): la filiation est flatteuse!
PS: il est possible de feuilleter (en partie) le livre sur le site de l’éditeur