Aventuriers malgré eux, t. 1 (1 Yack, 2 yétis, 3 explorateurs)
C. Alexander London
traduit (américain) par Valérie Le Plouhinec
Les Grandes personnes, 2012
Aventures en vrac
Par Anne-Marie Mercier
 Comme le titre l’indique, les héros (frère et sœur jumeaux) n’ont pas le goût de l’aventure. Ils aiment surtout (et exclusivement) la télévision, essentiellement les séries ou à la rigueur les documentaires animaliers ou les jeux. Pour leur malheur, leurs parents sont des explorateurs. Et pour leur malheur encore plus grand, leur mère a disparu et ils sont contraints de partir à sa recherche au Tibet, à la poursuite de Shangri-La et des tablettes de la Bibliothèque d’Alexandrie… Ils doivent vivre les aventures les plus extravagantes que leurs séries les plus décoiffées n’auraient pas imaginées: yétis, sorcières empoisonneuses, moines et lama les attendent au-dela d’une cascade gigantesque…
Comme le titre l’indique, les héros (frère et sœur jumeaux) n’ont pas le goût de l’aventure. Ils aiment surtout (et exclusivement) la télévision, essentiellement les séries ou à la rigueur les documentaires animaliers ou les jeux. Pour leur malheur, leurs parents sont des explorateurs. Et pour leur malheur encore plus grand, leur mère a disparu et ils sont contraints de partir à sa recherche au Tibet, à la poursuite de Shangri-La et des tablettes de la Bibliothèque d’Alexandrie… Ils doivent vivre les aventures les plus extravagantes que leurs séries les plus décoiffées n’auraient pas imaginées: yétis, sorcières empoisonneuses, moines et lama les attendent au-dela d’une cascade gigantesque…
Chaque chapitre offre une situation nouvelle, un obstacle inattendu, des rencontres qui sont la plupart du temps des retrouvailles avec les méchants qui sont à leurs trousses. L’humour domine à travers les échanges entre les jumeaux. Ils restent eux-mêmes quelles que soient les circonstances et traînent des pieds autant qu’ils peuvent ; c’est d’ailleurs souvent en faisant référence à un épisode d’une de leurs séries télé qu’ils trouvent des solutions aux situations les plus désespérées. Enfin, l’ensemble ressemble à un jeu où l’on saute de case en case, revient sur ses pas, retrouve les mêmes personnes sous d’autres apparences… un genre de série humoristico-aventureuse (les Orphelins Baudelaire en plus agité). Ce côté décousu et forcément répétitif gênera certains lecteurs et plaira aux lecteurs moins habiles sur les histoires au long cours.
C’est, évidemment le premier tome d’une série : à la fin du premier volume, les jumeaux se retrouvent liés par contrat à leur pire ennemi, on frémit d’avance…

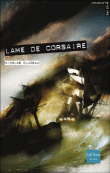
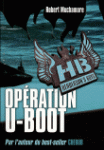
 Quel étrange roman : cela commence comme Le Club des Cinq. Maxime, 15 ans, couvé par ses parents, est envoyé en vacances chez l’habitant dans une île (qui ressemble furieusement à la Corse), pour y apprendre l’autonomie. Sa famille d’accueil est composée d’une mère, d’une grand-mère et de deux enfants, Ange, adorable bambin, et Maria, la fille de la maison, à peu près de son âge. Comme on peut s’y attendre, les relations entre Maria et Maxime sont d’abord tendues, l’une étant persuadée, non sans raisons, que l’autre est un fils à papa (qui plus est, elle est obligée de lui céder sa chambre).
Quel étrange roman : cela commence comme Le Club des Cinq. Maxime, 15 ans, couvé par ses parents, est envoyé en vacances chez l’habitant dans une île (qui ressemble furieusement à la Corse), pour y apprendre l’autonomie. Sa famille d’accueil est composée d’une mère, d’une grand-mère et de deux enfants, Ange, adorable bambin, et Maria, la fille de la maison, à peu près de son âge. Comme on peut s’y attendre, les relations entre Maria et Maxime sont d’abord tendues, l’une étant persuadée, non sans raisons, que l’autre est un fils à papa (qui plus est, elle est obligée de lui céder sa chambre). Florence Thinard dit elle-même qu’elle écrit avec un chapeau à plume (mental, bien sûr), et ça se voit. Son récit situé au 17e siècle reprend les ressorts du roman populaire de cape et d’épée, son modèle est la série des Pardaillan.
Florence Thinard dit elle-même qu’elle écrit avec un chapeau à plume (mental, bien sûr), et ça se voit. Son récit situé au 17e siècle reprend les ressorts du roman populaire de cape et d’épée, son modèle est la série des Pardaillan. Non, Eoin Colfer ne fait pas que du « Artemis Fowl », il écrit aussi de merveilleux romans d’aventures qui puisent à la fois à la source du roman populaire et à la veine de Jules Verne.
Non, Eoin Colfer ne fait pas que du « Artemis Fowl », il écrit aussi de merveilleux romans d’aventures qui puisent à la fois à la source du roman populaire et à la veine de Jules Verne. En écrivant sur le premier tome de la série, j’avais exprimé une certaine déception (voir plus bas). Le deuxième tome (et le dernier) est superbe et lève tous les doutes. Il va à toute allure, en train, en avion, à cheval… et toujours en dirigeable, d’Amérique en Russie en s’arrêtant en France, en Italie et en Ecosse. Il multiplie les péripéties et les coups de théâtre, croise les genres et les styles. Les thèmes du roman populaire (enlèvements, sombres complots, prince caché, retrouvailles…) sont brassés de belle manière ; on trouve aussi un zeste de roman de guerre (ici, la montée du nazisme, l’occupation, la résistance), un peu de roman d’espionnage (gentiment antisoviétique comme dans l’ancien temps…on ne va pas trop creuser sur ce plan), et une pincée de roman sentimental. Tout cela est brassé avec talent et avec des moments d’humour (le commissaire et sa vieille mère sont joliment traités). Enfin, si le livre est fort bien écrit, les derniers chapitres sont superbes et évoquent avec poésie et acuité le désespoir, le désir et la nostalgie.
En écrivant sur le premier tome de la série, j’avais exprimé une certaine déception (voir plus bas). Le deuxième tome (et le dernier) est superbe et lève tous les doutes. Il va à toute allure, en train, en avion, à cheval… et toujours en dirigeable, d’Amérique en Russie en s’arrêtant en France, en Italie et en Ecosse. Il multiplie les péripéties et les coups de théâtre, croise les genres et les styles. Les thèmes du roman populaire (enlèvements, sombres complots, prince caché, retrouvailles…) sont brassés de belle manière ; on trouve aussi un zeste de roman de guerre (ici, la montée du nazisme, l’occupation, la résistance), un peu de roman d’espionnage (gentiment antisoviétique comme dans l’ancien temps…on ne va pas trop creuser sur ce plan), et une pincée de roman sentimental. Tout cela est brassé avec talent et avec des moments d’humour (le commissaire et sa vieille mère sont joliment traités). Enfin, si le livre est fort bien écrit, les derniers chapitres sont superbes et évoquent avec poésie et acuité le désespoir, le désir et la nostalgie. Si l’action ne se déroulait pas dans le Grand Nord, dans une atmosphère glaciale, pure et étouffante comme celle des tragédies, on pourrait dire qu’il s’agit d’un western: le héros de l’histoire principale (il y a une histoire-cadre que je vous laisse découvrir), Sig, est un jeune garçon dont le père Einar meurt dès les premières lignes (« Sig regardait fixement le corps immobile de son père, attendant qu’il parle, et le père se taisait, car il était mort »). Einar, on l’apprendra, a été impitoyablement poursuivi, pendant toute sa vie, par une brute, un homme-ours (du nom de Wolff…) qu’il a trompé, dans une affaire d’or et de trésor. Appât du gain, batailles, ressentiment, vengeance, errance, violence, tout est là.
Si l’action ne se déroulait pas dans le Grand Nord, dans une atmosphère glaciale, pure et étouffante comme celle des tragédies, on pourrait dire qu’il s’agit d’un western: le héros de l’histoire principale (il y a une histoire-cadre que je vous laisse découvrir), Sig, est un jeune garçon dont le père Einar meurt dès les premières lignes (« Sig regardait fixement le corps immobile de son père, attendant qu’il parle, et le père se taisait, car il était mort »). Einar, on l’apprendra, a été impitoyablement poursuivi, pendant toute sa vie, par une brute, un homme-ours (du nom de Wolff…) qu’il a trompé, dans une affaire d’or et de trésor. Appât du gain, batailles, ressentiment, vengeance, errance, violence, tout est là.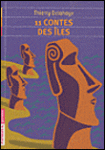
 La nouvelle œuvre de François Place, Le Secret d’Orbae, n’est pas un livre, c’est bien plus que cela : elle propose une nouvelle forme. C’est un coffret noir d’apparence mystérieuse dans lequel on trouve deux romans illustrés accompagnés par une carte de l’univers associé aux textes, et par des images illustrant certains de leurs épisodes, placées dans un portfolio cartonné et fermé par un lien. L’objet en lui-même est très beau.
La nouvelle œuvre de François Place, Le Secret d’Orbae, n’est pas un livre, c’est bien plus que cela : elle propose une nouvelle forme. C’est un coffret noir d’apparence mystérieuse dans lequel on trouve deux romans illustrés accompagnés par une carte de l’univers associé aux textes, et par des images illustrant certains de leurs épisodes, placées dans un portfolio cartonné et fermé par un lien. L’objet en lui-même est très beau.