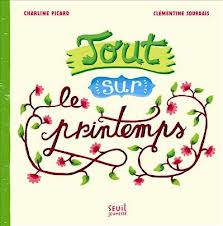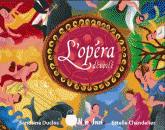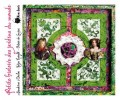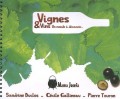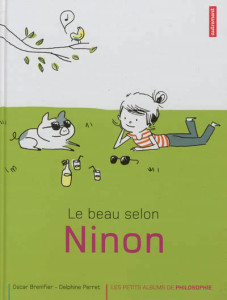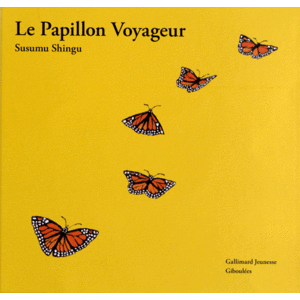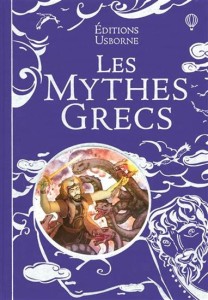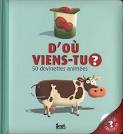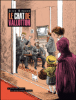L’opéra dévoilé
Sandrine Duclos (texte), Laurent Croizier (conseil scientifique), Estelle Chadelier (illustrations)
Mama Josefa (Tapis volant), 2012
Tout l’opéra en jeux
Par Anne-Marie Mercier
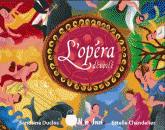 Les opéras pour enfants se sont multipliés depuis plusieurs années, mais il manquait un ouvrage qui permette aux jeunes spectateurs de connaître à la fois l’histoire du genre et l’envers du décor. Mama Josefa propose un album maniable qui réussit le tour de force de présenter à peu près tous les aspects de ce spectacle total en quelques doubles pages : l’histoire du genre est évoquée, depuis les premiers spectacles chantés de l’antiquité à nos jours, en passant par l’opera buffa, la tragédie lyrique et le ballet, avec les styles nationaux (italien, français, allemand, chinois…), quelques grands compositeurs, quelques œuvres majeures comme La Flûte enchantée, souvent proposée au jeune public en version courte.
Les opéras pour enfants se sont multipliés depuis plusieurs années, mais il manquait un ouvrage qui permette aux jeunes spectateurs de connaître à la fois l’histoire du genre et l’envers du décor. Mama Josefa propose un album maniable qui réussit le tour de force de présenter à peu près tous les aspects de ce spectacle total en quelques doubles pages : l’histoire du genre est évoquée, depuis les premiers spectacles chantés de l’antiquité à nos jours, en passant par l’opera buffa, la tragédie lyrique et le ballet, avec les styles nationaux (italien, français, allemand, chinois…), quelques grands compositeurs, quelques œuvres majeures comme La Flûte enchantée, souvent proposée au jeune public en version courte.
C’est aussi l’occasion de revenir sur des points fondamentaux de la connaissance de la musique : la voix et les voix, la composition d’un orchestre, le rôle du texte et de la musique. D’autres aspects (la scène, les costumes, le vocabulaire spécifique et les traditions, mais aussi le rôle de l’opéra dans l’histoire et la vie sociale, ses liens avec la création en général…) proposent des ouvertures multiples, qui peuvent être prolongées grâce à une biblio-disco-sitographie en fin d’ouvrage . Enfin, de nombreux jeux permettent au jeune lecteur de chercher la réponse à des questions, de compléter l’ouvrage, de mettre cet art en lien avec ce qu’il connaît. Les illustrations allient scènes colorées et documents, gravures ou photos retravaillés : art total au service d’un art total.
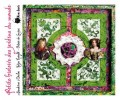 Les éditions Mama Josefa sont décrites sur leur site comme « À la croisée des chemins de l’éducation et de l’environnement »; elles comptent en Aquitaine une centaine d’adhérents, individuels ou associations, et proposent depuis 2010 des documentaires de qualité, respectueux de l’environnement. Le principe : » apprendre à regarder autour de soi, découvrir le monde pour acquérir des clés et développer une relation joyeuse au savoir ».
Les éditions Mama Josefa sont décrites sur leur site comme « À la croisée des chemins de l’éducation et de l’environnement »; elles comptent en Aquitaine une centaine d’adhérents, individuels ou associations, et proposent depuis 2010 des documentaires de qualité, respectueux de l’environnement. Le principe : » apprendre à regarder autour de soi, découvrir le monde pour acquérir des clés et développer une relation joyeuse au savoir ».
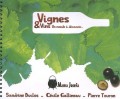 Dans la même collection, on trouve un ouvrage sur la préhistoire, le rugby, les rapaces, Sandrine Duclos a participé à Vignes & vins, un monde à découvrir… (ouvrage primé, en lien avec la région de ces éditions, celle de Bordeaux) et à La Petite histoire des jardins du monde.
Dans la même collection, on trouve un ouvrage sur la préhistoire, le rugby, les rapaces, Sandrine Duclos a participé à Vignes & vins, un monde à découvrir… (ouvrage primé, en lien avec la région de ces éditions, celle de Bordeaux) et à La Petite histoire des jardins du monde.
 Il est en soi intéressant que l’auteur de ce nouvel atlas soit un grand voyageur, tandis que son illustrateur se donne plutôt comme un flâneur du monde des livres. Les vertus d’une telle mise en tension se confirment à la lecture des vingt cartes et du planisphère présentés ici. Leur ordre est tout d’abord digne d’intérêt : d’abord les océans – et d’abord le Pacifique – puis, pour les continents, d’abord l’Océanie, suivie des cinq Asie (sud-Est, Est, Nord et centre, Sud, Sud-Ouest). Le ton est donné : quoique forcément incomplète, c’est une vision de la complexité du monde, mais aussi de ses proportions réelles qui saute au frais visage de lecteurs définis comme ayant au moins 7 ans. Comme tout effort sérieux de saisie du réel, celui-ci est précédé d’une réflexion sur l’histoire de son objet – avec une introduction sur l’histoire de la planète – et sur l’histoire de son intellection – avec un chapitre intitulé « cartographier le monde ».
Il est en soi intéressant que l’auteur de ce nouvel atlas soit un grand voyageur, tandis que son illustrateur se donne plutôt comme un flâneur du monde des livres. Les vertus d’une telle mise en tension se confirment à la lecture des vingt cartes et du planisphère présentés ici. Leur ordre est tout d’abord digne d’intérêt : d’abord les océans – et d’abord le Pacifique – puis, pour les continents, d’abord l’Océanie, suivie des cinq Asie (sud-Est, Est, Nord et centre, Sud, Sud-Ouest). Le ton est donné : quoique forcément incomplète, c’est une vision de la complexité du monde, mais aussi de ses proportions réelles qui saute au frais visage de lecteurs définis comme ayant au moins 7 ans. Comme tout effort sérieux de saisie du réel, celui-ci est précédé d’une réflexion sur l’histoire de son objet – avec une introduction sur l’histoire de la planète – et sur l’histoire de son intellection – avec un chapitre intitulé « cartographier le monde ».