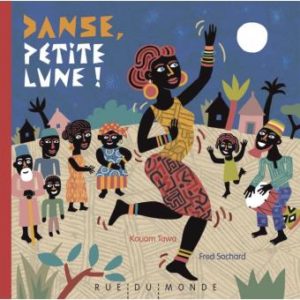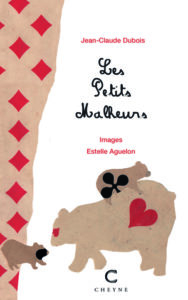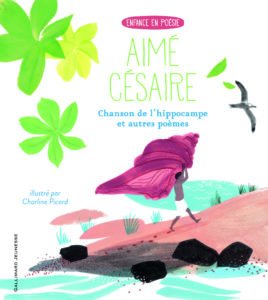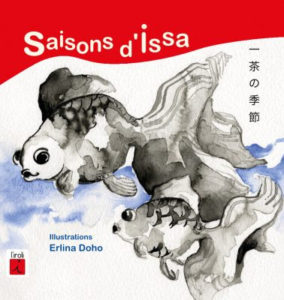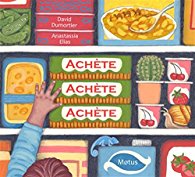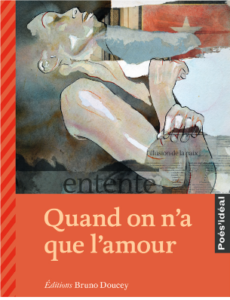Passagers d’exil
Anthologie présentée et établie
par Bruno Doucey et Pierre Kobel
Editions Bruno Doucey 2017,
De quoi faire aimer la poésie aux ados
Par Maryse Vuillermet
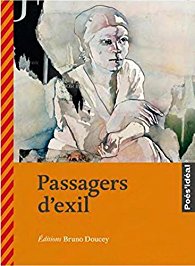 Cette anthologie vient enrichir la collection Poes’idéal « une collection engagée de poèmes rassemblés autour d’un idéal » dirigée par Mireille Szac qui a déjà publié Guerre à la guerre, Vive la liberté !, Chants du métissage, Quand on a que l’amour.
Cette anthologie vient enrichir la collection Poes’idéal « une collection engagée de poèmes rassemblés autour d’un idéal » dirigée par Mireille Szac qui a déjà publié Guerre à la guerre, Vive la liberté !, Chants du métissage, Quand on a que l’amour.
Elle rassemble soixante poètes d’âges, de nationalités et de sensibilités très différentes, comme Mahmoud Darwich, le Palestinien, Mohamed Cherfi et Soprano, les rappeurs d’origine algérienne et comorienne, les romanciers français Laurent Gaudé, Didier Daeninckx , les poètes classiques comme Jacques Prévert, Herman Hesse ou plus contemporains comme la Mauricienne Ananda Devi, Gaël Faye…
Elle se structure en cinq parties qui sont les étapes du parcours de l’exil :
I Il a fallu partir, parle de l’arrachement, du départ et de ses causes, la misère, la guerre, la persécution.
II Maintenant il faut traverser Les poèmes disent les dangers et les douleurs du voyage.
III Cet endroit n’entend pas, décrit la douleur et la surprise d’arriver dans un lieu indifférent, hostile, froid, d’être rejetés
IV Et les portes se referment, disent l’exil, l’errance, la solitude et l’anonymat.
V Parle-leur d’espoir Là, on nous parle de fraternité, de collectif, de langue et de paroles pour s’exprimer.
Entre chacune des parties, une double page de citations, phrases percutantes et fortes.
L’anthologie est accompagnée d’une introduction et d’une conclusion de Bruno Doucey, poète et éditeur, qui rappelle avec ses images, son histoire personnelle et de manière poétique, le contexte historique et politique.
Et enfin, chaque poème ou texte est accompagné d’une courte biographie de l’écrivain mettant l’accent sur sa relation au thème, personnelle, familiale, politique, ou d’engagement personnel.
Bibliographie, discographie, filmographie ainsi que des références bibliographiques de chaque extrait permettent d’aller plus loin.
C’est vraiment un très beau travail que l’illustration de Bruno Clarke, subtile et forte, sert avec justesse, les textes sont émouvants, le choix est varié, le propos n’est jamais larmoyant mais toujours, les mots des poètes parviennent à dire mieux que tous les documentaires l’humain, le singulier et l’inacceptable de cette actualité.