Graal Noir
Christian de Montella
Flammarion, 2011
Graal Noir I : « la menace fantôme »
Par Christine Moulin
To us les ingrédients médiévaux et bien connus sont là. La légende est, à quelques variantes près, intacte. Tout se met en place, mais rien n’a vraiment commencé. C’est ainsi qu’on assiste à la naissance de Merlin et à sa montée en puissance mais aussi à tous les stratagèmes et détours qui ont rendu possible la naissance d’Arthur. Les indispensables objets sont évoqués: l’épée dans la pierre, mais aussi le Graal. La maléfique Morgane est prête à nuire. Tout cela sur fond de lutte entre la nouvelle religion, chrétienne, et l’ancienne, celle des Druides. Sans qu’on sache exactement où se situe Merlin: il est le fils du Diable, certes, mais aussi d’une femme, qui lui a fait don de son humanité, part de lui-même qu’il a la liberté de développer, s’il en fait le choix. D’un autre côté, c’est d’une druidesse qu’il doit recevoir (au tome 2, si tout va bien?) la plénitude de ses pouvoirs.
us les ingrédients médiévaux et bien connus sont là. La légende est, à quelques variantes près, intacte. Tout se met en place, mais rien n’a vraiment commencé. C’est ainsi qu’on assiste à la naissance de Merlin et à sa montée en puissance mais aussi à tous les stratagèmes et détours qui ont rendu possible la naissance d’Arthur. Les indispensables objets sont évoqués: l’épée dans la pierre, mais aussi le Graal. La maléfique Morgane est prête à nuire. Tout cela sur fond de lutte entre la nouvelle religion, chrétienne, et l’ancienne, celle des Druides. Sans qu’on sache exactement où se situe Merlin: il est le fils du Diable, certes, mais aussi d’une femme, qui lui a fait don de son humanité, part de lui-même qu’il a la liberté de développer, s’il en fait le choix. D’un autre côté, c’est d’une druidesse qu’il doit recevoir (au tome 2, si tout va bien?) la plénitude de ses pouvoirs.
Pour l’instant, il n’est encore qu’un beau jeune homme, très doué, très agaçant, plein de morgue et de charme, flanqué d’une espèce de Sancho Pança, prêtre rondelet et gourmand, comme dans les farces du Moyen Age, qui se damnerait pour un poulet mais qui, en tant que chroniqueur, représente l’auteur au sein même de la fiction, de façon distanciée et comique, tout en jouant le rôle de protecteur pour Merlin. C’est que celui-ci, quoique capable de lire dans le passé et dans l’avenir, de se métamorphoser en n’importe quoi, de réaliser d’extraordinaires tours de magie, n’est pas encore tout à fait maître de lui-même. Il n’a que dix-huit ans (à peine) et il dépense sans compter son énergie en prodiges inutiles destinés à ébaudir qui veut bien l’admirer. Il s’amuse et même s’il a connu l’amertume d’un chagrin d’amour, il manque de profondeur, d’expérience, de sagesse. On croirait Harry Potter dans ses pires années.
Ce côté adolescent et, en général, les analyses psychologiques, nombreuses, contribuent largement à la modernisation du mythe. Nous avons souvent accès à l’intériorité des personnages, qui ne sont plus des figures légendaires mais des hommes et des femmes proches de nous, des individus qui ont une vie plus qu’un destin, même si celui-ci frappe à la porte avec insistance. Un autre élément qui modernise, mais en même temps, il faut l’avouer, désacralise quelque peu l’histoire du Graal, c’est l’écriture elle-même, cinématographique, faite de montages alternés, de « scènes », de raccourcis qui confèrent à la lecture un rythme haletant de « blockbuster ». Enfin, l’érotisme, assez torride et explicite (éloignez les très jeunes), les désirs clairement exposés des personnages (je ne me rappelais pas que Morgane ait eu une attirance incestueuse pour son père) marquent la différence avec les romans de Chrétien de Troyes! On est plus proche de l’univers de Marion Zimmer Bradley et de ses Dames du lac.
Néanmoins, si j’osais, je dirais que « ça dépote » et que ce roman peut très bien donner l’envie de se plonger dans la geste arthurienne, quitte à retourner vers son origine et y découvrir d’autres joies, moins immédiates, mais tout aussi intenses.
PS : l’avis de Ricochet

 Le roman débute au coeur de l’histoire, lorsque Darina, une héroïne rappelant étrangement la Bella de Twilight, se retrouve, non pas face à des vampires, mais à des revenants, nommés, de façon plus « vendeuse », « Beautiful Dead ». Dans la mesure où elle entretenait une passion amoureuse fusionnelle avec Phoenix, l’un des lycéens morts sans explication durant l’année scolaire, elle se retrouve, étrangement, en mission pour le compte de morts vivants cherchant la sérénité et le paradis, semble-t-il. Ce premier tome concerne l’enquête à propos de la mort inexpliquée de Jonas, le premier mort. Le deuxième tome, Arizona, vient de paraître. Devraient suivre deux autres, centrés chacun sur une nouvelle enquête, avec le meilleur pour la fin, puisque Phoenix est le dernier mort de la série !
Le roman débute au coeur de l’histoire, lorsque Darina, une héroïne rappelant étrangement la Bella de Twilight, se retrouve, non pas face à des vampires, mais à des revenants, nommés, de façon plus « vendeuse », « Beautiful Dead ». Dans la mesure où elle entretenait une passion amoureuse fusionnelle avec Phoenix, l’un des lycéens morts sans explication durant l’année scolaire, elle se retrouve, étrangement, en mission pour le compte de morts vivants cherchant la sérénité et le paradis, semble-t-il. Ce premier tome concerne l’enquête à propos de la mort inexpliquée de Jonas, le premier mort. Le deuxième tome, Arizona, vient de paraître. Devraient suivre deux autres, centrés chacun sur une nouvelle enquête, avec le meilleur pour la fin, puisque Phoenix est le dernier mort de la série ! Bel, l’héroïne, meurt dans un accident de montagnes russes. Mais elle ne se résigne pas à quitter le monde des vivants, pour des raisons que nous ne dévoilerons pas ici, et erre, invisible (sauf pour l’œil acéré d’une médium), principalement entre l’appartement de ses parents et l’hôpital, où gît l’amour de sa vie, victime du même accident.
Bel, l’héroïne, meurt dans un accident de montagnes russes. Mais elle ne se résigne pas à quitter le monde des vivants, pour des raisons que nous ne dévoilerons pas ici, et erre, invisible (sauf pour l’œil acéré d’une médium), principalement entre l’appartement de ses parents et l’hôpital, où gît l’amour de sa vie, victime du même accident. La « bit lit », n’est-ce pas ?, c’est cette littérature destinée principalement aux adolescentes, qui, dans le sillage plus ou moins commercial de Twilight, raconte les amours contrariées d’une jeune fille avec un vampire. Elle a même
La « bit lit », n’est-ce pas ?, c’est cette littérature destinée principalement aux adolescentes, qui, dans le sillage plus ou moins commercial de Twilight, raconte les amours contrariées d’une jeune fille avec un vampire. Elle a même  Nous sommes prévenus dès l’abord : ce roman est une « ukronie » et comme tel, fait partie d’une collection dirigée par Alain Grousset. L’Ukronie, qui est une branche féconde de la science-fiction, décrit « un temps imaginaire, une autre Histoire que celle que nous connaissons ».
Nous sommes prévenus dès l’abord : ce roman est une « ukronie » et comme tel, fait partie d’une collection dirigée par Alain Grousset. L’Ukronie, qui est une branche féconde de la science-fiction, décrit « un temps imaginaire, une autre Histoire que celle que nous connaissons ».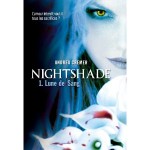
 C’est l’histoire d’une fille de pasteur, sage élève modèle, qui est amoureuse depuis l’enfance d’un apprenti artiste, accessoirement loup-garou à ses heures perdues (on le découvre dès la page 43 alors qu’il y en a plus de 400 !). Bon. On peut dire que ça partait mal ! Mais, contrairement à mes attentes peu enthousiastes, j’ai été prise par cette histoire.
C’est l’histoire d’une fille de pasteur, sage élève modèle, qui est amoureuse depuis l’enfance d’un apprenti artiste, accessoirement loup-garou à ses heures perdues (on le découvre dès la page 43 alors qu’il y en a plus de 400 !). Bon. On peut dire que ça partait mal ! Mais, contrairement à mes attentes peu enthousiastes, j’ai été prise par cette histoire. Ce roman se remarque d’abord par sa couverture, non pas par l’illustration, banale, mais par sa texture : lisse, douce au toucher, veloutée. Du noir tactile…
Ce roman se remarque d’abord par sa couverture, non pas par l’illustration, banale, mais par sa texture : lisse, douce au toucher, veloutée. Du noir tactile…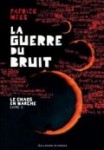
 Voici donc la suite du premier volet. Le suspens reste haletant et revient à la question si souvent posée : comment sauver l’humanité ? La réponse ne peut, bien évidemment, être donnée ici mais disons que la lutte entre l’ombre et la lumière continue, à l’échelle collective aussi bien qu’individuelle : le comportement de Pauline, l’héroïne, en est le signe. On retrouve les allusions à notre propre société, toujours percutantes : la violence augmente de jour en jour, telle une épidémie ; la police est dépassée ; le système d’enseignement est gangrené par la sélection et l’élitisme ; notre Terre est menacée par une catastrophe climatique.
Voici donc la suite du premier volet. Le suspens reste haletant et revient à la question si souvent posée : comment sauver l’humanité ? La réponse ne peut, bien évidemment, être donnée ici mais disons que la lutte entre l’ombre et la lumière continue, à l’échelle collective aussi bien qu’individuelle : le comportement de Pauline, l’héroïne, en est le signe. On retrouve les allusions à notre propre société, toujours percutantes : la violence augmente de jour en jour, telle une épidémie ; la police est dépassée ; le système d’enseignement est gangrené par la sélection et l’élitisme ; notre Terre est menacée par une catastrophe climatique.