La cité : la lumière blanche
Karim Ressouni-Dumigneux
Rue du Monde, 2011
Dans la Cité, vous allez vous rencontrer
par Christine Moulin
« Rien ne vaut la recherche lorsqu’on veut trouver quelque chose », Bilbo le Hobbit, J. R. R. Tolkien, cité p. 221
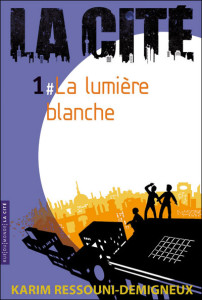 Les romans pour adolescents qui font pénétrer dans l’univers des jeux video sont maintenant légion. Ceux dont le récit repose sur l’immersion dans un jeu grandeur nature aussi : il n’est que de penser au célèbre Hunger games. Le roman de Karim Ressouni-Dumigneux relève de ces deux genres : avec quel talent!
Les romans pour adolescents qui font pénétrer dans l’univers des jeux video sont maintenant légion. Ceux dont le récit repose sur l’immersion dans un jeu grandeur nature aussi : il n’est que de penser au célèbre Hunger games. Le roman de Karim Ressouni-Dumigneux relève de ces deux genres : avec quel talent!
Thomas, le narrateur, vit seul avec son père: sa mère est morte à sa naissance et son père ne s’est jamais vraiment remis de la mort de son épouse. Pour autant, il n’est pas un adolescent triste et solitaire : il a deux amis très proches, Jonathan, son double, en quelque sorte (comme le prouve le choix du même prénom pour leur avatar respectif, « Harry ») et Nadia, un peu « intello », féministe engagée. Il adore la magie, passion qu’il partage avec son oncle Louis, jumeau de sa mère, qui l’emmène voir tout ce qui concerne cet art.
La vie de Thomas va basculer quand pour son anniversaire, son grand-père lui offre une inscription au jeu en ligne la Cité, dont l’un des slogans publicitaires est : « Dans la Cité, vous allez vous rencontrer ». Ce jeu est révolutionnaire : on y est immergé comme dans la vie réelle mais, selon les concepteurs, c’est mieux que Second Life ou World of Warcraft. Autant dire que c’est du lourd! Les règles en sont très strictes : on n’a pas le droit de faire communiquer vie extérieure et vie dans la Cité, sous peine de subir une légère douleur, semblable à celle d’une décharge électrique, celle provoquée par la Lumière Blanche qui donne son nom au premier tome (« De fait, nous entrions dans la Cité en passant par cette lumière blanche, elle nous bloquait et nous heurtait si nous transgressions les règles ») mais qui est aussi le pendant inversé de la lumière noire utilisée dans les tours de magie. Surtout, on ne sait pas quel est le but du jeu si bien que le but du jeu, c’est de trouver le but du jeu (oui, on vous l’avait dit, cela ressemble étrangement à la vie). Cette quête va, bien sûr, se révéler bien plus dangereuse qu’il n’y paraît, même, si pour l’instant, au terme du tome 1, la mort dans la Cité ne paraît pas « déborder » sur la vie réelle. Mais il y a danger et danger, Thomas va l’apprendre à ses dépens: la fin de cette première partie est terrible, apportant à la fois révélations et suspens. C’est que, comme dans les bons romans, dans la Cité, « tout est possible, mais tout a des conséquences ».
Ce qui est fascinant, c’est le jeu de miroirs dans lequel ce roman nous entraîne, rendant plus manifeste le pouvoir de la littérature, sans l’analyser de façon désincarnée ni intellectuelle. Il y a d’ailleurs beaucoup de miroirs dans ce livre : ceux qu’utilise Little King, un magicien que Thomas et son grand-père sont allés voir en Bretagne, mais aussi ceux que l’on trouve dans la Cité et dans lesquels Thomas et son ami Arthur peuvent découvrir les agissements passés de leurs amis, à l’instar de Frodon découvrant, dans le Seigneur des anneaux, le passé de Galadriel. Ce sont les miroirs qui sont le thème de la thèse de la mère de Thomas: « Les jeux de miroir dans A la recherche du temps perdu ».
On ne compte plus les mises en abyme: les évènements, dans la Cité, sont souvent modelés par d’autres univers de fiction, concrétisant ainsi ce que d’aucuns ont appelé l’intertextualité. Ainsi, si Harry-Thomas rencontre Arthur et Lisa, c’est grâce à une passion commune pour Tolkien. Harry et Lisa peuvent se métamorphoser, ou plus exactement, rajeunir ou vieillir à volonté : ces changements se font par l’intermédiaire de poèmes écrits au passé (Verlaine), au présent (Nerval) ou au futur (Victor Hugo).
Mais il faudrait aussi citer les commentaires que les joueurs écrivent sur la Toile dans la vie réelle: ils servent à faire monter le suspens mais rappellent aussi ceux que nous produisons sur nos lectures (à commencer par cette présente chronique!!). Il faudrait citer les allusions à de nombreux films (Psychose, Edward aux mains d’argent, Batman, Black Swan), sans oublier ces ordinateurs qui enregistrent la mémoire de la Cité et qu’une bande de joueurs malfaisants a détruits: à jamais ? Que deviendra, dans ce cas, la « recherche du temps perdu »? Nombreux, en effet, sont les jeux sur le temps car pendant que les joueurs vivent dans la vie réelle, ils sont exposés et continuent à agir dans la Cité.
Enfin, last but not least, si vous tapez l’adresse indiquée dans le roman comme étant celle du module « La Cité » (« search the lost time » !) eh bien, … essayez !
Bref, Karim Ressouni-Dumigneux a utilisé tous les poncifs du genre (la confusion vie réelle/vie jouée, les avatars, les métamorphoses, les superpouvoirs, etc.) pour leur donner une portée symbolique nouvelle, sans pour autant leur faire perdre leur pouvoir narratif. Le roman est haletant mais on se rend compte aussi qu’il faudrait le relire pour savoir vers quelle découverte nous mènent ses savants méandres. D’ailleurs, Lisa ne nous a-t-elle pas montré le chemin quand elle dit de Bilbo le Hobbit : « Je le connaissais déjà, mais, oui, du coup, je le relis, je me dis que cela doit signifier quelque chose » ou Thomas, quand il essaye de reconstituer un puzzle d’un tableau peint à la manière de Matisse? Tout se fait écho (on aurait pu parler du thème de la gémellité, autre piste intéressante à suivre, du jeu sur les prénoms car Thomas s’appelle Tom, Harry mais aussi Mandrake ou Man, du rôle de la lettre « H », etc.), rien ne semble gratuit: un épisode apparemment tout simple en appelle un autre, nous entraînant dans un passionnant labyrinthe (celui-là même dans lequel un des joueurs est enfermé) et dans une recherche de sens longtemps renouvelée (la Boucle Infinie de la dernière scène…). Cela s’appelle la Littérature, je crois.
La page Facebook du livre : http://www.facebook.com/pages/LA-CIT%C3%89-le-livre/291350254226162
 « Bonne journée qui commença mélancoliquement
« Bonne journée qui commença mélancoliquement
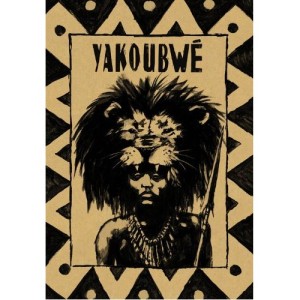

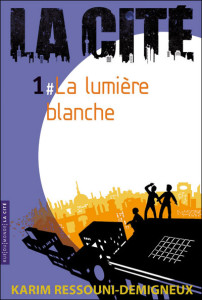
 « Mais pour avoir toujours la même pensée il faudrait pas que je pense parce ce que je pense me fait toujours changer de pensée », « Ma mère a pleuré plus que d’habitude. Ça cumulait plus que d’habitude. Son travail, mon père, mon œil, mon cuir plus chevelu, le miroir de star, Noël, il y a pas assez de virgules, et juste après je partais de là-bas pour venir ici à Maïsville respirer le bon air de sous le cul des poules ». C’est par là qu’il faut commencer : le roman de Corinne Lovera Vitali (qui depuis, a écrit Kid), c’est d’abord une écriture, truculente, touchante, proche du flux intérieur, mais en même temps précise, percutante. Si on osait les comparaisons excessives, ce serait presque du Céline. Déjà, dans C’est Giorgio (Editions du Rouergue, 2008, prix Rhône-Alpes jeunesse), l’auteur bouleversait la syntaxe pour des effets de grande émotion : « Pourtant j’aime trop quand quelqu’un m’accompagne. Mais quelqu’un est souvent occupé et quelqu’un d’autre n’est pas là. Ou alors c’est mon chien qui a fini d’être là et il n’y a pas d’autre mon chien ».
« Mais pour avoir toujours la même pensée il faudrait pas que je pense parce ce que je pense me fait toujours changer de pensée », « Ma mère a pleuré plus que d’habitude. Ça cumulait plus que d’habitude. Son travail, mon père, mon œil, mon cuir plus chevelu, le miroir de star, Noël, il y a pas assez de virgules, et juste après je partais de là-bas pour venir ici à Maïsville respirer le bon air de sous le cul des poules ». C’est par là qu’il faut commencer : le roman de Corinne Lovera Vitali (qui depuis, a écrit Kid), c’est d’abord une écriture, truculente, touchante, proche du flux intérieur, mais en même temps précise, percutante. Si on osait les comparaisons excessives, ce serait presque du Céline. Déjà, dans C’est Giorgio (Editions du Rouergue, 2008, prix Rhône-Alpes jeunesse), l’auteur bouleversait la syntaxe pour des effets de grande émotion : « Pourtant j’aime trop quand quelqu’un m’accompagne. Mais quelqu’un est souvent occupé et quelqu’un d’autre n’est pas là. Ou alors c’est mon chien qui a fini d’être là et il n’y a pas d’autre mon chien ». « Le carillon des anges » : l’évocation de ce jouet que la famille du narrateur, Pierre, ressort à chaque Noël, encadre le récit et fait mesurer ce qui s’y est joué.
« Le carillon des anges » : l’évocation de ce jouet que la famille du narrateur, Pierre, ressort à chaque Noël, encadre le récit et fait mesurer ce qui s’y est joué.
 Voici donc la suite du premier volet. Le suspens reste haletant et revient à la question si souvent posée : comment sauver l’humanité ? La réponse ne peut, bien évidemment, être donnée ici mais disons que la lutte entre l’ombre et la lumière continue, à l’échelle collective aussi bien qu’individuelle : le comportement de Pauline, l’héroïne, en est le signe. On retrouve les allusions à notre propre société, toujours percutantes : la violence augmente de jour en jour, telle une épidémie ; la police est dépassée ; le système d’enseignement est gangrené par la sélection et l’élitisme ; notre Terre est menacée par une catastrophe climatique.
Voici donc la suite du premier volet. Le suspens reste haletant et revient à la question si souvent posée : comment sauver l’humanité ? La réponse ne peut, bien évidemment, être donnée ici mais disons que la lutte entre l’ombre et la lumière continue, à l’échelle collective aussi bien qu’individuelle : le comportement de Pauline, l’héroïne, en est le signe. On retrouve les allusions à notre propre société, toujours percutantes : la violence augmente de jour en jour, telle une épidémie ; la police est dépassée ; le système d’enseignement est gangrené par la sélection et l’élitisme ; notre Terre est menacée par une catastrophe climatique. Chef d’œuvre : il fallait oser, dans un livre pour enfants, parler du mal de vivre, de la mélancolie, superbement figurée par un poisson monstrueux. Mélancolie qui s’attaque à une petite fille, fragile comme un émouvant croquis, comme une ébauche, malgré ses flamboyants cheveux roux. Cela aurait pu être didactique, pesant, ou gênant. C’est tout simplement magnifique. La puissance symbolique des illustrations ne s’épuise pas en une seule lecture. Comme chez Anthony Browne, et le compliment n’est pas mince, on découvre toujours quelque chose de nouveau : un cadenas, un requin, un robinet, et on s’interroge car rien, on le sent, n’est gratuit ni aléatoire.
Chef d’œuvre : il fallait oser, dans un livre pour enfants, parler du mal de vivre, de la mélancolie, superbement figurée par un poisson monstrueux. Mélancolie qui s’attaque à une petite fille, fragile comme un émouvant croquis, comme une ébauche, malgré ses flamboyants cheveux roux. Cela aurait pu être didactique, pesant, ou gênant. C’est tout simplement magnifique. La puissance symbolique des illustrations ne s’épuise pas en une seule lecture. Comme chez Anthony Browne, et le compliment n’est pas mince, on découvre toujours quelque chose de nouveau : un cadenas, un requin, un robinet, et on s’interroge car rien, on le sent, n’est gratuit ni aléatoire.