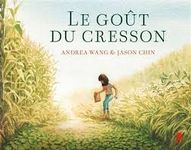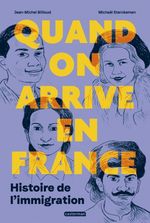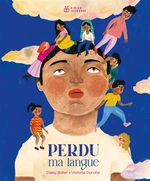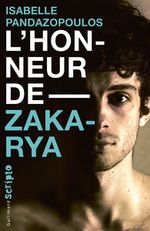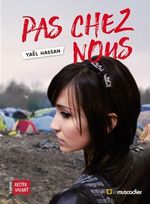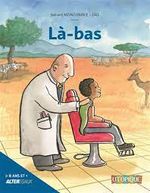Déplacements
Elisa Sartori
Cotcotcot 2025
Solitude de l’exilée…
Par Michel Driol
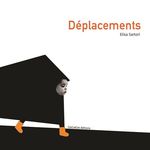 Un récit encadrant qui pose la fin d’un repas de famille, un dimanche, au cours duquel la mère raconte ses premiers pas dans ce pays, après avoir dû quitter le sien, trop chaud, après avoir traversé la mer. Puis ce récit, récit à la troisième personne, récit qui mêle solitude, inconnu, souvenirs de la famille restée au pays, quête d’une nouvelle identité jusqu’à la rencontre finale avec une nouvelle amie, mais qui s’arrête avant la fondation d’une nouvelle famille.
Un récit encadrant qui pose la fin d’un repas de famille, un dimanche, au cours duquel la mère raconte ses premiers pas dans ce pays, après avoir dû quitter le sien, trop chaud, après avoir traversé la mer. Puis ce récit, récit à la troisième personne, récit qui mêle solitude, inconnu, souvenirs de la famille restée au pays, quête d’une nouvelle identité jusqu’à la rencontre finale avec une nouvelle amie, mais qui s’arrête avant la fondation d’une nouvelle famille.
C’est d’abord un récit tout en sobriété, un récit qui se veut neutre, évoquant tantôt les habitudes, celle du café noir le matin avec les chaises comme seule compagnie, tantôt des épisodes, comme cet album photo trouvé dans un marché aux puces. Récit à la troisième personne, donc, façon d’objectiver les notations, mais en fait autant mise à distance de l’émotion que procédé permettant de mieux la faire ressentir. C’est aussi une façon de mettre en évidence le regard et les interrogations de l’étrangère qui cherche à décrypter le monde dans lequel elle se trouve, en particulier au travers de l’emploi régulier du verbe semble, invitant à questionner le monde, les êtres, les objets au-delà de leur apparence.
Ce sentiment d’étrangéisation est renforcé par les illustrations qui donnent à voir des personnages, de choses inquiétantes et sombres. Et ce, dès la couverture, une bouille d’enfant émergeant d’une forme géométrique, difforme, noire, au-dessus de deux bottes d’un orange bien terne. On serait au théâtre, on serait chez Tadeusz Kantor. On va retrouver tout au long de l’album cette représentation des passants, photographie des visages en noir et blanc, visages sans sourires, silhouettes géométriques gommant toute humanité. Toutefois, au fil de l’album, les visages deviennent corps photographiés, de loin, silhouettes minuscules. Autant de façons de montrer plastiquement cette mise à distance, cette coupure entre ceux d’ici et celle d’ailleurs. Les photographies montrent peu à peu le décor, un décor urbain, de maisons collées les unes aux autres, comme dans les villes ouvrières anglaises, d’où émergent parfois des grands immeubles. Toujours du noir et blanc, parfois marqué de cet orange terne, photos pixellisées comme pour dire le flou de la perception. Troisième axe de l’illustration, les représentations de l’intérieur du logement de la mère, illustrations à la géométrie marquée qui montrent le vide et la solitude au début, une installation plus confortable à la fin, avec les fauteuils, le chat, l’appareil photo polaroid et la plante en fleurs. Enfin, dernier axe de l’illustration, les objets du marché aux puces, objets abandonnées, tout comme la mère, échoués là par hasard, avec pourtant une histoire propre digne d’être racontée, reconstituée, ou inventée Objets mis en réserve, en blanc sur fond orange, représentations des photos de personnages retraçant des épisodes de vie, mais visages sans traits, inexpressifs, anonymes. Autant de procédés pour dire le manque et l’absence.
Il y a là un vrai travail et une vraie réflexion sur l’illustration, et sur le rapport texte image qui, à eux deux, disent la solitude, la nostalgie, la tentative de s’intégrer et ses difficultés. Difficulté d’entrer en contact avec les autres, parlant une langue inconnue, quête de sens à travers des objets abandonnés, exposés et exposant une intimité dans un marché aux puces. Cette approche esthétique rend parfaitement sensible la difficulté de l’exil et de l’adaptation à un monde nouveau, aux êtres étranges et inquiétants, au paysage urbain uniforme et labyrinthique, envoyant à la solitude au milieu de la foule.
Sur un thème difficile, un album d’une grande originalité formelle, et d’une grande sensibilité. A lire à tout âge.