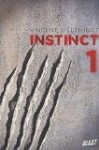Oz
Lyman Frank Baum
Traduction abrégée de Marie Hélène Sabard
L’école des loisirs (classiques abrégés), 2012
Lisons Oz !
Par Anne-Marie Mercier
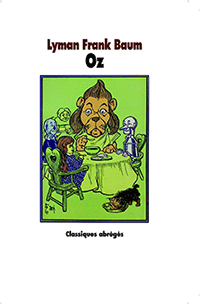 Bien avant la sortie en France du film Le Monde fantastique d’Oz (13 mars 2013), L’école des loisirs a publié une version abrégée des deux premiers volumes de L. F. Baum. Le film laissant de côté les aventures de Dorothée et les charmants personnages de l’épouvantail, de l’homme en fer blanc et du lion peureux pour se focaliser sur les débuts du magicien d’Oz et accumuler les effets spéciaux, il est bon que le jeune public puisse accéder au charme du texte.
Bien avant la sortie en France du film Le Monde fantastique d’Oz (13 mars 2013), L’école des loisirs a publié une version abrégée des deux premiers volumes de L. F. Baum. Le film laissant de côté les aventures de Dorothée et les charmants personnages de l’épouvantail, de l’homme en fer blanc et du lion peureux pour se focaliser sur les débuts du magicien d’Oz et accumuler les effets spéciaux, il est bon que le jeune public puisse accéder au charme du texte.
Il découvrira dans Le Magicien d’Oz (1900) Dorothée, emportée par une tornade avec sa maison et son petit chien Toto, loin du Kansas, sa rencontre avec un homme en fer blanc (sans cœur), un épouvantail (sans cervelle) et un lion (sans courage) qui vont avec elle consulter le magicien. Leur périple à travers les terribles champs de pavot et leur découverte de la cité, leurs luttes contre les sorcières, tout cela forme un monde « merveilleux » et une belle fable morale (ou politique, pour d’autres).
La deuxième partie, Le Merveilleux Pays d’Oz (1904), était bizarrement inconnue du public français. On en est moins étonné après l’avoir lue : son caractère déjanté ne pouvait que heurter les esprits qui n’acceptaient en littérature de jeunesse que des œuvres « sages ». L. F. Baum anime tout et surtout n’importe quoi; il crée des êtres composites et monstrueux, grotesques et angoissants, qui se déplacent avec difficulté et parfois au prix d’acrobaties laborieuses.
L’autre aspect étonnant du texte est son anti-féminisme : l’épouvantail, devenu roi de la cité d’Oz, est chassé du trône par une bande de filles déchainées, armées d’aiguilles à tricoter qui réduisent les hommes en esclavage (c’est-à-dire qu’ils font les tâches ménagères…). La fin de l’histoire présente une métamorphose magique d’un garçon en fille, ce qui a dû sembler encore plus inconvenant aux éditeurs français.
La première partie est présentée avec les illustrations de William Wallace Denslow, collaborateur et ami de Baum, illustrateur de la première édition ; la deuxième avec ceux de John Rea Neill, illustrateur du deuxième volume après la brouille entre les deux amis. Elles sont bien utiles car sans elles, on se demande comment le lecteur pourrait se figurer les étranges créatures qui animent cette histoire et comprendre les mots rares qui désignent leur éléments.
Les éditions du Cherche midi ont commencé une publication illustrée de la série dans son entier (14 vol.) avec les deux premiers volumes parus ce mois ci (7 mars), traduits par Blandine Longre et Anne-Sylvie Homassel. C’est ainsi un monument qui se dévoile pour les lecteurs français, un grand classique de la littérature de jeunesse, une histoire charmante, tantôt loufoque, tantôt sérieuse (et toujours assez conservatrice). C’est aussi la source d’un film culte (de Victor Fleming, 1939 – Judy Garland y chante « over the rainbow » –), film le plus vu au monde, paraît-il, et classé comme œuvre majeure dans le Registre international « Mémoire du monde » de l’Unesco. Du patrimoine, donc, mais ébouriffant.


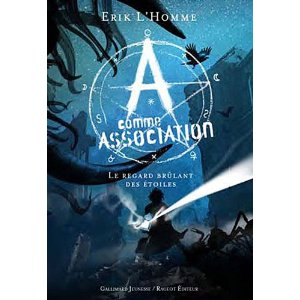
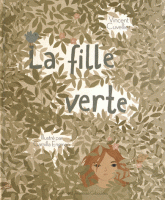
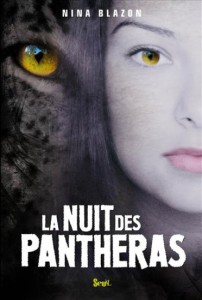
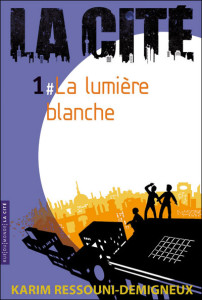
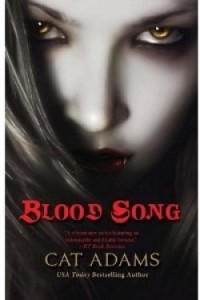
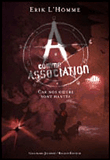
 Il y avait la veine Enfant Océan, réécriture de conte, la veine Harry Potter, mixage de mythes et de « collège novel », Twilight qui faisait se rencontrer « collège novel » et vampires… Victor Dixen arrive à faire mieux encore, en mélangeant tous ces ingrédients dans un roman étonnant, haletant et poétique.
Il y avait la veine Enfant Océan, réécriture de conte, la veine Harry Potter, mixage de mythes et de « collège novel », Twilight qui faisait se rencontrer « collège novel » et vampires… Victor Dixen arrive à faire mieux encore, en mélangeant tous ces ingrédients dans un roman étonnant, haletant et poétique.