Pour grandir, il faut
Catherine Grive, Jean-François Spricigo
Rouergue, 2010, coll. Yapasphoto
Comment présenter un livre tout neuf, qui semble là très au-delà des conditions de son apparition – à l’image des êtres auxquels il s’adresse, et de ceux qu’il montre ?
Par Dominique Perrin
 Pour grandir, il faut est de ces entreprises qui prétendent – et démontrent – que la photographie noir et blanc a une vocation sans égale à rendre compte de la situation de l’humain entre le commun et le particulier, le collectif et l’individuel. Les images s’y insèrent dans une lignée artistique associable au nom de Doisneau. Mais (car il y a sans doute un « mais » concernant cette référence très partagée et sa fraîcheur parfois perdue) leur association avec un texte aussi choisi que laconique donne à l’ensemble un statut comme réinventé de poème et de récit.
Pour grandir, il faut est de ces entreprises qui prétendent – et démontrent – que la photographie noir et blanc a une vocation sans égale à rendre compte de la situation de l’humain entre le commun et le particulier, le collectif et l’individuel. Les images s’y insèrent dans une lignée artistique associable au nom de Doisneau. Mais (car il y a sans doute un « mais » concernant cette référence très partagée et sa fraîcheur parfois perdue) leur association avec un texte aussi choisi que laconique donne à l’ensemble un statut comme réinventé de poème et de récit.
Ce récit met en image, comme l’indique la présentation finale, des « étapes de l’enfance » (perspective un peu solennelle), mais délicieusement improvisées, fugaces, graves et pas sérieuses. Les mots portés ici sous le regard, la langue et les oreilles sont les immenses vocables qui, pour référer à la substance réelle de « tous les jours », sont loin d’être prononcés journellement. « Manger », « se laver », « jouer », « courir » sont certes le quotidien verbal des jeunes lecteurs ; mais « naître », « s’éveiller », « contempler » ? et, en construction absolue, « manger » (être un être mangeant), « rester », « hésiter », « attendre » (être un être en suspens), « aimer » (être un être aimant) ?
La dernière page ouvre sur une photo un peu floue et le verbe : « S’imaginer ».

 Un petit album au format carré pour aborder un sujet très sérieux voire didactique, sur les risques liés aux médicaments pris avec excès. Dès le premier regard, le ton est à l’humour. Monsieur X, un rocker guetté par la calvitie, est prêt à recourir à tous les médicaments pour enrayer la chute de ses cheveux, sous l’œil railleur de son chien qui porte la voix des émotions. Chaque médicament au nom savoureux entraîne des effets secondaires ; le malheureux est pris dans une spirale infernale qui le conduit à aller chez tous les spécialistes sans succès pour revenir à son point de départ, mais en ayant accepté sa nouvelle apparence. Le dessin joue avec la ligne claire : le trait est précis frisant parfois le grotesque, ce qui confère à cet album un ton très BD, renforcé par un rythme enlevé, qu’illustre l’alternance du texte et des belles pages. Un livre moins simple qu’il n’y paraît, qui saura séduire aussi bien les petits que les plus grands.
Un petit album au format carré pour aborder un sujet très sérieux voire didactique, sur les risques liés aux médicaments pris avec excès. Dès le premier regard, le ton est à l’humour. Monsieur X, un rocker guetté par la calvitie, est prêt à recourir à tous les médicaments pour enrayer la chute de ses cheveux, sous l’œil railleur de son chien qui porte la voix des émotions. Chaque médicament au nom savoureux entraîne des effets secondaires ; le malheureux est pris dans une spirale infernale qui le conduit à aller chez tous les spécialistes sans succès pour revenir à son point de départ, mais en ayant accepté sa nouvelle apparence. Le dessin joue avec la ligne claire : le trait est précis frisant parfois le grotesque, ce qui confère à cet album un ton très BD, renforcé par un rythme enlevé, qu’illustre l’alternance du texte et des belles pages. Un livre moins simple qu’il n’y paraît, qui saura séduire aussi bien les petits que les plus grands. Grand album au format plus haut que d’ordinaire, au papier mat et épais, Jim Pop imite l’esthétique des illustrés des années 50 (quadrichromie qui bave un peu, couleurs franches). Ces couleurs imitent aussi celles du cirque : rouge, bleu, jaune, un peu de vert de temps en temps. Les formes schématiques se rapprochent du dessin d’enfant.
Grand album au format plus haut que d’ordinaire, au papier mat et épais, Jim Pop imite l’esthétique des illustrés des années 50 (quadrichromie qui bave un peu, couleurs franches). Ces couleurs imitent aussi celles du cirque : rouge, bleu, jaune, un peu de vert de temps en temps. Les formes schématiques se rapprochent du dessin d’enfant. Valentine est une petit fille sage, très sage, trop sage. Au fur et à mesure d’un texte énigmatique qui présente une héroïne très timide qui aurait envie mais attend que le monde vienne la chercher, on sent croître le malaise jusqu’à la fameuse nuit qui donne son titre à l’album. Une nuit où tout devient possible pour Valentine, sa nuit !
Valentine est une petit fille sage, très sage, trop sage. Au fur et à mesure d’un texte énigmatique qui présente une héroïne très timide qui aurait envie mais attend que le monde vienne la chercher, on sent croître le malaise jusqu’à la fameuse nuit qui donne son titre à l’album. Une nuit où tout devient possible pour Valentine, sa nuit ! Elzebia mêle dans cet album plusieurs des thèmes qu’elle a explorés précédemment. Celui de l’enfance malheureuse est illustré à travers l’histoire de Tittine qui a eu la malchance de naître chez une « maman à une place » où la place était déjà prise par sa soeur aînée. Celui de la pauvreté : celle de cette « maman à une place » n’arrange pas les choses. Orphelinat, prison, sombre château où l’on martyrise les enfants,… le monde est un lieu cruel pour les petits. Heureusement, il reste le rêve, incarné par le monde du cirque et par un sympathique fantôme.
Elzebia mêle dans cet album plusieurs des thèmes qu’elle a explorés précédemment. Celui de l’enfance malheureuse est illustré à travers l’histoire de Tittine qui a eu la malchance de naître chez une « maman à une place » où la place était déjà prise par sa soeur aînée. Celui de la pauvreté : celle de cette « maman à une place » n’arrange pas les choses. Orphelinat, prison, sombre château où l’on martyrise les enfants,… le monde est un lieu cruel pour les petits. Heureusement, il reste le rêve, incarné par le monde du cirque et par un sympathique fantôme. Élise Fontenaille, qui a publié de nombreux romans, s’essaye ici à l’album avec un hommage à un homme simple, à l’aise avec les plantes, les animaux et les enfants, moins à l’aise avec l’écrit et avec la langue française : comme le titre l’indique, il la transforme joliment. On découvre peu à peu son histoire d’enfant pauvre et de réfugié, on entend ses mots adressés à l’enfant à qui il transmet ses connaissances et sa sagesse.
Élise Fontenaille, qui a publié de nombreux romans, s’essaye ici à l’album avec un hommage à un homme simple, à l’aise avec les plantes, les animaux et les enfants, moins à l’aise avec l’écrit et avec la langue française : comme le titre l’indique, il la transforme joliment. On découvre peu à peu son histoire d’enfant pauvre et de réfugié, on entend ses mots adressés à l’enfant à qui il transmet ses connaissances et sa sagesse.
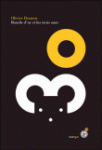
 Un joli petit livre au format carré, aux illustrations tout en douceur, dont le titre joue sur les mots « lapin » et « la peins ». Il s’agit en effet de peinture. Un petit lapin blanc s’adresse directement à son lecteur, en commentant ce qu’il est en train de créer au moyen de couleurs variées. La surprise naît du fait que peu à peu les formes approximatives ainsi créées – pré, nuages, soleil, fleurs… – viennent peu à peu orner le corps du lapin, qui se complète, et ce de jour comme de nuit. Ces transformations au caractère quelque peu magique sont soulignées par un texte minimaliste qui parfois rime, ajoutant ici et là une touche de poésie. Une incitation à la création en toute simplicité.
Un joli petit livre au format carré, aux illustrations tout en douceur, dont le titre joue sur les mots « lapin » et « la peins ». Il s’agit en effet de peinture. Un petit lapin blanc s’adresse directement à son lecteur, en commentant ce qu’il est en train de créer au moyen de couleurs variées. La surprise naît du fait que peu à peu les formes approximatives ainsi créées – pré, nuages, soleil, fleurs… – viennent peu à peu orner le corps du lapin, qui se complète, et ce de jour comme de nuit. Ces transformations au caractère quelque peu magique sont soulignées par un texte minimaliste qui parfois rime, ajoutant ici et là une touche de poésie. Une incitation à la création en toute simplicité. Du riche parcours d’Elzbieta dans les possibles de l’album contemporain, le Rouergue réédite l’une des réalisations fondatrices. L’album trouve sa puissance narrative et poétique dans le modèle plastique de la portée musicale et de ses groupes de notes, qui révèle ici l’étendue dynamique de ses possibilités. Le troun et l’oiseau musique (première édition Duculot, 1984) s’offre comme une partition à la fois très libre et rigoureuse, composée par Sharon Kanach, qui raconte comment les « trouns » – comprenons les petits humains – conquièrent progressivement, passionnément, et dans tous les sens… l’espace sonore.
Du riche parcours d’Elzbieta dans les possibles de l’album contemporain, le Rouergue réédite l’une des réalisations fondatrices. L’album trouve sa puissance narrative et poétique dans le modèle plastique de la portée musicale et de ses groupes de notes, qui révèle ici l’étendue dynamique de ses possibilités. Le troun et l’oiseau musique (première édition Duculot, 1984) s’offre comme une partition à la fois très libre et rigoureuse, composée par Sharon Kanach, qui raconte comment les « trouns » – comprenons les petits humains – conquièrent progressivement, passionnément, et dans tous les sens… l’espace sonore.