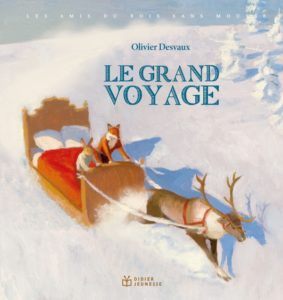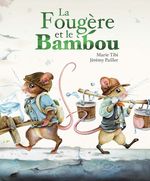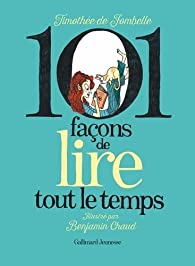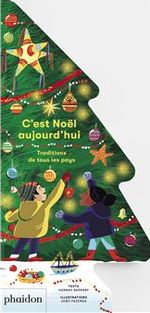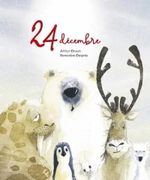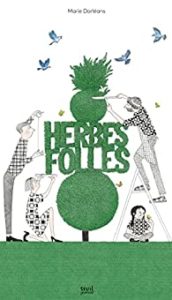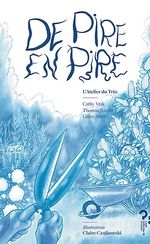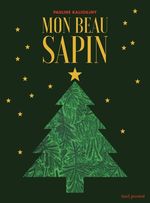Il ne faut pas mettre les enfants au congélateur
Michaël Escoffier – France Cormier
D’eux 2021
Petit manuel de cuisine pour les ogres
Par Michel Driol
C’est le chef Bronislav Haddendur qui accueille les lecteurs dans cet album. Depuis 50 générations, sa famille régale les ogres : n’est-il pas le mieux qualifié pour livrer ses recettes ? L’ouvrage commence par présenter les enfants, dire leurs dangers, préciser la différence entre enfants sauvages et enfants d’élevage, et donner les conseils pour la capture de seconds, bien plus gouteux ! Vient ensuite le chapitre consacré à la conservation des enfants. Et enfin trois recettes savoureuses : le rôti d’enfant, l’enfant brioché, le sandwich à l’enfant. Bon appétit !
Conçu sur le modèle des livres de recettes traditionnels, cet album est drôle et réjouissant à plus d’un titre. D’abord parce qu’il parodie les encyclopédies ou les émissions culinaires qui donnent des conseils avisés, tant sur le choix des produits que sur leur utilisation. Cela sera peut-être plus perçu par les adultes lecteurs que par les enfants. Ensuite parce qu’il présente une vision de l’enfance pleine de saveur : la moquerie toujours présente, les dents gâtées par les bonbons trop fréquents, les microbes qu’ils apportent avec eux, leur gout pour les frites ou les pizzas, leur aptitude à se chamailler ou encore leur manque d’hygiène… Chacun s’y reconnaitra, et mettre ces traits dans la bouche d’un ogre ne manque pas de piquant et introduit une distance entre le texte et la réalité qui permet de mieux la percevoir. Enfin par les recettes. Passons d’abord sur leur côté rabelaisien dans l’exagération des proportions. 10 kg de farine ou 3 kg d’oignons, pas moins ! Evoquons ensuite la précision du lexique culinaire utilisé : on a affaire à un spécialiste ! Certes, mais n’est pas trop transgressif de proposer ainsi des recettes dans lesquelles des enfants vont se faire rôtir, griller ? C’est là qu’il faut évoquer le rapport texte image, et observer finement comment, à chaque recette, l’image montre que l’enfant est plus malin pour glisser qui un nounours, qui une chaussure, qui un grille-pain à sa place dans le plat, alors que l’ogre n’y voit que du feu. Autre qualité attribuée aux enfants : la débrouillardise qui culmine avec la fuite de toute la troupe d’enfants, dans le dos de l’ogre. Comme une revanche de David sur Goliath ! Les illustrations, colorées, vivantes, expressives, sont pleines de détails à examiner avec attention.
Ce petit manuel de cuisine pour les ogres, album grand format, est un vrai portrait des enfants d’aujourd’hui, avec leurs qualités comme la débrouillardise, avec leurs défauts comme la gourmandise, avec leurs penchants à l’irrespect. Il est surtout d’une drôlerie irrésistible !