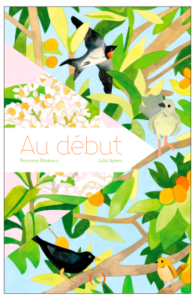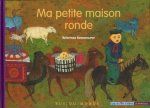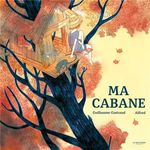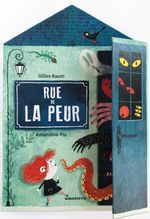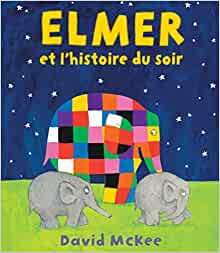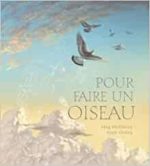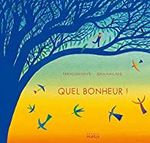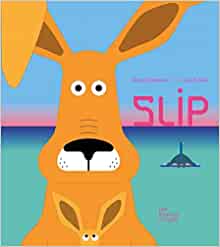Papa partout
Emilie Chazerand illustrations de Sébastien Pelon
L’élan vert 2022
L’absence, la voilà…
Par Michel Driol
 Dès le début, la mort du père est là, à peine euphémisée : Maman dit qu’il est au ciel désormais, puis énoncée directement, en une phrase non verbale qui sonne comme un couperet : Mort. Au début, pour le narrateur, il n’y a que le vide et le chagrin, le souvenir des choses qu’ils ne feront plus. Puis c’est la découverte de la présence du père dans tous les objets, vêtements, même ces objets intangibles que sont l’ombre sur la plage et le reflet des yeux dans le miroir.
Dès le début, la mort du père est là, à peine euphémisée : Maman dit qu’il est au ciel désormais, puis énoncée directement, en une phrase non verbale qui sonne comme un couperet : Mort. Au début, pour le narrateur, il n’y a que le vide et le chagrin, le souvenir des choses qu’ils ne feront plus. Puis c’est la découverte de la présence du père dans tous les objets, vêtements, même ces objets intangibles que sont l’ombre sur la plage et le reflet des yeux dans le miroir.
Voilà un bel album bouleversant, plein de simplicité, pour dire différentes phases du deuil vues à hauteur d’enfant, de la colère et du sentiment de l’injustice profonde jusqu’au retour du sourire et de la paix intérieure, ce que l’on nomme résilience. L’album sait éviter l’écueil du pathos par une écriture qui sait être à la fois métaphorique et enfantine pour exprimer ce que traverse l’enfant. Il est question de l’oreiller salé au réveil et du cœur haché menu, par exemple. Les anaphores disent la répétition des marques de l’absence, mais surtout celles des signes de présence avec la série des groupes nominaux qui commencent par « Dans… », façon de rendre concrète l’universalité de cette présence mystérieuse de l’absent. L’illustrateur a su jouer aussi de la simplicité et de l’expressivité, semblant prendre au pied de la lettre certaines expressions comme « il est au ciel », ou donnant à voir une vision du jeu de Puissance 4 comme une sorte de prison derrière laquelle est caché l’enfant, dont seul l’œil cherche à voir au delà du jeu. Quant aux aplats de couleurs, ils se réchauffent progressivement, allant jusqu’au jaune éclatant de la plage et de la maison finale. A noter que les pages de garde reprennent aussi ce code de couleurs.
Un bel album, mélange de tendresse, de fragilité et de force, pour évoquer les étapes du deuil lié au décès le plus éprouvant qui puisse affecter un enfant.