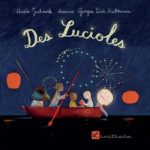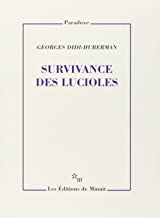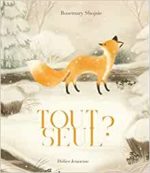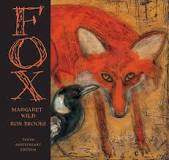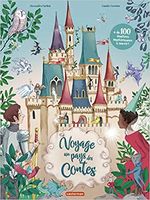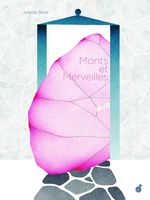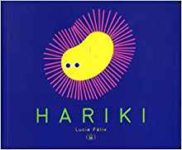L’Arrivée des capybaras
Alfredo Soderguit
Traduit (espagnol, Uruguay) par Michèle Moreau
Didier Jeunesse, 2020
« La volaille qui fait l’opinion »
Par Matthieu Freyheit
 La littérature de jeunesse a beaucoup glosé sur ses fonctions et sur les valeurs qu’il fallait accorder à l’une d’entre elles, l’édification. Avec le déclin de la valeur-autorité, l’édification a fait l’objet d’une suspicion qui ne s’est pas encore tarie, loin s’en faut. Reste que nous sommes à géométrie variable : oui à l’édification, donc, lorsque celle-ci accompagne des sujets suffisamment consensuels pour ne pas être remis en question. Idéologie ?
La littérature de jeunesse a beaucoup glosé sur ses fonctions et sur les valeurs qu’il fallait accorder à l’une d’entre elles, l’édification. Avec le déclin de la valeur-autorité, l’édification a fait l’objet d’une suspicion qui ne s’est pas encore tarie, loin s’en faut. Reste que nous sommes à géométrie variable : oui à l’édification, donc, lorsque celle-ci accompagne des sujets suffisamment consensuels pour ne pas être remis en question. Idéologie ?
L’affaire est ici délicate, car L’Arrivée des capybaras rappelle un contexte tendu par le retour de la problématique des frontières. Une famille de gros rongeurs inconnus de tous fait rupture dans le panorama quotidien d’un poulailler. La fable reprend les thèmes éculés du rejet de l’inconnu, de la résistance devant l’acceptation de l’altérité et du refus de partager son espace autant que ses profits. Partager ? Non. Discuter ? Non. Se mélanger ? Non. Jusqu’au jour où, bien sûr, ces autres peu rancuniers qu’incarnent les capybaras n’hésitent pas à secourir l’un de ceux qui les avaient pourtant rejetés. L’ensemble est tendre et graphiquement fort bien mené, l’auteur réalisant à partir d’une gamme chromatique restreinte une vraie spatialisation de la problématique (les vis-à-vis, en particulier, y sont très beaux).
Réussi, donc, mais peu original dans le propos. La nuance y manque et la situation initiale schématise la vie des habitants du poulailler, dont l’attitude s’en trouve d’autant moins acceptable : « La vie n’était pas compliquée. Chacun faisait ce qu’il avait à faire. Il y avait à manger pour tout le monde. Et jamais rien à signaler. » On pourrait reprocher à l’album cette présentation caricaturale des sociétés d’abondance, souvent désignées comme incompétentes à l’accueil. Toutefois, les réponses que s’offrent le texte l’image permettent d’échapper en partie à la simplification. Ainsi le « jamais rien à signaler » est-il démenti par l’image d’une poule emportée par le fermier, juste avant l’arrivée des fameux capybaras : une façon de dire que l’événement n’est pas toujours où l’on croit, et que ce qui est rendu invisible par l’habitude trouve un dérivatif bien utile dans l’arrivée de l’inhabituel, aisément présenté comme faisant événement.
Un album esthétiquement très réussi, qui peut interroger par ailleurs sur ce que la littérature de jeunesse aime à penser et sur ce que nous aimons lui voir penser.