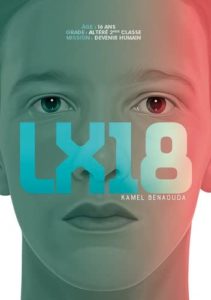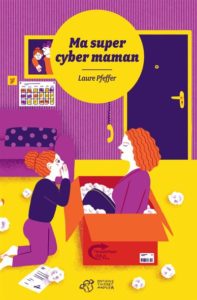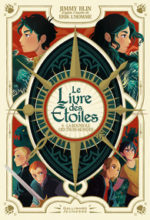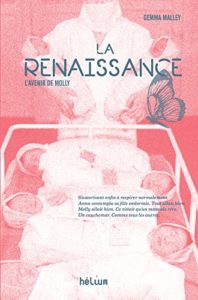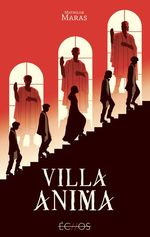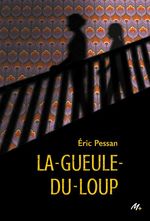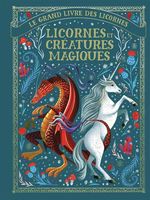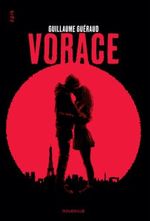Les Poupées savantes
Arthur Ténor
Le Muscadier 2022
Alter poupée…
Par Michel Driol
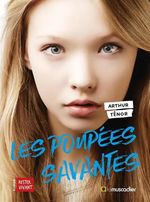 Dans un futur proche Lilibellule reçoit pour son anniversaire une poupée savante, réplique exacte de son visage, qui doit l’aider dans son travail scolaire. Surviennent deux événements. Lilibellule est renversée par une voiture, et la poupée est enlevée par un gang de trafiquants de poupées et robots. Comment la récupérer ?
Dans un futur proche Lilibellule reçoit pour son anniversaire une poupée savante, réplique exacte de son visage, qui doit l’aider dans son travail scolaire. Surviennent deux événements. Lilibellule est renversée par une voiture, et la poupée est enlevée par un gang de trafiquants de poupées et robots. Comment la récupérer ?
Dans ce roman de science-fiction, Arthur Ténor propose une société dans laquelle s’affrontent les cyberprogressistes, partisans de développer au maximum toutes les formes d’intelligence artificielle, et les humaniloves, qui pensent qu’il faut rejeter l’usage des humanoïdes dans la vie quotidienne. Ces deux causes sont incarnées par Lillibellule, dont les parents gèrent une start-up consacrée au développement de robots et Cléon, qui semble épouser la cause humanilove. C’est à une réflexion sur le thème de l’intelligence artificielle que conduit ce roman. Représente-elle un danger pour l’humanité, en termes de perte de contrôle sur sa destinée, voire sur sa nature même ? Les scènes finales confrontent les héros à eux-mêmes, aux envies de pouvoir absolu, à l’usage d’armes à distance, façon de se sentir tout puissant, mais aussi responsable. La vie et la mort ne sont pas des jeux vidéo, et le sens de la mesure, de la raison doivent l’emporter face à toutes les tentations.
Un roman de science-fiction qui pose des questions bien actuelles, aborde la question de ce qui fait notre humanité, celle de notre dépendance aux différentes formes d’intelligence artificielle, et touche aussi certains points sensibles pour les ados comme leur relation aux réseaux sociaux et aux fake-news.