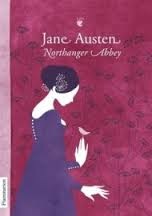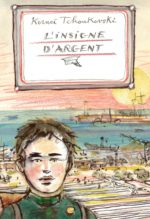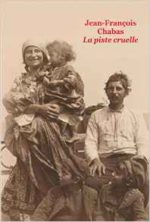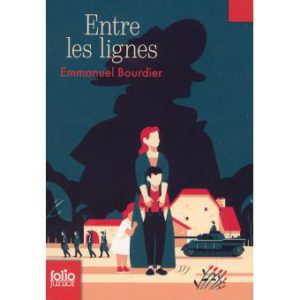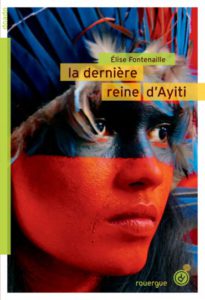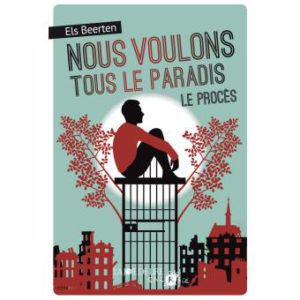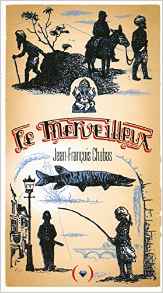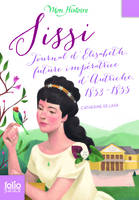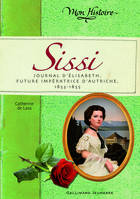Chante, Luna
Paule du Bouchet
Gallimard Jeunesse 2016 (1ère édition 2004)
Varsovie, quand même
Par Michel Driol
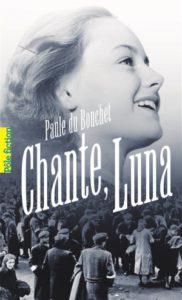 Luna a 14 ans lorsque les Allemands enferment les Juifs de Varsovie dans le ghetto. Peur, faim, persécutions, rafles, misère rythment les jours, marqués par les décès ou les disparitions des êtres chers, emportés par le typhus ou par des wagons. Luna participe à la résistance, au soulèvement du ghetto, animée par sa jeunesse, et sa voix, hors du commun. « Une héroïne qui chante pour rester en vie », précise l’auteure. Survivante du ghetto, Luna s’exile aux Etats Unis, où elle rédige ce récit.
Luna a 14 ans lorsque les Allemands enferment les Juifs de Varsovie dans le ghetto. Peur, faim, persécutions, rafles, misère rythment les jours, marqués par les décès ou les disparitions des êtres chers, emportés par le typhus ou par des wagons. Luna participe à la résistance, au soulèvement du ghetto, animée par sa jeunesse, et sa voix, hors du commun. « Une héroïne qui chante pour rester en vie », précise l’auteure. Survivante du ghetto, Luna s’exile aux Etats Unis, où elle rédige ce récit.
Sur cette période monstrueuse de l’histoire du XXème siècle, Paule du Bouchet parvient à réaliser un récit historique à la fois réaliste et romanesque. D’abord au travers des personnages, ceux de la famille de Luna, à la fois inscrits dans une tradition juive (la mère est fille de rabbin, plutôt traditionnelle) et le père, intellectuel européen, imprimeur, ouvert au monde, la grand-mère, polonaise catholique convertie au judaïsme par amour, tous sont dessinés avec justesse par la narratrice, qui, au fil du temps, grandit, murit. Réalisme aussi des scènes, qui pourront peut-être heurter les plus jeunes, montrant la barbarie nazie et les conditions de vie au sein du ghetto, les rafles, la faim, la mort omniprésente. Ce qu’évoque aussi l’adolescente qu’est Luna, c’est la vie politique telle qu’elle la perçoit, avec son père, membre sans illusion du Judenrat, cette administration juive du ghetto sans réel pouvoir, et la complexité des relations avec la résistance polonaise, divisée sur la question juive. Romanesque aussi, car Luna est remarquée par un soldat allemand – musicien anti nazi – pour sa voix, et ce dernier va, à plusieurs reprises, lui permettre d’échapper à la mort, à la déportation. C’est cette dimension-là qui séduit dans ce roman : la volonté de dépasser les clivages, de monter comment, au-delà des religions, des nationalités, des liens forts peuvent se tisser, dans une perspective humaniste, pour dessiner un après. C’est aussi, en filigrane, le rappel qu’il existait une opposition allemande au nazisme.
Le roman sait jouer du pathétique pour permettre au lecteur d’éprouver les sentiments de Luna, des autres personnages, mais enseigne aussi une leçon de vie, de courage, d’engagement au service de la liberté individuelle. Enfin, ce n’est pas pour rien que le dernier chapitre montre l’écriture de Luna comme un récit destinée à sa fille, pour lui permettre de combler les vides de la famille, de faire connaissance avec ses grands-parents au sens propre disparus, dans une volonté de transmission d’une expérience et d’un amour plus fort que les forces de la mort.