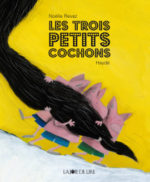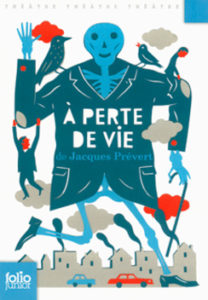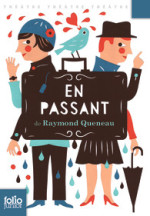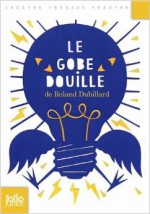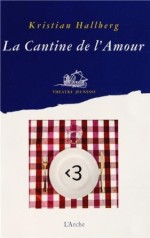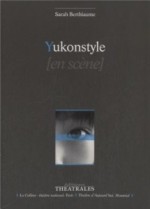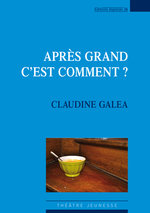Simon la Gadouille
Rob Evans
Traduit de l’anglais par Séverine Magois
L’Arche, 2012
Par Clara Adrados
 Dans cette pièce de théâtre on suit l’histoire de Martin, histoire somme toute banale : celle d’un enfant, le nouveau de sa classe, un peu perdu, un peu seul, qui va se lier d’amitié avec l’autre nouveau de la classe, Simon.
Dans cette pièce de théâtre on suit l’histoire de Martin, histoire somme toute banale : celle d’un enfant, le nouveau de sa classe, un peu perdu, un peu seul, qui va se lier d’amitié avec l’autre nouveau de la classe, Simon.
L’histoire se passe dans une école primaire, les enfants se cherchent, se chamaillent… Martin est la risée de ses camarades qui s’empressent de se moquer dès qu’une légère différence pointe son nez chez l’un de leurs camarades. Pour Martin, c’est le fait de venir de Birmingham et peut-être d’être un peu timide, en manque d’attention. Simon le sauve et lui permet de rêver, de rire, de s’inventer une vie qui lui correspond, où les moqueries glissent sur lui. Jusqu’au jour où Simon tombe dans la boue et se ridiculise devant tout le monde. Martin ne réagit pas, ne va pas vers son ami pour l’aider. Et c’est le surnom de « Simon la Gadouille » qui poursuit le pauvre garçon où qu’il aille. Les enfants répètent en chœur ce surnom. Le lecteur ressent alors l’oppression à laquelle la victime doit faire face. La narration constituée de très peu de dialogue contribue à rendre ce sentiment d’envahissement, d’étouffement subi par Simon. Peu de mots sont dits, peu de dialogues mais des chuchotements incessants qui constituent une rengaine malveillante dans sa vie. Martin est déchiré entre la culpabilité de renier son ami, et l’envie de faire partie du groupe des « populaires », de ceux à qui on ne donne pas de surnoms dégradants. Il choisira l’entente avec tout le monde plutôt que de garder son ami d’enfance. Les années passent et Martin souhaite revoir son vieil ami. La culpabilité et la peur de le retrouver et de voir qu’il ne lui a toujours pas pardonné hantent ce quarantenaire. Les deux hommes se donnent rendez-vous pour se revoir : une façon de retrouver un vieil ami ? Un moment propice aux excuses, au pardon ? Ou un instant pour se redécouvrir, adulte, dégagé de ces schémas de martyr / groupe dominant ?
Le lecteur peut se faire sa propre fin.
Cette pièce aborde avec justesse un sujet précieux pour les enfants scolarisés : le harcèlement à l’école. Martin semble avoir autant souffert que Simon de cette situation, même s’il a intégré le parti des harceleurs à un moment donné. Cela a détruit une part de lui-même pour que trente ans plus tard il ne se le soit toujours pas pardonné. Le personnage de Martin faisant office de narrateur, nous n’avons pas le point de vue de Simon, et cela donne toute sa force au texte. Simon accepte de revoir son vieil ami et on peut imaginer que ce dernier a bien réussi dans la vie, qu’il s’est construit malgré les maux auxquels il a été soumis, peut-être même que sa force vient du fait de ne s’être jamais plié à ses bourreaux. Une pièce qui ne laisse personne sur le côté : bourreau, martyr … Une ligne facile à franchir.