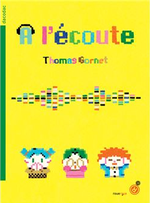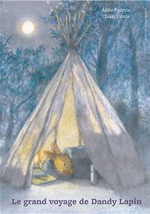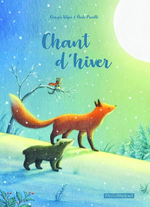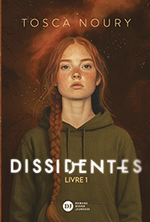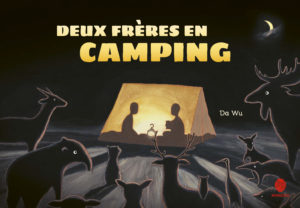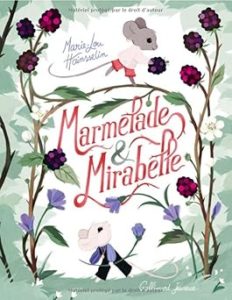Comme un film de Noël
Elle McNicoll
La Martinière 2025
It’s a wonderful life ! (Capra)
Par Michel Driol
 Lake Pristine, petite bourgade située on ne sait où, petite communauté où tout le monde se connait, avec son cinéma, sa représentation de Casse-Noisette, ses boutiques et ses préparatifs de Noël, auxquels, cette année, se mêlent à ceux du mariage de Christine et de Kevin. C’est là que revient Jasper, après 18 mois d’absence passés dans une fac de psycho, bien décidée à partir pour toujours de Lake Pristine. C’est là aussi qu’Arthur tourne un film pour tenter de gagner un prix à un concours. Et pourtant, rien – ou presque – ne va se passer comme prévu !
Lake Pristine, petite bourgade située on ne sait où, petite communauté où tout le monde se connait, avec son cinéma, sa représentation de Casse-Noisette, ses boutiques et ses préparatifs de Noël, auxquels, cette année, se mêlent à ceux du mariage de Christine et de Kevin. C’est là que revient Jasper, après 18 mois d’absence passés dans une fac de psycho, bien décidée à partir pour toujours de Lake Pristine. C’est là aussi qu’Arthur tourne un film pour tenter de gagner un prix à un concours. Et pourtant, rien – ou presque – ne va se passer comme prévu !
Comme un film de Noël propose une romance sur fond enneigé, une histoire d’amour entre deux êtres qui se sont crus adversaires durant toute leur scolarité mais qui, de hasards en hasards vont découvrir les sentiments qu’ils éprouvent l’un pour l’autre, comme dans les bons vieux films américains que Jasper va voir tous les jours dans le cinéma d’Arthur. Le personnage de Jasper est l’un de ces trop rares personnages de roman neuro-atypiques, autistes, et l’autrice parvient à montrer le monde tel qu’elle le ressent, tel qu’elle le perçoit, avec beaucoup d’empathie (l’autrice est, elle-même, neuro atypique) et de réalisme. Elle sait saisir un personnage à la croisée de ses chemins, à 18 ans, au sortir de l’enfance, découvrant l’amour, et prenant une nouvelle orientation pour sa vie, devenant adulte.
Autour de ce personnage central de Jasper, une famille et une ville. Sa famille, c’est sa sœur, Christine, aussi dure et despotique, égoïste, qu’elle est altruiste, sa mère, caricature de professeur de danse autoritaire, son père, plus effacé. Une famille qui semble, au premier abord, dysfonctionnelle, avec laquelle Jasper souhaite clarifier ses relations, mais dont les relations apparaissent, au final, plus complexes et plus nuancées. Un village typique, traditionnel, où règnent les rituels et la bonne humeur, mais dont on va découvrir, avec l’héroïne, qu’il est bien moins lisse qu’il n’y parait au premier abord. Ce qui sert de révélateur, c’est le film tourné par Arthur, dont le montage, réalisé par son cousin, montre au grand jour la méchanceté de certains, la gentillesse d’autres, et donne à voir ce qui devrait rester dans l’ombre.
Pour autant, le roman est plein de cette joie de Noël, feel-good novel diraient certains, entrainant, avec sa galerie de personnages secondaires dont on suit, sur une quinzaine de jours, les trajectoires individuelles, les espoirs et les déceptions, jusqu’à un happy end final qui, on s’en doutait dès le début, saura réconcilier tout le monde. Magie du roman, magie de Noël, magie de l’amour… Et surtout façon de montrer le monde tel qu’une jeune neuro atypique peut le percevoir, elle que tout le monde adore, et qui va pouvoir enfin mettre bas le masque du mimétisme social pour être, enfin, elle-même, dans toute sa complexité.
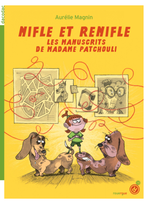 Accompagnée de ses deux bassets, Joe, 8 ans, se veut détective privée dans la cabane au fond du jardin. Sa seule cliente, Madame Patchouli, vient déclarer le vol de précieux manuscrits. De la littérature pour les chiens, qui permet entre autres choses de leur donner de super pouvoirs. Et voilà que deux malfrats se sont emparés de ces ouvrages !
Accompagnée de ses deux bassets, Joe, 8 ans, se veut détective privée dans la cabane au fond du jardin. Sa seule cliente, Madame Patchouli, vient déclarer le vol de précieux manuscrits. De la littérature pour les chiens, qui permet entre autres choses de leur donner de super pouvoirs. Et voilà que deux malfrats se sont emparés de ces ouvrages !