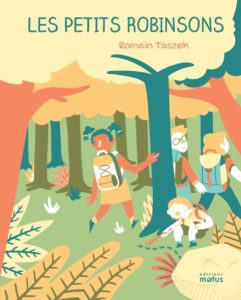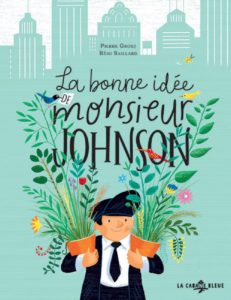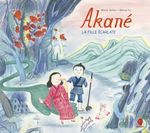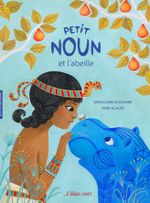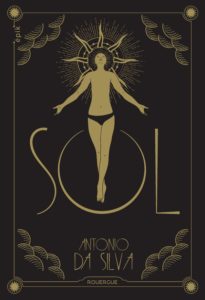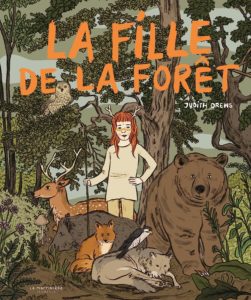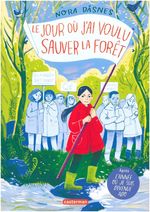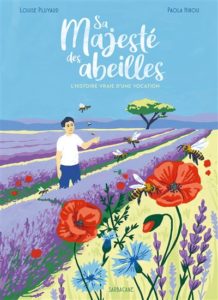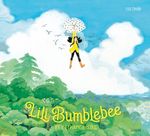Les Magni Freaks
Gaspard Flamant
Sarbacane (roman)
Comme des super héros de Marvel (en mieux)
Par Anne-Marie Mercier
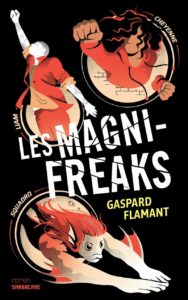 Trois héros bien cabossés par la vie se retrouvent un peu par hasard et vivent des aventures entre Marseille, Aix et Lyon. Ils ont un point commun : chacun a un super-pouvoir. Squadro peut vivre sous l’eau et communique à distance à travers l’eau, Cheyenne est une passe-muraille, Liam peut voler. Chacun a un rapport différent à son pouvoir et l’a acquis dans des circonstances différentes, mais tous l’ont découvert au moment où, d’une manière ou d’une autre – mais toujours violemment –, ils sont devenus orphelins.
Trois héros bien cabossés par la vie se retrouvent un peu par hasard et vivent des aventures entre Marseille, Aix et Lyon. Ils ont un point commun : chacun a un super-pouvoir. Squadro peut vivre sous l’eau et communique à distance à travers l’eau, Cheyenne est une passe-muraille, Liam peut voler. Chacun a un rapport différent à son pouvoir et l’a acquis dans des circonstances différentes, mais tous l’ont découvert au moment où, d’une manière ou d’une autre – mais toujours violemment –, ils sont devenus orphelins.
Ce cadre étant posé, on peut se dire que, un roman ne pouvant pas arriver à la hauteur de l’émerveillement des effets spéciaux des films de Marvel, à quoi bon en faire un roman ? Eh bien c’est une belle surprise : c’est un bon et un beau roman.
Tout d’abord parce qu’il est parfaitement écrit, composé, équilibré. Les dialogues sont justes, en langage très banlieue populaire pour Cheyenne, marseillaise à la famille bigarrée, en français approximatif pour Liam l’irlandais, en langage bizarre, italien ensemencé de Rap marseillais pour Squadro, l’homme poisson (comment il a découvert le rap, c’est aussi une belle invention !). Quant à la narration, elle est écrite dans une langue et un style riches, soignés, précis, souvent beaux, très justes.
Liam maitrise mal son pouvoir, découvert depuis peu, et cela donne lieu à de micro-épisodes comiques réussis. Cheyenne porte la dimension tragique du récit : elle cherche à venger son frère, assassiné au moment où il fouinait vers une usine de retraitement de déchets dont le propriétaire est le caïd du quartier. Tous sont redevables à ce criminel, et tout le monde le craint, à raison car il est lui aussi une autre espèce de monstre. Squadro, lui, met la préoccupation écologique au cœur du polar : il s’agit aussi bien de trouver et neutraliser l’assassin de Toufik que de punir l’homme qui salit les océans.
Rebondissements multiples, vision chaleureuse de la vie des quartiers urbains pauvres, sur le plan humain, mais désastreuse aussi, c’est une belle plongée dans un monde tantôt glauque tantôt lumineux, dans lequel les super héros font rêver à davantage de justice, comme des super héros de Marvel (en mieux).