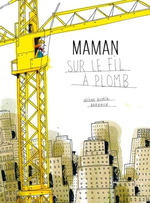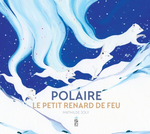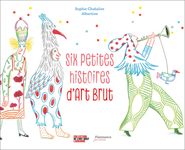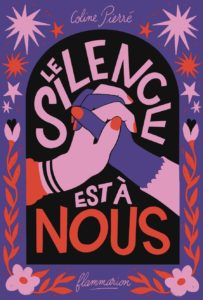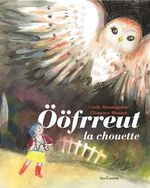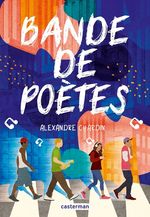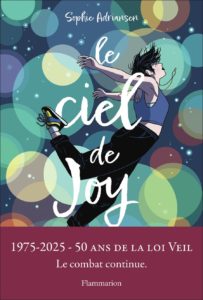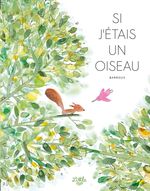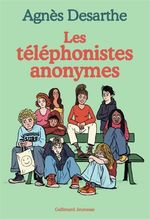Petite Chose / Et si l’on s’aime
Claire Beuve / Cathy Ytak : illustrations de Joséphine Forme
Editions du Pourquoi pas ?? 2026
Femme, vie, liberté
Par Michel Driol
 Deux récits, de deux autrices différentes, mais qui tournent autour de la question de la liberté, de la sexualité, de la femme, avec des personnages qu’on retrouve dans les deux textes, Linh, Tiago, Noam, Mélina et Bilal. Claire Beuve, dans Petite Chose, imagine Linh, une adolescente au moment d’être forcée d’épouser un lointain cousin qu’elle ne connait pas, ses sentiments, sa peur, la pression familiale, avant de la montrer s’échappant heureusement à ce piège grâce à une ruse. Cathy Ytak raconte la découverte de l’amour de Mélina et de Bilal, sur une ile, entre les deux rives d’un fleuve.
Deux récits, de deux autrices différentes, mais qui tournent autour de la question de la liberté, de la sexualité, de la femme, avec des personnages qu’on retrouve dans les deux textes, Linh, Tiago, Noam, Mélina et Bilal. Claire Beuve, dans Petite Chose, imagine Linh, une adolescente au moment d’être forcée d’épouser un lointain cousin qu’elle ne connait pas, ses sentiments, sa peur, la pression familiale, avant de la montrer s’échappant heureusement à ce piège grâce à une ruse. Cathy Ytak raconte la découverte de l’amour de Mélina et de Bilal, sur une ile, entre les deux rives d’un fleuve.
Les deux récits tissent ainsi des liens entre les personnages, mais c’est surtout par leurs thématiques qu’ils se font écho. Il y est question, sans tabou ni pudibonderie, des transformations liées à l’adolescence, les règles pour les filles, la mue pour les garçons, et l’entrée dans un nouveau monde où la sexualité occupe une part plus importante. Que signifie cela pour les deux personnages féminins principaux ? Pour la famille de Linh, la voilà devenue en âge de se marier : mariage forcé, arrangé. Pour la mère de Mélina, c’est la mise en garde contre le risque d’avoir un bébé. Bien sûr, au mariage sans amour s’oppose la découverte de l’amour par Mélina et Bilal, un amour tout en tendresse, douceur, respect et consentements partagés. Un amour post MeToo, un amour dans lequel Cathy Ytak s’amuse à déconstruire les stéréotypes pour donner à voir d’autres modèles de comportement qui font plaisir à lire, faisant de Bilal un garçon timide, sensible, et de Mélina une fille pleine de force et d’empathie.
C’est bien la question des modèles familiaux que posent ces deux récits. D’un côté la famille traditionnelle, traditionnaliste, pour laquelle la réputation et la répétition des coutumes tient lieu de mode de vie, au détriment des libertés et des désirs individuels. De l’autre, le singulier discours du père de Bilal, un discours qui institue un modèle masculin à l’opposé du modèle dominant, un modèle qui valorise la douceur et la tendresse. Et, au milieu de tout cela, au milieu de ce fleuve, de cette nouvelle carte du tendre, deux adolescents qui se découvrent et découvrent une nouvelle façon d’être ensemble. Symboliquement, l’image centrale du cahier d’illustration montre le reflet dissocié d’une adolescente dans l’eau, reliant ainsi les deux récits, la construction et la déconstruction.
Ecriture soignée pour les deux textes. Ecriture en elle qui deviendra une écriture en je pour Petite Chose, les pronoms symbolisant bien le passage entre la chose de la famille et le je qui s’échappe et court vers sa liberté. Ecriture aussi très poétique, dans sa structure, des strophes de trois ou quatre vers, dans son rythme, ses anaphores, son montage serré entre ce qu’éprouve Linh et les paroles qu’elle entend, une écriture qui semble marquer l’immobilisme de cette société figée et qui s’oppose aux deux dernières pages, la fuite, au rythme haletant, et au rêve d’un autre futur possible. Ecriture aussi très poétique de Cathy Ytak, dans un autre registre, écriture qui épouse le point de vue masculin, celui de Bilal, écriture de l’intime, de l’intimité des corps qui se touchent, des regards, mais aussi des paroles échangées. A noter ces phrases en italique qui tranchent, phrases en nous, phrases en on, qui montrent ce qui relie ces deux adolescents dans leurs gestes, leurs pensées, leurs souvenirs.
Deux récits très féministes mais deux récits qui ne se veulent pas militants, deux récits qui ouvrent la voie à une autre relation entre les filles et les garçons, deux récits qui disent l’espérance et l’attente d’un autre monde possible.