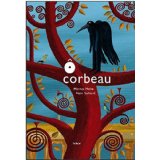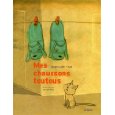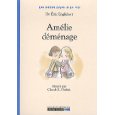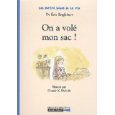Méto: t. 1 (La maison), 2 (L’île), 3 (Le monde)
Yves Grevet
Syros, 2008-2010
SF en poupées russes
par Anne-Marie Mercier
 La trilogie de science fiction d’Yves Grevet se clôt avec le troisième tome de Méto. Rarement une œuvre de science fiction française aura créé avec autant de cohérence un univers aussi original que sobre et rarement (jamais ?) une œuvre pour la jeunesse aussi classique de ce genre aura été d’une telle qualité, sans concessions quant à la violence et à la noirceur.
La trilogie de science fiction d’Yves Grevet se clôt avec le troisième tome de Méto. Rarement une œuvre de science fiction française aura créé avec autant de cohérence un univers aussi original que sobre et rarement (jamais ?) une œuvre pour la jeunesse aussi classique de ce genre aura été d’une telle qualité, sans concessions quant à la violence et à la noirceur.
Le monde de Méto est un univers de poupées russes à l’envers : chaque volume fait découvrir dans quel ensemble plus large il se trouve, et chaque ensemble est aussi noir et limité que le précédent. La maison est une prison, située dans une île concentrationnaire, elle–même placée dans un monde fermé où la seule issue est… le retour à la Maison.
A signaler également, la réussite graphique des volumes, qui déclinent bien répétition et variation et offrent une mise en image intéressante de ce monde.
tome 1 : la maison
Prison d’enfants
 Roman d’anticipation, de formation, de collège, La Maison est tout cela sous le signe général de l’enfermement. Des garçons sont réunis dans une maison qui est tout leur monde : amnésiques, ils n’ont pas accès à leur passé, sans famille ils ne se souviennent pas d’en avoir eu une. Ils n’ont pas de futur non plus, ignorant ce que deviennent ceux d’entre eux qui arrivent à l’adolescence et disparaissent. Ils ignorent aussi qu’un autre sexe existe.
Roman d’anticipation, de formation, de collège, La Maison est tout cela sous le signe général de l’enfermement. Des garçons sont réunis dans une maison qui est tout leur monde : amnésiques, ils n’ont pas accès à leur passé, sans famille ils ne se souviennent pas d’en avoir eu une. Ils n’ont pas de futur non plus, ignorant ce que deviennent ceux d’entre eux qui arrivent à l’adolescence et disparaissent. Ils ignorent aussi qu’un autre sexe existe.
Dirigés par des hommes nommés « César » (César 1, César 2 etc.), eux mêmes portent des noms aux consonances romaines (Claudius, Crassus, Paulus…). La discipline est militaire, carcérale aussi. Les plus vieux initient les plus jeunes. L’entraînement se fait dans un jeu collectif très violent, seul dérivatif à la tension qui les habite tous, et on y joue avec la mort.
Tentatives de comprendre, de savoir qui sait, de connaître ses vrais amis et les distinguer des traîtres, de trouver des échappées, d’ouvrir des portes, de renouer avec des bribes de souvenir… tout cela est mené par le héros, Méto, qui raconte à la première personne dans un style très simple et factuel et entraîne ainsi le lecteur dans ce monde opaque et inquiétant
(article paru antérierement sur Sitartmag)
tome 2 : l’île
Prison à ciel ouvert
 Evadé de la maison, Méto découvre que le paradis de la liberté est encore loin, plus loin même que dans le volume précédent. Ce deuxième univers est lui aussi fait de couloirs, de recoins, de complots, encore plus sombres que les précédents (au propre comme au figuré). Le héros passe par de multiples souffrances aussi bien physiques que morales. L’un des mérites de l’ouvrage, à ajouter à son originalité et à son mystère, réside dans la manière de les décrire : guérir est lent, difficile, demande beaucoup de patience, et parfois n’advient pas. Autre mérite : le bien et le mal sont liés et on ne sait plus bien ce qui est le pire, le pouvoir de la maison ou celui qui règne sur l’île. La trahison et la déception alternent avec les moments d’éclaircie, jusqu’au moment où l’on retourne à la case départ… la maison.
Evadé de la maison, Méto découvre que le paradis de la liberté est encore loin, plus loin même que dans le volume précédent. Ce deuxième univers est lui aussi fait de couloirs, de recoins, de complots, encore plus sombres que les précédents (au propre comme au figuré). Le héros passe par de multiples souffrances aussi bien physiques que morales. L’un des mérites de l’ouvrage, à ajouter à son originalité et à son mystère, réside dans la manière de les décrire : guérir est lent, difficile, demande beaucoup de patience, et parfois n’advient pas. Autre mérite : le bien et le mal sont liés et on ne sait plus bien ce qui est le pire, le pouvoir de la maison ou celui qui règne sur l’île. La trahison et la déception alternent avec les moments d’éclaircie, jusqu’au moment où l’on retourne à la case départ… la maison.
tome 3 : le monde
L’avenir en prison
 De retour dans la maison, Méto apprend encore beaucoup de choses. Son sens logique et ses talents de manipulateur font merveille et donnent lieu à d’excellentes pages. Ils lui permettent de lever tous les mystères : d’où il vient, qui il est, qui a créé la Maison, pourquoi il s’y trouve et ce que le monde a à leur offrir. Tout cela rassemble de nombreux thèmes de la science fiction et les entremêle de façon très cohérente (catastrophe, savants amoraux, manipulations de la mémoire, nouvel ordre social, éducation, jeux…) pour créer un monde parfaitement dystopique.
De retour dans la maison, Méto apprend encore beaucoup de choses. Son sens logique et ses talents de manipulateur font merveille et donnent lieu à d’excellentes pages. Ils lui permettent de lever tous les mystères : d’où il vient, qui il est, qui a créé la Maison, pourquoi il s’y trouve et ce que le monde a à leur offrir. Tout cela rassemble de nombreux thèmes de la science fiction et les entremêle de façon très cohérente (catastrophe, savants amoraux, manipulations de la mémoire, nouvel ordre social, éducation, jeux…) pour créer un monde parfaitement dystopique.
La découverte du sexe féminin, ébauchée dans le précédent volume, montre un traitement du genre sans stéréotypes et Méto et sa compagne semblent prêts pour un avenir qu’ils auront contribué à construire, libre mais clos, imparfait mais humain. Ce dernier volume répond à toutes les questions tout en proposant une fin ouverte que chaque lecteur pourra imaginer à son gré, tant que l’œuvre lui restera en mémoire, c’est-à-dire longtemps, vu sa qualité.

 Ils ont seize ans, ils sont beaux, ils sont bons élèves, ils habitent Versailles, ils écoutent Tom Waits sur leur iPod, mais ils jouent de la musique classique dans un orchestre et on leur pardonne aisément de confondre parfois Schubert et Schumann qui ne sont pas de leur génération – Tom Waits non plus d’ailleurs n’est pas de leur génération. Ils ont vu Good Bye Lenine et savent que le héros de Scream porte le masque du Cri (de Munch).
Ils ont seize ans, ils sont beaux, ils sont bons élèves, ils habitent Versailles, ils écoutent Tom Waits sur leur iPod, mais ils jouent de la musique classique dans un orchestre et on leur pardonne aisément de confondre parfois Schubert et Schumann qui ne sont pas de leur génération – Tom Waits non plus d’ailleurs n’est pas de leur génération. Ils ont vu Good Bye Lenine et savent que le héros de Scream porte le masque du Cri (de Munch). L’idée était bonne et avait de quoi séduire les amateurs de brocante : le mérite indiscutable du roman de Marie-Claire Boucault est de faire partager et de bien analyser les émotions et les rêveries qui peuvent survenir à la vue de tel ou tel objet en vente aux Puces. Elle en a fait le point de départ de son récit : la narratrice déniche un album de photos et se laisse arrêter par celle d’une tombe. Elle décide de rendre l’album à la famille à laquelle il appartient.
L’idée était bonne et avait de quoi séduire les amateurs de brocante : le mérite indiscutable du roman de Marie-Claire Boucault est de faire partager et de bien analyser les émotions et les rêveries qui peuvent survenir à la vue de tel ou tel objet en vente aux Puces. Elle en a fait le point de départ de son récit : la narratrice déniche un album de photos et se laisse arrêter par celle d’une tombe. Elle décide de rendre l’album à la famille à laquelle il appartient. La qualité du roman précédent de Yves Grevet, Méto, trilogie de science fiction, créait une attente et c’est sans doute l’une des raisons d’un léger sentiment de déception à la lecture de ce nouveau texte. Il y a une certaine originalité, ce n’est pas mal écrit, mais l’ensemble est moins inventif, moins orienté vers la réflexion critique, et, bizarrement, moins crédible… En effet, Yves Grevet quitte ici le genre de la SF pour le policier, un genre qui demande davantage d’ancrage dans le probable.
La qualité du roman précédent de Yves Grevet, Méto, trilogie de science fiction, créait une attente et c’est sans doute l’une des raisons d’un léger sentiment de déception à la lecture de ce nouveau texte. Il y a une certaine originalité, ce n’est pas mal écrit, mais l’ensemble est moins inventif, moins orienté vers la réflexion critique, et, bizarrement, moins crédible… En effet, Yves Grevet quitte ici le genre de la SF pour le policier, un genre qui demande davantage d’ancrage dans le probable. Le petit Louis Lézard, accompagné de sa mère, rend visite à son arrière grand-père dans sa maison de retraite. Sa mère reste dans le couloir et le vieil homme et l’enfant sont seuls. « L’ancêtrosaure » lui parle de la difficulté de vieillir, de sa jeunesse (un album photo fait resurgir les personnages de sa vie), de ses regrets et de son dernier désir (une ultime promenade en montagne dont on sait qu’elle est impossible à moins d’être une métaphore du dernier voyage). Il fait parler Louis également et s’intéresse à la vie des autres.
Le petit Louis Lézard, accompagné de sa mère, rend visite à son arrière grand-père dans sa maison de retraite. Sa mère reste dans le couloir et le vieil homme et l’enfant sont seuls. « L’ancêtrosaure » lui parle de la difficulté de vieillir, de sa jeunesse (un album photo fait resurgir les personnages de sa vie), de ses regrets et de son dernier désir (une ultime promenade en montagne dont on sait qu’elle est impossible à moins d’être une métaphore du dernier voyage). Il fait parler Louis également et s’intéresse à la vie des autres. Jo Hoestland fait parler le jeune Tim, en un langage populaire, imagé et gouailleur, une imitation d’oral un peu datée. Elle passe également par ses impressions pour évoquer sans trop de misérabilisme ni trop de condescendance une histoire bien misérable, celle d’un vieil homme, le voisin d’en face de Tim, solitaire, sale, méchant, radin et mystérieux.
Jo Hoestland fait parler le jeune Tim, en un langage populaire, imagé et gouailleur, une imitation d’oral un peu datée. Elle passe également par ses impressions pour évoquer sans trop de misérabilisme ni trop de condescendance une histoire bien misérable, celle d’un vieil homme, le voisin d’en face de Tim, solitaire, sale, méchant, radin et mystérieux. Au milieu des illustrations colorées et naïves, alliant tachisme, fonds pastels et papiers découpés, un livre blanc aux pages blanches voyage. S’il est figuré avec l’esthétique d’un dessin d’ordinateur il se superpose à des peintures. Son premier lecteur le poursuit par monts et par mers.
Au milieu des illustrations colorées et naïves, alliant tachisme, fonds pastels et papiers découpés, un livre blanc aux pages blanches voyage. S’il est figuré avec l’esthétique d’un dessin d’ordinateur il se superpose à des peintures. Son premier lecteur le poursuit par monts et par mers.