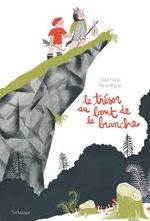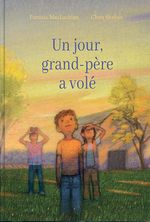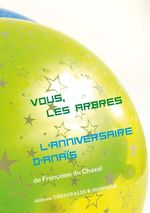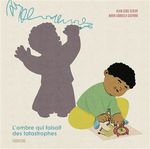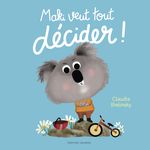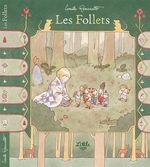Barabal Skaw
Benjamin Desmares
Rouergue 2025
Les maitres du monde
Par Michel Driol
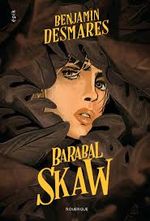 Avec un tel prénom, voilà une héroïne de 17 ans qui ne manque pas de courage. Orpheline, écossaise, indomptable, cleptomane, c’est dans le bureau d’un psychologue qu’on fait sa connaissance. Elle n’a pu s’empêcher de voler une lettre bien compromettante à un lord haut placé lorsque ce dernier est venu visiter son école. Seule issue : l’envoyer – oh mystère ! – dans une école de luxe située au milieu de la mer Ionienne, à Mélanos. Mais rêve ou cauchemar ? car, après un éprouvant voyage dans un bateau de pêche à la morue breton, et donc un détour par l’Islande, la voilà débarquée dans un autre monde, dans une école où se côtoient les externes, locaux et les internes fortunés, dans une école bien étrange.
Avec un tel prénom, voilà une héroïne de 17 ans qui ne manque pas de courage. Orpheline, écossaise, indomptable, cleptomane, c’est dans le bureau d’un psychologue qu’on fait sa connaissance. Elle n’a pu s’empêcher de voler une lettre bien compromettante à un lord haut placé lorsque ce dernier est venu visiter son école. Seule issue : l’envoyer – oh mystère ! – dans une école de luxe située au milieu de la mer Ionienne, à Mélanos. Mais rêve ou cauchemar ? car, après un éprouvant voyage dans un bateau de pêche à la morue breton, et donc un détour par l’Islande, la voilà débarquée dans un autre monde, dans une école où se côtoient les externes, locaux et les internes fortunés, dans une école bien étrange.
C’est d’abord un roman d’aventures, avec une héroïne – narratrice – au caractère bien trempé, maligne, avec un réel don pour le vol et l’escamotage. Tous ces dons lui seront nécessaires pour découvrir les mystères de l’ile, et la raison pour laquelle on l’a envoyée à Mélanos. Passons sur les péripéties, nombreuses, mutinerie à bord du bateau de pêche, expéditions nocturnes pleines de danger, sauvetage miraculeux. Passons aussi sur les personnages, le récit révélant les faux amis comme les alliés inattendus, et conduisant l’héroïne à revoir son jugement sur les autres. Passons enfin sur la question des retrouvailles – ou pas – de l’héroïne avec ses parents. Car ce roman d’aventures plein de romanesque plonge le lecteur au cœur d’une ile qui s’avère bien plus qu’un simple point sur la carte, au sein d’une école aux cours étranges à destination des seuls externes et de Barabal. Cours de dessin, cours de méditation, cours d’hypnose, cours de bourdonnement… Après Poudlard, Mélanos ? Oui, et non. Oui, car il est bien question de magie, de pouvoirs occultes à apprendre à développer. Non, car cet univers n’est pas clos sur lui-même, mais place là les véritables maitres du monde, capables d’orienter à leur guise, et de façon souvent brutale, les décisions des hommes d’état, des journalistes qu’ils peuvent facilement contrôler. Dès lors, le roman pose toute une série de questions au lecteur. Qui détient le pouvoir ? Les démocraties sont-elles une illusion face à une oligarchie ou une mafia capables de se reproduire, de protéger leurs intérêts ? Que signifie résister, et quelles peuvent être les formes et les dangers de cette résistance ? Sous couvert de magie, c’est bien de cela qu’il est question dans ce roman. Et si jamais le pouvoir se retrouvait concentré dans les mains de Barabal, qu’en ferait-elle ?
Ecrit à la première personne pour l’essentiel, le roman ménage pourtant quelques chapitres qui montrent une réalité que ne connait pas la narratrice. Chapitres courts, percutants, comme ce prologue dans lequel on voit un journaliste indépendant, prêt à révéler les agissements d’une organisation criminelle jeter ses propres enfants par la fenêtre, sans raison. Autant de chapitres qui suscitent l’intérêt du lecteur, en ménageant le suspense sur l’identité des interlocuteurs dans tel chapitre, sur le destin de Barabal dans tel autre…
Un roman d’aventure à l’intrigue solide, flirtant avec le fantastique, mais s’ancrant ben dans le réel, situé en 1926, dont l’héroïne attachante découvrira son histoire autant qu’elle révèlera des mystères quant à la marche du monde.