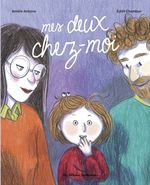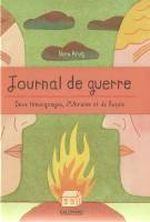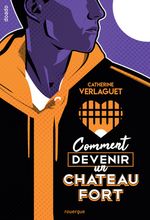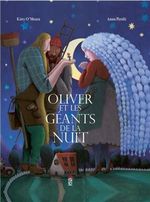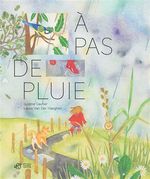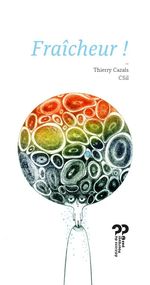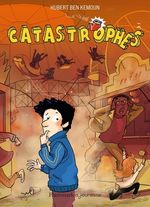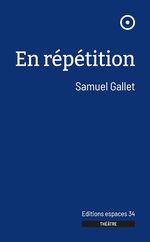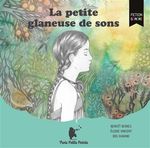Welcome Sarah
Véronique Foz
Milan 2024
Mais je suis une fille…
Par Michel Driol
 Arthur, un prénom de roi pour ce petit métis, qui raconte son histoire. Ce petit métis ou cette petite métisse, car Arthur se sait fille depuis toujours, emprisonnée dans un corps de garçon, ce que son entourage ne veut pas voir. On n’accepte pas qu’elle mette des robes, pour se déguiser… On est dans une famille monoparentale, la mère est aide-soignante, le père, d’origine africaine, et parti. Trop violent, sans doute, si bien qu’on ne parle pas de lui à la maison. Arrive dans la vie de la mère Dumi, émigré d’origine roumaine, un homme doux et plein de qualités humaines. Les voisins avec lesquels on s’entend bien déménagent, laissant en cadeau une robe de princesse des neiges… C’est le temps de l’école primaire, puis du collège. Comment accepter son identité de genre et se faire reconnaitre comme Sarah, entre tentative de suicide, harcèlements divers, et l’amitié de trois personnages lumineux, Lenny l’assistant d’anglais, Amérindien, Elliott, l’américain, et Natasha la jeune russe ?
Arthur, un prénom de roi pour ce petit métis, qui raconte son histoire. Ce petit métis ou cette petite métisse, car Arthur se sait fille depuis toujours, emprisonnée dans un corps de garçon, ce que son entourage ne veut pas voir. On n’accepte pas qu’elle mette des robes, pour se déguiser… On est dans une famille monoparentale, la mère est aide-soignante, le père, d’origine africaine, et parti. Trop violent, sans doute, si bien qu’on ne parle pas de lui à la maison. Arrive dans la vie de la mère Dumi, émigré d’origine roumaine, un homme doux et plein de qualités humaines. Les voisins avec lesquels on s’entend bien déménagent, laissant en cadeau une robe de princesse des neiges… C’est le temps de l’école primaire, puis du collège. Comment accepter son identité de genre et se faire reconnaitre comme Sarah, entre tentative de suicide, harcèlements divers, et l’amitié de trois personnages lumineux, Lenny l’assistant d’anglais, Amérindien, Elliott, l’américain, et Natasha la jeune russe ?
Ecrit à la première personne par Arthur-Sarah, voilà un roman poignant qui aborde sans détours un sujet difficile, celui de la transidentité de genre, et ses conséquences psychologiques et sociales chez un enfant. On voit grandir Sarah, depuis sa naissance jusqu’à son adolescence, jusqu’au moment où elle fait son coming out en venant habillée en fille au collège. Le récit à la première personne permet un discours sur les émotions, le ressenti, les craintes, les rêves, les espoirs de la fillette, et surtout l’expression de son incompréhension. Incompréhension face à cette différence qui la laisse en marge, craintes face à la puberté qui avance et le fait de se sentir encore plus étrangère dans un corps de garçon. Elle n’est pas la seule à ne pas comprendre, Sarah. Il y aussi sa mère, qui refuse de voir en elle une fille, et reste sourde aux propos pourtant plus ouverts de la voisine qui va déménager. Il y aussi les psychiatres et les psychologues, qui, sous un mot savant, dysphorie de genre, laissent Sarah et sa mère bien désemparées. Le roman décrit bien les différentes phases par lesquelles passe Sarah, abattement, révolte, violence, avec la figure métaphorique du loup présent en elle prêt à se réveiller.
On ressent avec l’héroïne toute la violence subie du temps du collège. Peu d’adultes protecteurs face au harcèlement dont elle est victime (triste figure que celle du principal, plus préoccupé par un « pas de vague » que par la sécurité physique et affective de cette élève, victime d’une bande de quatre garçons harceleurs et hyper violents, dans leur refus d’accepter la différence). Insultes homophones et coups conduisent Sarah à l’hôpital après une agression particulièrement sauvage. L’autrice ne cache rien de ce harcèlement scolaire, et de ses conséquences.
Le roman vaut aussi par les personnages secondaires : la mère, à la fois débordante d’amour, aide-soignante dans un EHPAD, qui reprend des études d’infirmière, protectrice maladroite, Idriss, le frère ainé, lui aussi plein d’amour pour Arthur-Sarah, en quête de son père biologique, personnage déchiré et en crise d’identité, lui aussi cherchant sa voie entre travail et études, Natasha, la jeune russe, orpheline de mère, qui sait être à l’écoute d’Arthur, celle à qui il confie pour la première fois son angoisse quant à son identité, et surtout Lenny, le jeune indien d’Amérique, personnage non binaire qui allie une force naturelle à une profonde sensibilité qui le conduit à comprendre les désarrois et la souffrance – morale et physique – d’Arthur. Sans compter tous les autres (Dumi, les oncles et cousines de Sarah…), personnages bien dessinés et attachants.
On reprochera peut-être le côté un peu didactique du chapitre 51, qui décrit le parcours de transition « classique », mais il est le signe d’un roman documenté, qui ne veut rien laisser au hasard, cherche à instruire tout en présentant une grande qualité littéraire. La langue est claire et précise, c’est celle du témoignage, qui ne cherche pas les effets faciles de pathos, mais raconte, dans l’ordre chronologique, à hauteur d’enfant ou d’adolescent. Des allusions au conte (en particulier la petite sirène) ou à la comptine (la souris verte), des citations de chansons, de films apportent aussi une ouverture culturelle pour dire cette force qu’ont les récits pour qui veut bien les écouter. Des motifs récurrents (liés aux lectures de Sarah souvent) viennent aussi structurer le récit.
Welcome Sarah, un roman plein d’empathie pour ses personnages principaux, et pour ceux qui se situent dans les marges, celles et ceux dont l’intégration et l’acceptation dans la société est encore difficile. Gageons que ce roman permettra d’appréhender ces questions avec plus d’humanité ! n’est-ce pas là un des grands rôles du roman et de la littérature ? Ce serait tellement mieux de changer les mentalités, affirme Lenny à la fin…