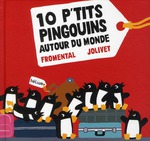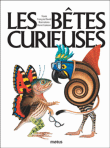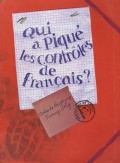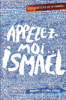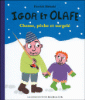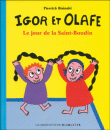Pipi! Crotte! Prout!
Pittau et Gervais
Seuil jeunesse, 2012
Pipicacaprout!
Par Caroline Scandale
 Pittau et Gervais, auteur/illustratrice de cet ouvrage et couple à la ville, ont à leur actif des dizaines d’albums en commun. L’originalité de leur travail est qu’ils ne prennent pas les enfants pour des idiots. A travers des thèmes en apparence légers, et de manière toujours décalée, ils font passer des messages intelligents dénués de toute moralisation pesante. On leur doit par exemple, Les interdits des petits et des grands où ils dressent l’inventaire leger de ce que les enfants ne doivent pas faire (pipi dans la piscine…) Et surtout, celui beaucoup plus serieux, de ce que les adultes n’ont absolument pas le droit de faire, comme toucher leur zizi ou zezette… Leur volonté de parler de choses qui dérangent est claire et réussie.
Pittau et Gervais, auteur/illustratrice de cet ouvrage et couple à la ville, ont à leur actif des dizaines d’albums en commun. L’originalité de leur travail est qu’ils ne prennent pas les enfants pour des idiots. A travers des thèmes en apparence légers, et de manière toujours décalée, ils font passer des messages intelligents dénués de toute moralisation pesante. On leur doit par exemple, Les interdits des petits et des grands où ils dressent l’inventaire leger de ce que les enfants ne doivent pas faire (pipi dans la piscine…) Et surtout, celui beaucoup plus serieux, de ce que les adultes n’ont absolument pas le droit de faire, comme toucher leur zizi ou zezette… Leur volonté de parler de choses qui dérangent est claire et réussie.
Concernant Pipi! Crotte! Prout!, il s’agit d’une réédition de trois albums cultes, réunis en un seul, à l’occasion des 20 ans de Seuil jeunesse. Le titre évocateur colle parfaitement au contenu… Phobiques d’humour scatologique s’abstenir!
Et pourtant… Comment faire rire un enfant si ce n’est en lui parlant de prout-pipi-caca? Et quoi de plus naturel et vital que cela? L’histoire transposée dans le monde animal permet à l’auteur de transgresser les règles de bienséance, obtenant ainsi des scènes cocasses. La plus marquante est celle du zèbre dans un restaurant, qui urine dans l’assiette d’un hôte installé à la table d’à côté, faute de pouvoir juguler ce besoin naturel…
Un ouvrage à posséder dans sa petite bibliothèque idéale des moins de 5 ans.