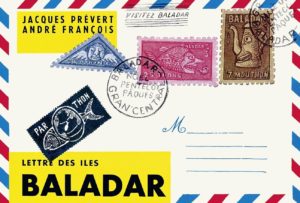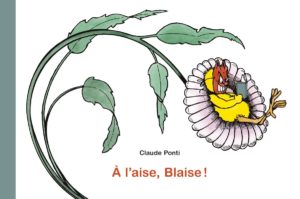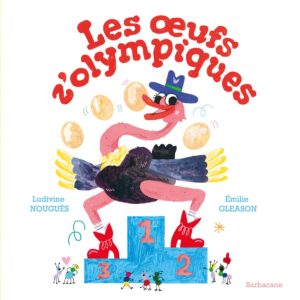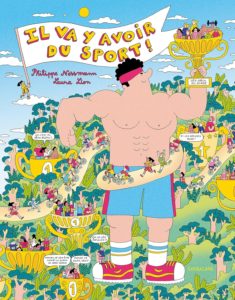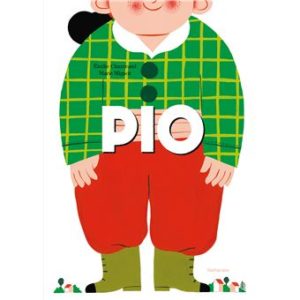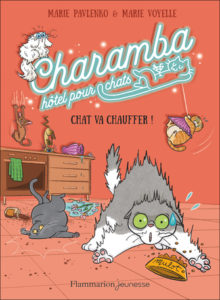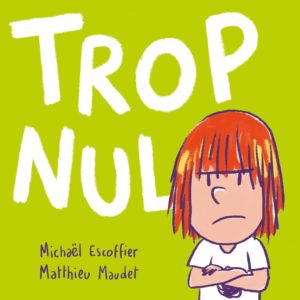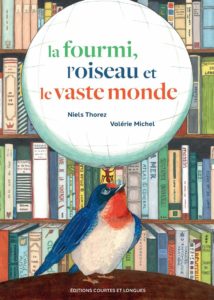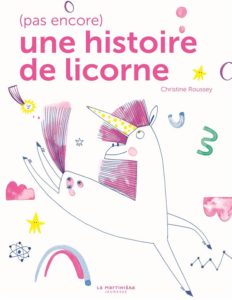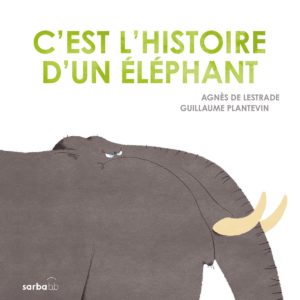Pagaille en pagaies
Marie Dorléans
Sarbacane, 2024
Une médaille d’or en mosaïque
Par Anne-Marie Mercier
 Après Course épique, Marie Dorléans reprend le même format à l’italienne très allongé pour s’amuser d’un autre sport, ici l’aviron. Les doubles pages proposent une vue très panoramique de la rivière, dans un décor presque immuable : en haut le ciel bleu, puis la pelouse, couverte au début de pique-niqueurs, et enfin la rivière, vide au début et qui se couvre de canoés à deux rameurs. Certains rameurs sont bien maladroits et l’on découvre différentes manières de ne pas avancer, mais le problème est plus grand encore et les suspenses s’accumulent.
Après Course épique, Marie Dorléans reprend le même format à l’italienne très allongé pour s’amuser d’un autre sport, ici l’aviron. Les doubles pages proposent une vue très panoramique de la rivière, dans un décor presque immuable : en haut le ciel bleu, puis la pelouse, couverte au début de pique-niqueurs, et enfin la rivière, vide au début et qui se couvre de canoés à deux rameurs. Certains rameurs sont bien maladroits et l’on découvre différentes manières de ne pas avancer, mais le problème est plus grand encore et les suspenses s’accumulent.
Une première énigme nous était proposée dès le début : parmi les pique-niqueurs, il y a Sophia qui vient de recevoir un cadeau ; il faut la trouver dans l’image et comprendre ce que c’est que cet objet qu’elle tient dans ses mains.
C’est un masque de plongée et un tuba. Elle l’inaugure quand la course commence, et nous découvrons avec elle l’envers de la compétition. Parmi ces rameurs il y a des tricheurs. Le point de vue descend un peu plus bas, suivant Sophia en plongée : le ciel a disparu du tiers supérieur de la page, c’est la pelouse qui occupe sa place et l’on voit la rivière occuper toute la moitié inférieure, sur toute sa profondeur. On découvre alors avec Sofia ce qui se trame sous les bateaux : certains se font remorquer par des poissons, d’autres par des scaphandriers, etc., d’autres ont des jambes, des poissons font la course… Les situations absurdes s’accumulent. Tout cela est très drôle, servi par un dessin à la ligne claire, une grande sobriété, et beaucoup de sérieux apparent.
Tout s‘achève dans un grand désordre, et une course où, chacun ayant voulu battre l’autre, personne ne gagne : il faut partager la médaille d’or en petites miettes. Une leçon de sportivité?
En voir un peu plus sur le site de l’éditeur