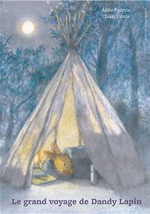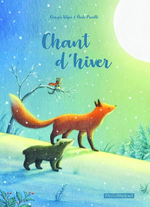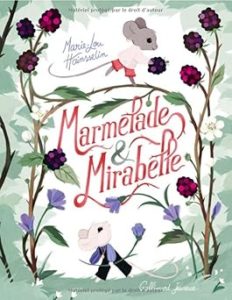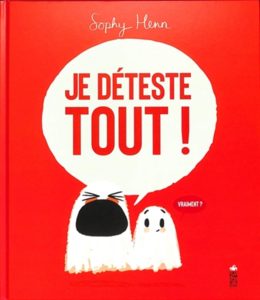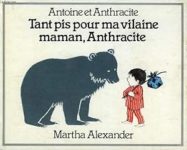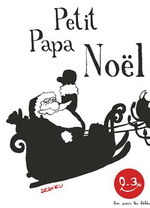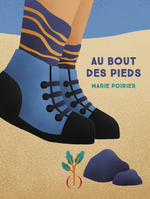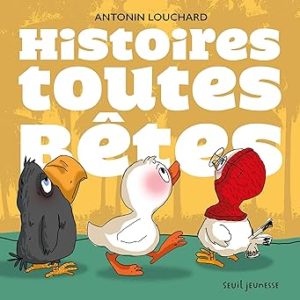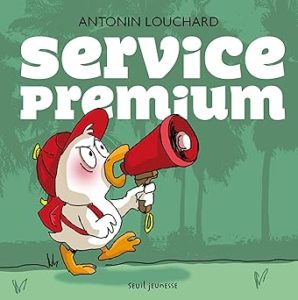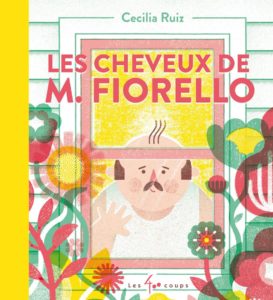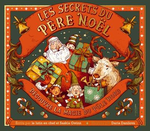La Fée bleue
Marie Détrée
Rouergue 2025
Comme un cherche et trouve…
Par Michel Driol
 La Fée bleue, c’est l’amour invisible d’Aimé, le dompteur de nuages. Il la cherche partout, et demande tant à Agathe la contremaitre de la carrière de pierre qu’aux gallinacées ou au tigre où elle se trouve. En vain…
La Fée bleue, c’est l’amour invisible d’Aimé, le dompteur de nuages. Il la cherche partout, et demande tant à Agathe la contremaitre de la carrière de pierre qu’aux gallinacées ou au tigre où elle se trouve. En vain…
Ce récit en randonnée est aussi très poétique. Une poésie qui joue sur les sonorités, les homophonies, les rimes parfois, les rythmes souvent. Une poésie qui joue aussi sur les mots, qui s’associent de façon parfois inattendue, parfois à la limite du clin d’œil ou du double sens. Une poésie qui joue aussi sur la situation, nous proposant le monologue d’un improbable dompteur de nuages et qui côtoie le merveilleux de l’univers du cirque à l’ancienne.
Les illustrations sonnent comme un hommage à ces vieilles images d’Epinal dans lesquelles il fallait trouver un personnage bien caché dans des feuillages ou un motif. C’est le cas ici, le lecteur étant invité à trouver la fée bleue qu’Aimé, le mal nommé, ne voit pas. Elle se dissimule un peu partout dans les images, parfois de façon évidente, parfois de façon plus subtile. Autant qu’un clin d’œil à l’imagerie d’Epinal, les illustrations ont un aspect retro qui plonge dans le monde du cirque du début du XXème siècle, avec ce personnage de colosse dompteur dont les moustaches et le marcel évoquent bien les hercules de foire. Qu’on soit dans la jungle ou sous la mer, elles multiplient les animaux, les végétaux dans une luxuriance proche de la naïveté du douanier Rousseau, techniques mises à part, puisqu’ici tout est stylisé et fait au feutre, et à l’aquarelle.
Au final, cet album dit la quête de l’être aimé par une sorte de géant lunaire pas très malin. Quête universelle de l’amour d’un être inaccessible magique, merveilleux. Quête qui entraine les quolibets des autres, leur moquerie. Quête qui pourtant se clôt sur deux leçons de sagesse. La première, que chacun est caché sous un masque, comme la fée cachée dans les images. La seconde, c’est que cette quête d’un être extérieur est peut-être bien celle d’un moi profond. La Fée bleue se cacherait-elle en Aimé, comme un contraire ou un complémentaire, une autre vérité ?
Un album en forme de cherche et trouve, poétique et sensible, qui aborde de façon originale la quête de l’autre et de soi même.