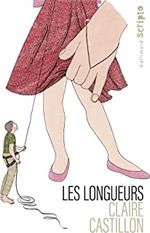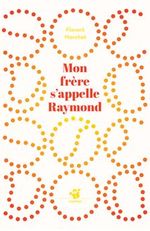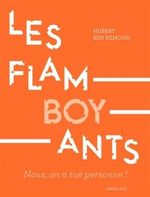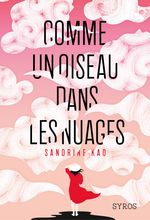Sombre
Patrice Favaro
Le calicot 2022
Ce qui reste de l’enfance
Par Michel Driol
 Le narrateur vit avec ses grands-parents dans une ville du sud de la France. Il prend des cours d’orthographe avec une jeune étudiante. Un jour, il est la cible d’un pédophile au scooter jaune. Apeuré, pour se défendre, il récupère le révolver de ses grands-parents, en parle à un de ses copains qui l’incite à aller, avec lui, attaquer quelques homosexuels. Puis le copain, qui garde le révolver, attaque un commerce… Quelques années plus tard, écrivain, il revient sur les lieux de son enfance.
Le narrateur vit avec ses grands-parents dans une ville du sud de la France. Il prend des cours d’orthographe avec une jeune étudiante. Un jour, il est la cible d’un pédophile au scooter jaune. Apeuré, pour se défendre, il récupère le révolver de ses grands-parents, en parle à un de ses copains qui l’incite à aller, avec lui, attaquer quelques homosexuels. Puis le copain, qui garde le révolver, attaque un commerce… Quelques années plus tard, écrivain, il revient sur les lieux de son enfance.
Le narrateur donne toujours un nom aux gens qu’il rencontre. Sombre, c’est lui, la Ridée et le Trembloteur ses grands-parents… Des surnoms qui disent en fait la vérité profonde de ceux qu’il croise. Victime du divorce de ses parents, il se souvient des jours heureux, se dédouble parfois : je et il. Deux rencontres le marquent : celle de Clara l’étudiante, comme un premier amour inavoué, celle de Flamme, l’homosexuel, qui trouve les mots pour lui parler et le faire progresser. Grandir sans ses parents, pris dans une ville sans intérêt, solitaire, quand on est Sombre, mais qu’on va aller vers la lumière et la reconnaissance finale de l’écrivain, voilà le parcours que propose dans une écriture dépouillée et expressive ce petit roman, plus complexe qu’il n’y parait à premier regard. Complexité des thèmes qu’il aborde : solitude de l’adolescence, l’enfant victime d’un sadique, des préjugés du copain, confronté à l’homosexualité, à d’autres différences. Complexité de l’écriture, en particulier dans les incipits des chapitres, phrases courtes, groupes nominaux, allant à l’essentiel. Complexité du regard de l’adolescent sur le monde, marqué en particulier par les surnoms sans complaisance qu’il donne à son entourage. Complexité du temps qui passe, qui évoque aussi bien le passé glorieux de docker du grand père que la réussite du héros dans un domaine où on ne l’attendait pas. Le dernier chapitre, en particulier, après une belle ellipse, le conduit à décrire ce qui a changé dans cette ville du sud en quelques années.
Un beau roman dans lequel nombre d’adolescents, solitaires, mal dans leur peau, sombres eux aussi, dans des familles désaccordées, se reconnaitront, pour les inciter à réfléchir et leur donner l’espoir de la lumière à venir.