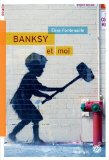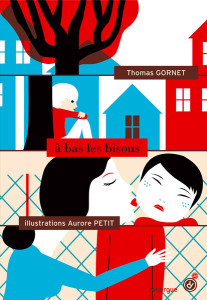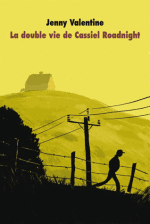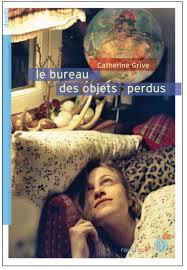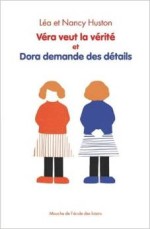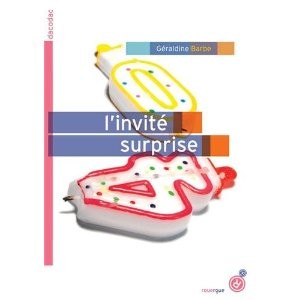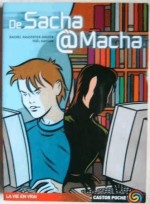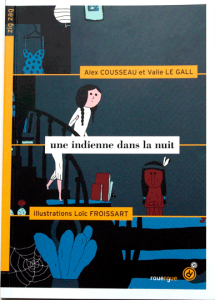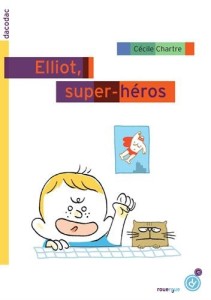La Cerise sur le gâteau – Histoires des Jean-Quelque-Chose
Jean-Philippe Arrou-Vignod
Gallimard Jeunesse
Back to the early seventies !
Par Michel Driol
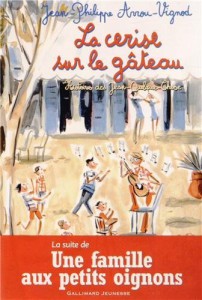 Après L’Omelette au sucre, Le Camembert Volant, La Soupe de poissons rouges et Des vacances en chocolat, voici le cinquième opus de la série des Jean-Quelque-Chose, une famille de six garçons, tous prénommés de Jean-A à Jean-F. Famille de médecin, à Toulon, en ce début des années 70 (date de sortie de Les diamants sont éternels), où on lit encore Spirou et le Club des Cinq, où on regarde Chapeau melon et bottes de cuir. Chronique familiale, sous la férule d’un père qui menace d’envoyer tout le monde aux enfants de troupe, tandis qu’arrive l’adolescence de l’ainé, et la rencontre des deux plus grands avec les filles. Car, à l’époque, la mixité fait juste son apparition dans notre système éducatif. Le narrateur – le second de la fratrie – observe non sans ironie le rêve de son grand frère de devenir idole des jeunes, alors que lui-même se voit en futur agent secret. Première guitare, pantalons patte d’eph, première boum, messe du dimanche et initiation sexuelle au restaurant… tout cela a un côté nostalgique et retro, permettant de mesurer à quel point la société a changé, en particulier sur le plan de la place et de la vision des femmes (par le père, en particulier)…
Après L’Omelette au sucre, Le Camembert Volant, La Soupe de poissons rouges et Des vacances en chocolat, voici le cinquième opus de la série des Jean-Quelque-Chose, une famille de six garçons, tous prénommés de Jean-A à Jean-F. Famille de médecin, à Toulon, en ce début des années 70 (date de sortie de Les diamants sont éternels), où on lit encore Spirou et le Club des Cinq, où on regarde Chapeau melon et bottes de cuir. Chronique familiale, sous la férule d’un père qui menace d’envoyer tout le monde aux enfants de troupe, tandis qu’arrive l’adolescence de l’ainé, et la rencontre des deux plus grands avec les filles. Car, à l’époque, la mixité fait juste son apparition dans notre système éducatif. Le narrateur – le second de la fratrie – observe non sans ironie le rêve de son grand frère de devenir idole des jeunes, alors que lui-même se voit en futur agent secret. Première guitare, pantalons patte d’eph, première boum, messe du dimanche et initiation sexuelle au restaurant… tout cela a un côté nostalgique et retro, permettant de mesurer à quel point la société a changé, en particulier sur le plan de la place et de la vision des femmes (par le père, en particulier)…
Cette chronique – dans laquelle on retrouve des éléments très autobiographiques – favorisera une lecture distanciée par jeunes lecteurs actuels, qui y trouveront, un peu comme dans Avant la télé, d’Yvan Pommaux, des traces d’un mode de vie qui n’est plus. Ils y apprécieront peut-être aussi, en particulier dans la dernière scène, ce qu’est une famille unie, loin des consoles de jeu qui individualisent, autour d’un baby-foot.
Familles nombreuses, je vous aime, même si c’est difficile d’y trouver sa place !