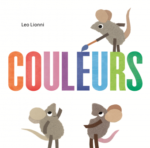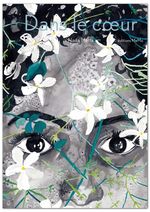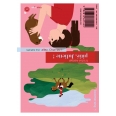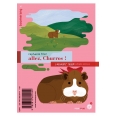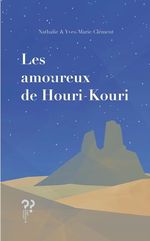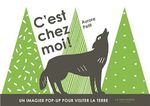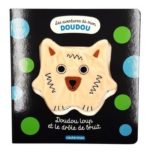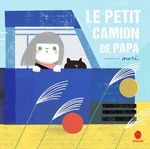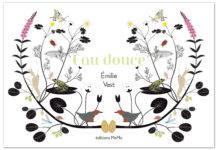Qui a peur de la peur ?
Milada Rezkovà (texte), Lukàš Urbanek, Jakub Kaše (ill.)
Traduit (tchèque) par Eurydice Antolin
Helvetiq, 2021
Une émotion vue dans les grandes largeurs (et en détail)
Par Anne-Marie Mercier
 On trouve de nombreux livres plus ou moins bien faits sur les émotions, mais rarement un projet aussi élaboré et aussi abouti. Il est fait autant pour l’enfant que pour les adultes qui cherchent à l’éduquer et le rassurer, contrairement à la plupart, qui sont des livres conçus comme des supports d’éducation ou d’enseignement, et non comme des objets de plaisir, de curiosité, de réflexion et de jeu.
On trouve de nombreux livres plus ou moins bien faits sur les émotions, mais rarement un projet aussi élaboré et aussi abouti. Il est fait autant pour l’enfant que pour les adultes qui cherchent à l’éduquer et le rassurer, contrairement à la plupart, qui sont des livres conçus comme des supports d’éducation ou d’enseignement, et non comme des objets de plaisir, de curiosité, de réflexion et de jeu.
Pas de pensée simplette ici : la peur est montrée comme un phénomène normal, naturel, qui touche tout le monde, même les adultes et les animaux. On apprend comment elle fonctionne, en quoi elle est nécessaire pour la survie, comment elle évolue avec l’âge et les expériences, comment elle diffère selon les individus, quelles phobies diverses peuvent affecter certains…
Mais ce parcours n’a rien d’un livre encyclopédique ardu car il sollicite sans cesse son lecteur par le jeu, l’imagination, la création (plusieurs pages vierges sont proposées pour y dessiner ou écrire comment on se représente la peur, ce qu’on en a vécu comme expérience). La peur elle-même s’adresse au lecteur, consciente de son rôle et montrant qu’il ne faut pas la craindre, mais la comprendre. Elle introduit le lecteur à toutes ses nuances (appréhension, anxiété, nervosité…) ; le vocabulaire est d’une extrême richesse et la traduction (du tchèque) d’un grand naturel. La peur donne aussi des secrets et petits trucs pratiques pour dompter ou contourner ses peurs.
Les illustrations sont souvent cocasses, parfois belles, elles sont dues à deux graphistes pragois. De courtes bandes dessinées proposent des situations bien connues des enfants et adolescents (par exemple la crainte de faire un exposé en classe). Le choix de gros caractères et d’images en grand format rend l’ouvrage facile à lire à plusieurs.
C’est donc le livre parfait pour tout comprendre de la peur, chez soi ou à l’école, débattre sans crainte, grandir sans appréhension. Et que de choses on y apprend (tiens, saviez-vous que les requins ont peur des dauphins ?).
Une critique et des images à lire et voir sur mômes.net