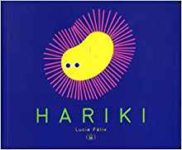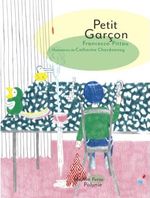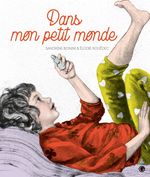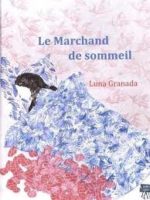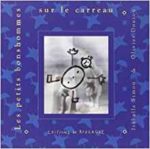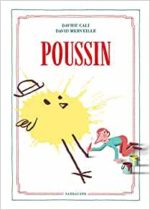La Seizième clé
Eric Senabre
Didier jeunesse (romans), 2019
Seize ans de solitude
Par Anne-Marie Mercier
 La seizième clé, c’est celle qui ouvre la porte des seize ans, autant dire de la connaissance, de l’émancipation, de la rencontre amoureuse. Mais chez Eric Senabre, cette porte n’est pas qu’une métaphore, ni la maison qui l’entoure. Elle est le support d’une intrigue complexe et se trouve, avec les quinze autres portes qui jouent comme elle un rôle dans les cérémonies d’anniversaire, dans une salle qui occupe le centre d’une maison si immense qu’elle semble infinie, labyrinthique, coupée du monde par une vaste forêt.
La seizième clé, c’est celle qui ouvre la porte des seize ans, autant dire de la connaissance, de l’émancipation, de la rencontre amoureuse. Mais chez Eric Senabre, cette porte n’est pas qu’une métaphore, ni la maison qui l’entoure. Elle est le support d’une intrigue complexe et se trouve, avec les quinze autres portes qui jouent comme elle un rôle dans les cérémonies d’anniversaire, dans une salle qui occupe le centre d’une maison si immense qu’elle semble infinie, labyrinthique, coupée du monde par une vaste forêt.
La forêt interdite, la clé de la porte interdite… on aura reconnu des thèmes de contes de fées ; d’autres genres sont convoqués, qui tirent davantage le récit vers le fantastique ou le roman à énigme : le héros est seul dans cette maison, uniquement entouré de gouvernantes et de précepteurs à son service, et gardé par de mystérieux serviteurs, les « Ratels », qui ne semblent pas tout à fait humains. On lui dit qu’il souffre d’un grave problème de santé qui a obligé ses parents à le mettre ainsi à l’abri. Génie bien entouré, il peut cultiver librement son talent pour la poésie et commente ainsi en vers ce qu’il vit et ce qui l’inspire, tout au long du roman, en toutes circonstances, même les plus dangereuses ; cela donne dans le roman de nombreux passages versifiés.
Prison dorée, où tout se plie à son caprice, la maison (on pense à La Maison sans pareil, merveilleux roman de lieux en expansion) devient une prison lorsqu’il rencontre une fille âgée d’un an de plus que lui qui lui conseille de fuir avant son seizième anniversaire et de ne surtout pas franchir cette porte…
Roman complexe et bien écrit, qui plie et déplie l’espace et le temps, c’est aussi le récit d’une aventure trépidante et semée d’embuches, et une belle histoire d’amitié – ou plus.
http://www.lietje.fr/wp-admin/post.php?post=4534&action=edit&classic-editor