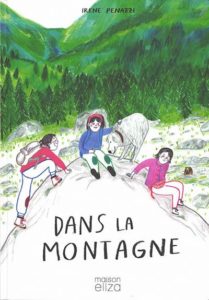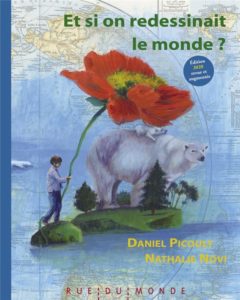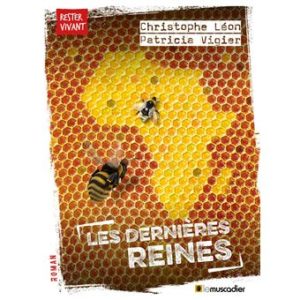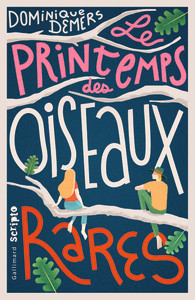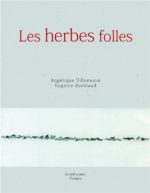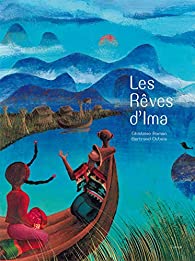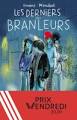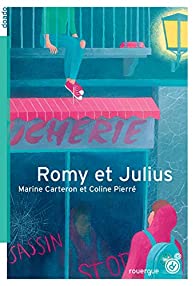Old soul
Nancy Guilbert,
Editions courtes et longues, 2021
« La résilience, c’est l’art de naviguer dans les torrents » Boris Cyrulnick
Maryse Vuillermet
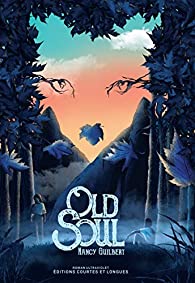 Ce roman choral a une unité de lieux : une région du Canada, sauvage, boisée, qui est encore traversée par des loups, des orignaux, et qui conserve la mémoire des Nations premières.
Ce roman choral a une unité de lieux : une région du Canada, sauvage, boisée, qui est encore traversée par des loups, des orignaux, et qui conserve la mémoire des Nations premières.
Les personnages, Brindille, Will, Emâ et Mahikan ont en commun un abîme de souffrance. Ils s’expriment tour à tour. Brindille vit dans une famille recomposée, avec sa mère, son petit frère aveugle, son beau-père et son demi-frère. Elle et son petit frère sont humiliés, frappés par leur beau-père et leur demi-frère. Elle tente de protéger son petit frère aveugle, comme elle peut. Sa mère, qui a épousé sur un coup de tête, cet homme cruel et est venue habiter avec lui et son fils, fait semblant de ne rien voir, et même quand Brindille se plaint, refuse d’intervenir. Will est un jeune infirmier dans un service pédiatrique où les enfants malades ou grands-prématurés sont pris en charge. Emâ vient de France, elle est soignante dans un parc animalier qui protège les loups, elle est passionnée de ces animaux élégants, solidaires et fidèles. Elle tient un blog où elle raconte sa vie avec eux, on ne sait pas pourquoi elle est venue de si loin. Mahikan est un jeune Amérindien, qui, pour ne pas aller à la pension des Blancs, des centres de redressement qui inculquent aux Amérindiens la honte de leur culture, a fui sa famille et vit dans la forêt. Il a aménagé une grotte et rencontre parfois un loup solitaire qu’il nourrit.
Vous comprenez donc que le thème est la fuite et la quête de l’amour pour tous ces jeunes malmenés, frappés par des adultes violents ou abandonnés par leurs parents, en effet, aucun ne se laisse détruire. Tous sont passionnés par la nature, les animaux ou encore les tout petits êtres qu’on croit incapables de communiquer, comme les bébés. Brindille et son petit frère connaissent très bien les oiseaux, leur chant, leurs couleurs, leur habitat, Emâ est une spécialiste des loups et Mahikan a hérité de son grand-père la connaissance des animaux, de leur mode de vie et un certain animisme, une façon de communiquer avec eux. Will est passionné par son métier, les enfants malades et se prend d’une immense affection pour un bébé abandonné. Lui aussi, à sa manière, prouve qu’on peut communiquer avec les tout petits bébés, même très prématurés et que, dès cet âge, l’amour est nécessaire à leur survie.
Ces passions les aident à vivre, à prendre des décisions et les consolent de leurs souffrances. Dans leur quête, ils ont parfois des personnages tutélaires, grands-pères, pères, souvenirs vagues d’une mère ou des esprits qui les protègent.
Brindille va avoir le courage de fuir avec son petit frère. Mohikan s’est échappé dans la forêt mais rôde autour de la pension pour Amérindiens en veillant de loin sur ses plus jeunes frères et sœurs qui y sont enfermés. Emma en soignant les loups, en parcourant leur domaine, en tentant de les protéger des braconniers et des chasseurs stupides, se répare aussi. On comprend que Will, en veillant sur le bébé, revit son propre passé mais il en change la perception aussi.
L’ensemble est très vivant, parce qu’on a les points de vue des quatre personnages, donc leurs quatre univers, mais aussi une grande variété d’énoncés : des extraits de blog avec commentaires d’Emâ, des extraits de chansons, des extraits du journal de naissance que Will écrit pour que le bébé, pour qu’elle garde la mémoire de ses premiers jours, des extraits de prières et des mots du lexique Atikamekw avec leur traduction…
A la fin, les histoires des quatre personnages se relient, et c’est encore une belle surprise.