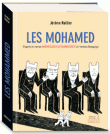Asdiwal, l’indien qui avait faim tout le temps
Manchette et Loustal
Gallimard jeunesse, 2011
Par Marianne Mondel (Master MESFC Lyon 1)
 Quelle caractéristique incarne le mieux notre jeune héros Asdiwal ? Son incommensurable appétit bien sûr ! C’est durant l’été 1966 que ce personnage a été mis en scène par un père pour son fils, alors en vacances en Provence loin de lui, à Paris. Cette œuvre est la première et seule incursion de Manchette au sein de la littérature de jeunesse. Lorsque que l’on songe à cet auteur, polyvalent dans ses fonctions de critique littéraire et de cinéma, scénariste et dialoguiste, traducteur, et surtout père de nombreux romans policiers, on aurait tendance à penser noirceur, violence, crimes… mais bien au contraire, le ton reste résolument comique et décalé !
Quelle caractéristique incarne le mieux notre jeune héros Asdiwal ? Son incommensurable appétit bien sûr ! C’est durant l’été 1966 que ce personnage a été mis en scène par un père pour son fils, alors en vacances en Provence loin de lui, à Paris. Cette œuvre est la première et seule incursion de Manchette au sein de la littérature de jeunesse. Lorsque que l’on songe à cet auteur, polyvalent dans ses fonctions de critique littéraire et de cinéma, scénariste et dialoguiste, traducteur, et surtout père de nombreux romans policiers, on aurait tendance à penser noirceur, violence, crimes… mais bien au contraire, le ton reste résolument comique et décalé !
Malgré une histoire semblant sortir tout droit de l’imagination de son auteur, les indiens Tsimshian, peuple d’Asdiwal, existent bel et bien dans de lointaines contrées. Ce dernier fait figure de héros dans leur mythologie. Manchette puise ses sources dans le l’ethnologie des peuples amérindiens, connue chez nous depuis Claude Lévi-Strauss (ASDIWAL est le nom d’une revue d’anthropologie et d’histoire des religions).
La langue employée par l’auteur est très inventive et frappe le lecteur par sa vivacité et son naturel. Celui-ci s’adresse ainsi aux enfants en s’exprimant comme eux. Les répétitions sont un élément récurrent qui accroche le petit lecteur à l’ouvrage. Manchette joue joyeusement entre le réel et le fantastique, nous entrainant doucement dans l’imaginaire. La dynamique de l’œuvre par ses enchainements d’actions entraîne attention et réflexion. Le loufoque pointe le bout de son nez par la succession brutale des évènements, sans beaucoup de transition ou de logique. Les dessins, quant à eux, accrochent l’œil par la vivacité des couleurs et l’impression de mouvement qui s’en dégage.
L’attachement à ces petits indiens ne parvenant plus à voir leurs mocassins, dissimulés par un ventre grassouillet, est inévitable. Ce joyeux bazar indéniablement original permet une fin heureuse à Asdiwal, devenant un mari comblé… et obèse !

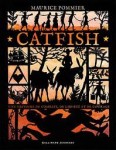
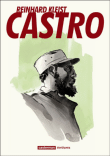
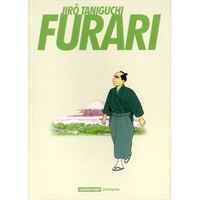
 C’est une « mini BD », et pourtant il y a une foule d’histoires et de jeux : d’abord l’histoire de Hansel et Gretel, racontée par Louisette la taupe, héroïne de la série (9 volumes parus), puis celle des trois jeunes lapins kidnappés par une belette qui veut réécrire cette histoire à son profit, et celle des sauveteurs qui se déguisent en renard pour les délivrer. On pense à Sylvain et Sylvette : un décor réduit, la maison, la forêt, le stupide ennemi. On pense aussi aux Musiciens de Brême, petits animaux unis contre un plus gros.
C’est une « mini BD », et pourtant il y a une foule d’histoires et de jeux : d’abord l’histoire de Hansel et Gretel, racontée par Louisette la taupe, héroïne de la série (9 volumes parus), puis celle des trois jeunes lapins kidnappés par une belette qui veut réécrire cette histoire à son profit, et celle des sauveteurs qui se déguisent en renard pour les délivrer. On pense à Sylvain et Sylvette : un décor réduit, la maison, la forêt, le stupide ennemi. On pense aussi aux Musiciens de Brême, petits animaux unis contre un plus gros. Les « grands soldats », ce sont des hommes de plus d’1m 88 que Frédéric Guillaume Ier de Prusse faisait recruter – et parfois enlever – à travers l’Europe au 18e siècle pour former sa garde personnelle, avec des tentatives pour les faire se reproduire avec de très grandes femmes choisies pour cela… ce qui évoque d’autres « recherches » sinistres du même type. On trouve le détail de tout cela dans l’Histoire de Frédéric II de Carlyle (ch. 5) ; quant au présent album, un texte final précise sa dimension historique. Cette BD ou roman graphique présente l’histoire de l’un de ces soldats, un géant irlandais de la côte ouest, Cathal Crann. C’est un bon gars, presque un simplet, tant qu’on ne le « cherche » pas, un prototype de « quiet man » irlandais. Dans le cas contraire, sa fureur le métamorphose en monstre. Le chien rouge qui se manifeste alors, en lui et hors de lui, est à la fois une métaphore et une réalité, donnant à l’histoire une allure fantastique. On y voit ce qui est sans doute le début de ses aventures : son enrôlement ou plutôt son enlèvement, son installation à Potsdam, ses rencontres, ses amours, une tentative d’assassinat, sa désertion…
Les « grands soldats », ce sont des hommes de plus d’1m 88 que Frédéric Guillaume Ier de Prusse faisait recruter – et parfois enlever – à travers l’Europe au 18e siècle pour former sa garde personnelle, avec des tentatives pour les faire se reproduire avec de très grandes femmes choisies pour cela… ce qui évoque d’autres « recherches » sinistres du même type. On trouve le détail de tout cela dans l’Histoire de Frédéric II de Carlyle (ch. 5) ; quant au présent album, un texte final précise sa dimension historique. Cette BD ou roman graphique présente l’histoire de l’un de ces soldats, un géant irlandais de la côte ouest, Cathal Crann. C’est un bon gars, presque un simplet, tant qu’on ne le « cherche » pas, un prototype de « quiet man » irlandais. Dans le cas contraire, sa fureur le métamorphose en monstre. Le chien rouge qui se manifeste alors, en lui et hors de lui, est à la fois une métaphore et une réalité, donnant à l’histoire une allure fantastique. On y voit ce qui est sans doute le début de ses aventures : son enrôlement ou plutôt son enlèvement, son installation à Potsdam, ses rencontres, ses amours, une tentative d’assassinat, sa désertion… Angie, c’est le titre d’une chanson des Stones, une chanson sur un amour perdu. Le personnage de ce court roman graphique s’appelle Angie Monde, tout un programme. Et c’est bien une part du monde qu’elle représente. Elle est dans un lit d’hôpital. A son chevet, un policier, Etienne Bufka, attend qu’elle parle et qu’elle explique. Il est question de choses graves : de la trahison en amour, du désarroi des très jeunes filles (Angie a tout juste 15 ans) devant une grossesse inattendue, non voulue, du déni, et de ce qui s’ensuit ; plus largement il est question d’enfances à la dérive, d’adolescents trop seuls qui vivent « comme des grands » mais sont incapables d’être adultes. « C’est la vie qui est terrible », dit l’inspecteur à celle qui reste au niveau du fait divers
Angie, c’est le titre d’une chanson des Stones, une chanson sur un amour perdu. Le personnage de ce court roman graphique s’appelle Angie Monde, tout un programme. Et c’est bien une part du monde qu’elle représente. Elle est dans un lit d’hôpital. A son chevet, un policier, Etienne Bufka, attend qu’elle parle et qu’elle explique. Il est question de choses graves : de la trahison en amour, du désarroi des très jeunes filles (Angie a tout juste 15 ans) devant une grossesse inattendue, non voulue, du déni, et de ce qui s’ensuit ; plus largement il est question d’enfances à la dérive, d’adolescents trop seuls qui vivent « comme des grands » mais sont incapables d’être adultes. « C’est la vie qui est terrible », dit l’inspecteur à celle qui reste au niveau du fait divers Lors d’une même nuit moyenâgeuse, une femme raconte une légende à son enfant et attend son amant, un garde scrute l’obscurité du haut des remparts, les fantômes dansent et plaisantent dans le cimetière, un chevalier, seigneur du château où vivent (ou pas) tous ces êtres, rentre de guerre et hésite entre le suicide et le retour ; des hommes complotent, une sorcière joue…
Lors d’une même nuit moyenâgeuse, une femme raconte une légende à son enfant et attend son amant, un garde scrute l’obscurité du haut des remparts, les fantômes dansent et plaisantent dans le cimetière, un chevalier, seigneur du château où vivent (ou pas) tous ces êtres, rentre de guerre et hésite entre le suicide et le retour ; des hommes complotent, une sorcière joue…