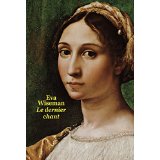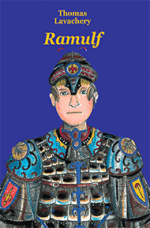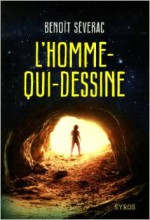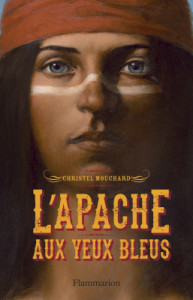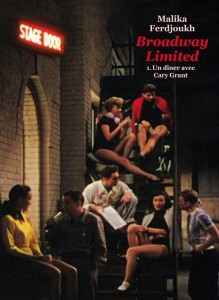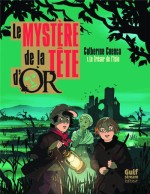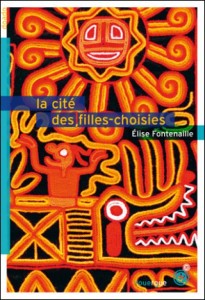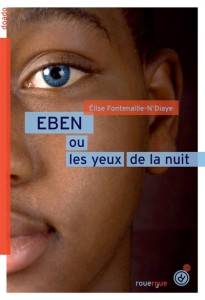J’ai fui l’Allemagne nazie. Journal d’Ilse, 1938-1939
Yaël Hassan
Gallimard (« Folio junior », « Mon histoire »), 2015
Sissi, Journal d’Élisabeth, future impératrice d’Autriche, 1853-1855
Catherine de Lasa
Gallimard (« Folio junior », « Mon histoire »), 2015
Grande Histoire et petits histoires d’adolescentes
Par Anne-Marie Mercier
La collection « mon histoire » de folio junior se refait une jeunesse (notons que les nouvelles maquettes n’apparaissent pas encore dans le catalogue sur le site de cet éditeur :
Ces deux rééditions montrent en partie les deux voies que suit cette collection. Le principe général est de raconter la grande histoire à travers la petite, grâce au témoignage d’un personnage enfant ou adolescent (j’avais beaucoup apprécié l’histoire de l’apprenti de Gutenberg). Parfois le personnage (féminin, ce qui donne un point de vue de coulisse) est proche des sphères du pouvoir, dans d’autres cas (on y trouve davantage de garçons) il est en situation précaire et lutte pour sa survie. Catherine de Lasa (voir chronique suivante) s’est fait une spécialité de la première, Isabelle Duquesnoy également pour certaines de ses œuvres. Yaël Hassan explore plutôt la deuxième voie.
Le Journal d’Ilse est un beau roman, intéressant (une histoire ahurissante et peu connue, celle du bateau Le Saint-Louis qui transportait des juifs allemands vers Cuba entre 1938 et 1939, destination qu’il s n’atteindront pas. Mais le récit commence bien avant, lors de la « Nuit de cristal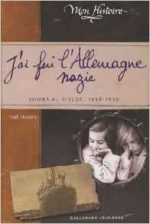 ». L’auteure prend donc soin de justifier la tenue de cet écrit particulier : Ilse écrit pour conjurer la peur qui s’est installée dans sa famille. Elle donne à son récit un rythme irrégulier, ponctué de temps forts, de moments d’abattement, de retour sur soi, ou de long silences dont on apprend un peu plus tard la raison. Les émotions d’Isle, ses espoirs et ses déceptions, ses rencontres qui développent des histoires qui auraient pu être d’amour en d’autres temps ou d’amitiés trahies ou fidèles permettent d’incarner bellement le récit historique et faire saisir de l’intérieur ce qu’on peut éprouver quand notre communauté est mis au ban de l’humanité.
». L’auteure prend donc soin de justifier la tenue de cet écrit particulier : Ilse écrit pour conjurer la peur qui s’est installée dans sa famille. Elle donne à son récit un rythme irrégulier, ponctué de temps forts, de moments d’abattement, de retour sur soi, ou de long silences dont on apprend un peu plus tard la raison. Les émotions d’Isle, ses espoirs et ses déceptions, ses rencontres qui développent des histoires qui auraient pu être d’amour en d’autres temps ou d’amitiés trahies ou fidèles permettent d’incarner bellement le récit historique et faire saisir de l’intérieur ce qu’on peut éprouver quand notre communauté est mis au ban de l’humanité.