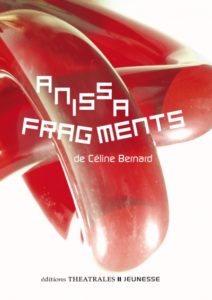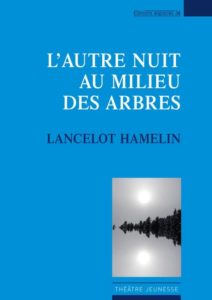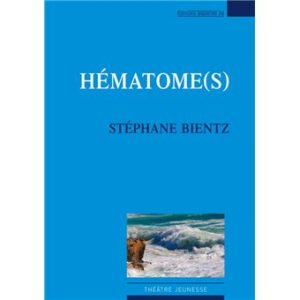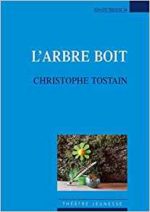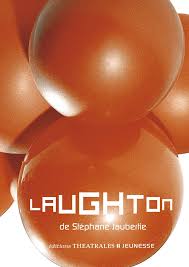Anissa / Fragments
Céline Bernard
Editions Théâtrales jeunesse 2019
Fini la docilité
Par Michel Driol
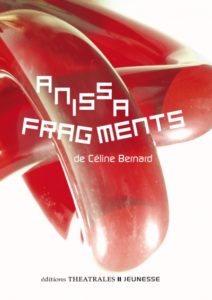 Une classe de lycée, d’où se dégagent quelques individualités : Sandrine qui vit chez sa grand-mère, faute d’argent pour payer l’internat, Léa qui découvre l’amour et son identité sexuelle, Anissa, mineure isolée sans papier, qui, à la suite d’un test osseux, est menacée de devoir quitter le territoire. Que faire face à ce cas ? Ne pas s’en mêler ? Lui venir en aide ? A l’heure où l’on doit faire des vœux sur une fiche d’orientation, engager sa vie, s’engager tout simplement.
Une classe de lycée, d’où se dégagent quelques individualités : Sandrine qui vit chez sa grand-mère, faute d’argent pour payer l’internat, Léa qui découvre l’amour et son identité sexuelle, Anissa, mineure isolée sans papier, qui, à la suite d’un test osseux, est menacée de devoir quitter le territoire. Que faire face à ce cas ? Ne pas s’en mêler ? Lui venir en aide ? A l’heure où l’on doit faire des vœux sur une fiche d’orientation, engager sa vie, s’engager tout simplement.
Céline Bernard propose un texte fort, issu d’une commande d’écriture pour un groupe d’adolescents dans un atelier théâtre. Elle réunit ainsi un chœur d’ados, qui peut aussi jouer tous les autres personnages (la prof principale, des parents, une éducatrice, un médecin, des policiers…). Le texte fait alterner des scènes chorales (chœur à géométrie variable, laissant grande latitude pour la distribution) et des scènes plus dialoguées de façon classique. Les scènes chorales sont écrites dans une langue poétique et métaphorique particulièrement travaillée : rythme, longueur des « répliques », faisant alterner doutes, certitudes, inquiétudes et injonctions diverses dans la scène d’ouverture construite autour des réactions face à la fiche d’orientation et ce qu’elle engage de futur et d’interrogations. Les scènes dialoguées plongent dans des univers extrêmement variés : scène de petit déjeuner familial, interrogatoire d’Anissa par la police ou le médecin… Mais, même dans ces scènes, le chœur d’ados n’est jamais loin.
Le texte est découpé en quatre mouvements porteurs de la dynamique de la pièce : disparaitre, subir, désobéir, s’enflammer, construisant ainsi comme la naissance d’une prise de conscience et d’un être différent au monde que l’on voudrait changer et dans lequel des solidarités nouvelles sont possibles.
Fragments, cela renvoie à la technique dramatique parfaitement maitrisée : des scènes courtes et des histoires individuelles déconstruites, apparaissant en lambeaux et laissant au spectateur et au chœur le loisir d’établir les liens dans ce qui apparait quelque part comme une enquête à partir de la disparition d’Anissa dont on découvre quelques épisodes de la vie : la mort de la grand-mère, qu’elle va enterrer seule, le voyage – cheveux rasés pour se faire passer pour un garçon – les hôtels, et, pour finir, la brutalité et la violence des interrogatoires médicaux et policiers.
Rien de manichéen dans ce texte : les ados ne sont pas unanimes quant à la nécessité de la solidarité envers Anissa, les adultes sont positifs, comme la prof principale, dépassés comme l’éducatrice, protecteurs comme les parents, trop zélés et sûrs d’eux comme le médecin.
Un superbe texte très contemporain dans sa forme et dans sa langue, mais aussi quant à ce qu’il dit de notre époque, pour évoquer une problématique très actuelle, avec beaucoup d’humanité, un texte finalement optimiste et plein d’espoir dans la jeunesse et sa capacité à se mobiliser et à faire preuve de maturité et d’enthousiasme.
 Neuf tableaux pour évoquer le destin de Zou et de ses deux frères. Dernier d’une fratrie de trois, Zou part aussi tenter sa chance en Europe. Neuf tableaux dans lequel ses frères lui racontent leur mort, l’un sur un bateau, l’autre dans le tunnel sous la Manche, neuf tableaux où on voit sa mère lui tricoter son costume de clown, car à quoi bon être invisible pour passer les frontières ? Neuf tableaux qui culminent à la mort de la mère, tandis que Zou remet son nez rouge…
Neuf tableaux pour évoquer le destin de Zou et de ses deux frères. Dernier d’une fratrie de trois, Zou part aussi tenter sa chance en Europe. Neuf tableaux dans lequel ses frères lui racontent leur mort, l’un sur un bateau, l’autre dans le tunnel sous la Manche, neuf tableaux où on voit sa mère lui tricoter son costume de clown, car à quoi bon être invisible pour passer les frontières ? Neuf tableaux qui culminent à la mort de la mère, tandis que Zou remet son nez rouge…