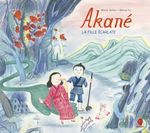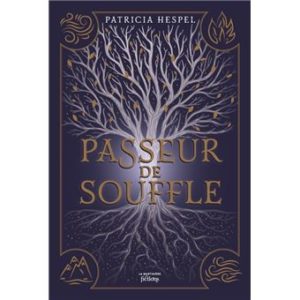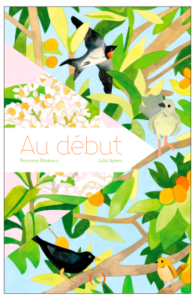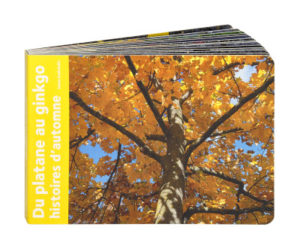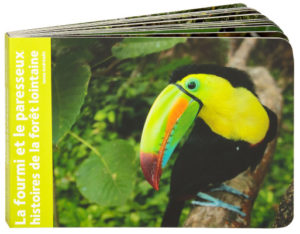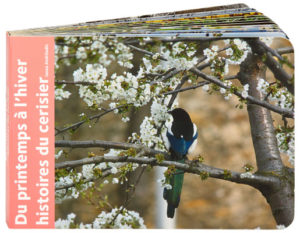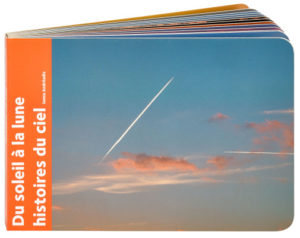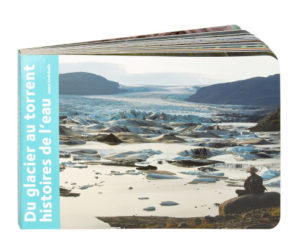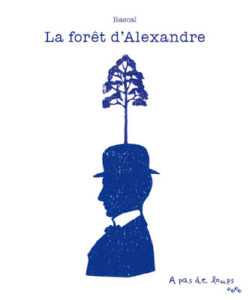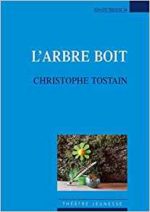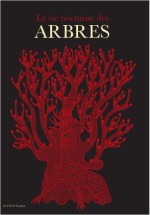Alice et le séquoia géant
Sébastien Gayet – Illustrations de Joséphine Forme
Editions du Pourquoi pas 2024
Du pouvoir des arbres
Par Michel Driol
 Depuis la mort de sa mère, Alice est élevée par son père, qui n’a d’autre solution que la mettre en colo durant le mois de juillet. Mais, depuis ce décès, Alice est perturbée, solitaire. Dès le premier soir de son séjour, elle disparait, on ne sait où. Nuit après nuit, Alice se réfugie auprès d’un séquoia géant du parc, dans les branches duquel elle se réfugie, et qui lui permet, enfin, de se sentir bien.
Depuis la mort de sa mère, Alice est élevée par son père, qui n’a d’autre solution que la mettre en colo durant le mois de juillet. Mais, depuis ce décès, Alice est perturbée, solitaire. Dès le premier soir de son séjour, elle disparait, on ne sait où. Nuit après nuit, Alice se réfugie auprès d’un séquoia géant du parc, dans les branches duquel elle se réfugie, et qui lui permet, enfin, de se sentir bien.
En quatre chapitres, Sébastien Gayet brosse avec tendresse le portrait d’une Alice dans un pays de merveilles, fuyant un réel trop difficile à supporter pour se réfugier dans la nature, près d’un arbre consolateur, arbre dont on découvre à la fin qu’il abrite toute une forme de vies invisibles, mais pourtant bien présentes. Arbre qui, comme chez Lewis Carroll, est creux, mais ce n’est pas par son trou qu’il sera lieu de passage. Le récit touche à l’imaginaire et au merveilleux par un autre biais, lorsqu’Alice découvre que le nom de l’arbre est l’exacte anagramme du prénom de sa mère, donnant ainsi tout son sens à ce lien mystérieux. Lien fait d’une double protection, celle de l’arbre, qui protège Alice contre ses angoisses, celle d’Alice, qui se veut protectrice aussi de ce bon gros géant. Le récit, plein de poésie, suit Alice au plus près de ses pensées, de ses sensations (celles des doigts contre l’écorce), de sa façon de communiquer avec l’arbre. Mais le récit vaut aussi par la bulle protectrice qui s’établit autour d’Alice, dans le parc – bien réel du Château de Soubeyran, où se déroulent les colonies de vacances de la FOL de l’Ardèche – , mais aussi avec le personnage de la directrice et celui du père, personnages bienveillants en retrait, qui semblent avoir tout compris des escapades d’Alice et de son attachement pour l’arbre.
Les illustrations de Joséphine Forme magnifient le bleu nuit, ou celui de l’heure bleue qui sert de cadre au récit. Principalement sous forme de strips, elles s’attachent à montrer la fillette sous différents aspects, ses angoisses dans sa chambre, sa découverte de l’arbre, son escalade, toujours plus haut, jouant sur les contrastes entre l’immensité de l’arbre et la petitesse de l’enfant, entre le blanc de ses vêtements et le sombre de la nuit, jouant aussi sur les cadrages, et les contre plongées pour montrer le ciel.
Que ce soit dans la réalité (construction de cabanes, exploration des branches, accrobranche…) ou dans la fiction (les arbres-maisons chez Ponti, le Baron perché…), les enfants entretiennent des rapports particuliers avec les arbres. Evitant les écueils de la sylvothérapie, le récit s’inscrit plutôt dans une poétique de l’arbre, opposant sa verticalité, sa façon de joindre la terre et le ciel, son immensité à la petitesse et à la finitude humaine. Il aborde aussi, avec beaucoup de délicatesse et de pudeur, la question du deuil d’un parent chez les enfants.