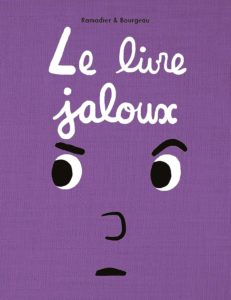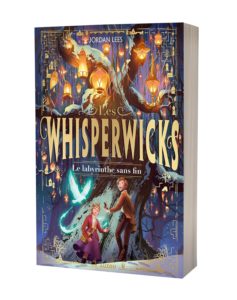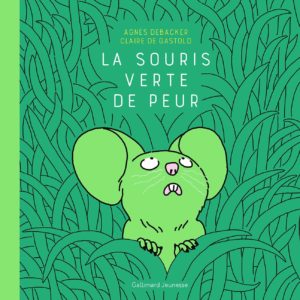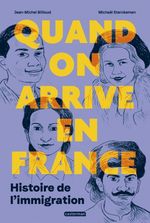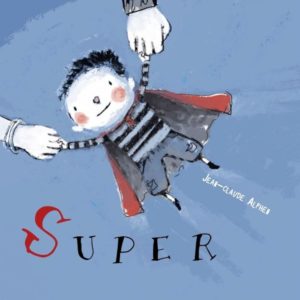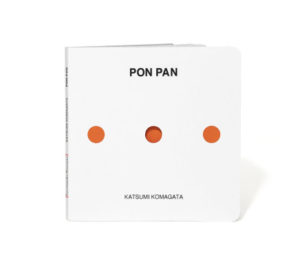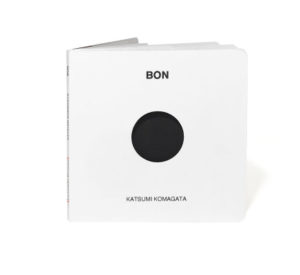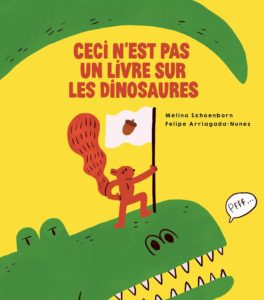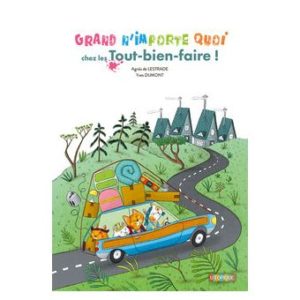Les Aventures farfelues de dix chaussettes perdues (quatre droites et six gauches)
Justyna Bednarek, Daniel de Latour (ill.)
Traduit (polonais) par Lydia Waleryszak
Helium, 2024
Chaussettes en liberté !
Par Anne-Marie Mercier
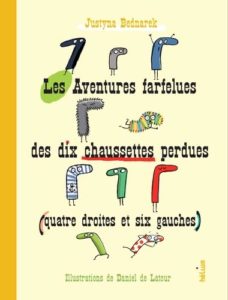 Où vont les chaussettes qui disparaissent, remplissant nos placards de chaussettes « veuves » ou « célibataires »? Ce grand mystère existentiel, question que tout le monde ou presque se pose, trouve une réponse dans ce livre : il y a un trou sous les machines par lequel les chaussettes, en quête d’aventures, de consolation, de célébrité ou de bien d’autres choses s’enfuient.
Où vont les chaussettes qui disparaissent, remplissant nos placards de chaussettes « veuves » ou « célibataires »? Ce grand mystère existentiel, question que tout le monde ou presque se pose, trouve une réponse dans ce livre : il y a un trou sous les machines par lequel les chaussettes, en quête d’aventures, de consolation, de célébrité ou de bien d’autres choses s’enfuient.
Après un prologue résumant cette vérité fondamentale, dix histoires illustrent la question : selon leurs couleurs et leurs motifs, selon qu’elles sont de fil, de laine ou de soie, chaussette droite ou chaussette gauche, neuve ou vieille, les chaussettes ont une personnalité et même un destin quand elles décident de se l’inventer. Certaines restent chaussettes mais couvrent des pieds plus intéressants, une autre devient nounou d’une famille de souris, une autre conseillère royale, ou détective privée, ou animatrice dans un service d’enfants malades, ou devient morceau de pull… une autre rentre à la maison pour retrouver sa jumelle.
C’est drôle, surprenant, plein d’invention, bien raconté et bien traduit et les illustrations sont cocasses à souhait, transformant toutes ces chaussettes en héroïnes d’histoires en tous genres. Les recueils de nouvelles sont rares en littérature de jeunesse. Celui-ci part d’une belle idée, très originale, et illustre bien ce genre.