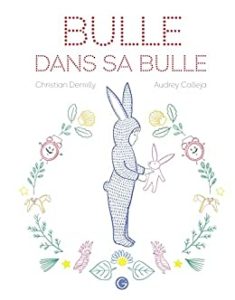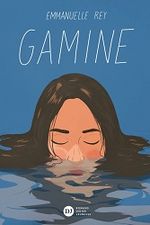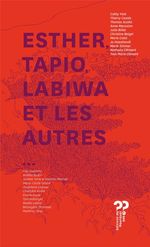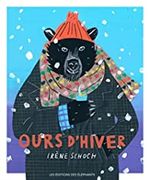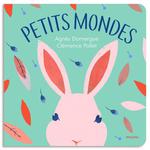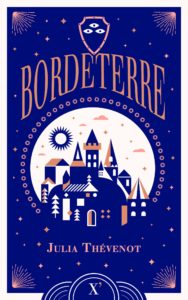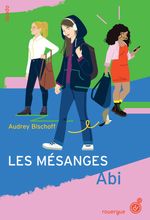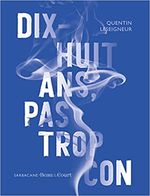La Peinture de Yulu
Cao Wenxuan – Suzy Lee
Rue du monde 2022
Ode à la persévérance
Par Michel Driol
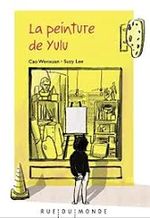 Yulu sera artiste-peintre, ainsi l’ont décidé ses parents. Jusqu’à 8 ans, c’est son père qui lui enseigne la peinture, puis ce sont les plus grands artistes. Lorsque le moment est venu de faire peindre à Yulu son premier autoportrait, on va acheter la toile de lin la plus parfaite, celle qui était promise à un très grand peintre décédé la veille. Yulu réalise son autoportrait, mais, le lendemain matin, le tableau est devenu informe. Et ce phénomène se reproduit 7 fois de suite, au point que la mère de Yulu se débarrasse de cette toile. Yulu la récupère et peint une nouvelle fois son autoportrait, jette sur lui un tissu, et l’oublie. « Mais un jour, enfin, le soleil du matin vient inonder la toile. On y voit une petite fille lumineuse qui, paisiblement, sourit. »
Yulu sera artiste-peintre, ainsi l’ont décidé ses parents. Jusqu’à 8 ans, c’est son père qui lui enseigne la peinture, puis ce sont les plus grands artistes. Lorsque le moment est venu de faire peindre à Yulu son premier autoportrait, on va acheter la toile de lin la plus parfaite, celle qui était promise à un très grand peintre décédé la veille. Yulu réalise son autoportrait, mais, le lendemain matin, le tableau est devenu informe. Et ce phénomène se reproduit 7 fois de suite, au point que la mère de Yulu se débarrasse de cette toile. Yulu la récupère et peint une nouvelle fois son autoportrait, jette sur lui un tissu, et l’oublie. « Mais un jour, enfin, le soleil du matin vient inonder la toile. On y voit une petite fille lumineuse qui, paisiblement, sourit. »
Peu connu en France, Cao Wenxuan est un auteur chinois pour la jeunesse renommé, lauréat du Prix Hans Christian Andersen en 2016, prix reçu en 2022 par Suzy Lee, illustratrice coréenne un peu plus connue en France. Rue du Monde a réuni ces deux excellents auteurs et c’est Alain Serres lui-même qui a traduit et adapté le texte. Et le résultat est de toute beauté. Des illustrations pleine page, qui s’ouvrent petit à petit à la couleur. C’est le huis-clos d’un appartement, envahi de tissus et de tableaux encadrés, huis-clos enfermant, dont on ne sort que deux fois, lorsqu’on va acheter la toile, et lorsque Yulu va la chercher dans les buissons, dans des scènes nocturnes très expressionnistes par l’éclairage et l’atmosphère. Ces illustrations, par le choix des couleurs et du cadrage, offrent un point de vue sur l’évolution de Yulu. Le texte avec poésie reprend un motif fantastique, celui de la toile ou du portrait maudit. Tout se passe ici comme si la toile voulait se venger de ne pas avoir été servie à un célèbre peintre, mais à une fillette inconnue. Toile qui met à rude épreuve la persévérance de la fillette qui, huit fois sur le métier, remettra son ouvrage. Pas de découragement, mais une volonté farouche de vaincre la matière de la toile, cet espèce de mauvais génie qui contrarie les projets que l’on a pour Yulu. Car, au fond, qui est Yulu ? Une fillette sur laquelle son père projette ses rêves, comme c’est malheureusement souvent le cas dans certaines familles. Lui qui se voulait artiste est devenu marchand de tissus… Yulu doit se couler dans le moule, dans ce que ses parents ont décidé pour elle. Mais que veut-elle vraiment ? Qui est-elle vraiment ? Docilement, elle obéit, prend des leçons, fait l’admiration de tous, jusqu’au moment où l’improbable fantastique se produit, et où Yulu devra lutter à la fois contre la mauvaise volonté de la toile, mais aussi contre la décision de sa mère de jeter la toile maudite. Réussir à peindre le tableau, c’est bien pour Yulu une façon de s’inscrire dans un chemin tracé pour elle, mais le recouvrir et l’oublier, c’est une façon de sortir de ce chemin, non pas comme un renoncement, mais plutôt comme une façon de dire qu’on a fait sa part. On laissera bien sûr chaque lecteur libre d’interpréter la belle fin, cette figure de la petite fille lumineuse, apaisée après les tourments qu’elle a traversés, et qui sourit à la vie. Suivra-t-elle le chemin tracé pour elle ? En suivra-t-elle un autre ? Ne faut-il pas laisser du temps au temps pour grandir, à son rythme, et devenir soi, avec son propre destin et ses propres rêves ?
Un album très riche, tant par la qualité de son illustration que par les thèmes qu’il aborde : aussi bien l’emprise des rêves parentaux sur le destin des enfants que la création et la nécessaire liberté de créer.
Voir la chronique d’Anne-Marie Mercier : http://www.lietje.fr/2023/09/17/la-peinture-de-yulu-2/