L’Aigle de la neuvième légion (Les Trois Légions, vol. 1)
Rosemary Sutcliff
Traduit (anglais) par Bertrand Ferrier
Gallimard jeunesse (hors série littérature), 2011
Le retour du roman historique des années 50
Par Anne-Marie Mercier
 Pour une fois, nous suivons l’actualité de près, la devançons même un peu, tout en plongeant dans l’Antiquité : le Péplum est de retour, et il est romano-Breton. Après le film Centurion de Marshal (2010) qui relatait la guerre des Romains contre les Pictes et le massacre de la 9e légion romaine, L’Aigle de la 9e légion, tiré du roman que nous évoquons ici prend son essor demain, 4 mai 2011, sur les écrans des cinémas français après avoir été un succès dans sa version originale.
Pour une fois, nous suivons l’actualité de près, la devançons même un peu, tout en plongeant dans l’Antiquité : le Péplum est de retour, et il est romano-Breton. Après le film Centurion de Marshal (2010) qui relatait la guerre des Romains contre les Pictes et le massacre de la 9e légion romaine, L’Aigle de la 9e légion, tiré du roman que nous évoquons ici prend son essor demain, 4 mai 2011, sur les écrans des cinémas français après avoir été un succès dans sa version originale.
En fait de nouveauté, c’est plutôt du réchauffé (mais du bon réchauffé !) que présentent les éditions Gallimard jeunesse en grand format, puisque le texte dont ce film est issu existait déjà en folio junior (2003), dans l’édition française d’un roman anglais publié bien plus tôt, en 1954 (The Eagle of the Ninth). C’était le premier roman de Rosemary Sutcliff qui en a publié beaucoup d’autres du même genre (jeunesse, historique, antiquités anglaises). L’auteur est une célébrité, nommée officier de l’Empire britannique grâce à son oeuvre.
On trouve ici tout le charme et tous les problèmes du roman pour adolescent de ces années là, au temps où les jeux vidéos n’existaient pas, et la télévision à peine : le joli temps où les enfants avaient encore de longues après midi de pluie devant eux pour se plonger dans des aventures héroïques. Tout en étant un récit d’aventures avec tous ses ingrédients (suspens, chasses à l’homme) c’est aussi un livre où la nature est très présente et où l’on prend le temps de s’attarder sur l’évocation de la faune et de la flore, des nuages et de la pluie. Le livre prend son temps, n‘épargne pas les descriptions et les moments d’inactivité et d’attente, pour le héros comme pour le lecteur. Il ne craint pas non plus de décevoir l’un comme l’autre. Le livre ne cherche pas à caresser dans le sens du poil : le renoncement aux rêves y est un fil rouge discret mais insistant. On sent que la guerre n’est pas très loin, dans l’esprit de l’auteur comme de ses lecteurs. C’était aussi le temps de l’innocence.
 Avant de creuser un peu cela, deux mots de l’histoire. Elle se caractérise par son caractère déceptif, dès le titre : cet aigle n’est pas un oiseau, ce n’est pas non plus la désignation du héros, c’est un objet, une aigle romaine qui guidait une légion. La 9e légion est pour les Anglais une légion mythique puisque, dit-on (mais d’autres disent que tout cela est faux…), elle disparut corps et biens au moment où les Romains, contraints d’abandonner la Caledonia, se replièrent derrière le mur d’Hadrien. Corps et biens ? Pas dans le roman, car dans cette histoire qui se passe une dizaine d’années plus tard, Marcus le romain et Esca le breton partent à la recherche de l’aigle porte étendard de la 9e, et, avec cette aigle, à la recherche d’éventuels survivants.
Avant de creuser un peu cela, deux mots de l’histoire. Elle se caractérise par son caractère déceptif, dès le titre : cet aigle n’est pas un oiseau, ce n’est pas non plus la désignation du héros, c’est un objet, une aigle romaine qui guidait une légion. La 9e légion est pour les Anglais une légion mythique puisque, dit-on (mais d’autres disent que tout cela est faux…), elle disparut corps et biens au moment où les Romains, contraints d’abandonner la Caledonia, se replièrent derrière le mur d’Hadrien. Corps et biens ? Pas dans le roman, car dans cette histoire qui se passe une dizaine d’années plus tard, Marcus le romain et Esca le breton partent à la recherche de l’aigle porte étendard de la 9e, et, avec cette aigle, à la recherche d’éventuels survivants.
Marcus est un jeune centurion dont le père appartenait à cette légion. Quête du père, donc, classique ; puis tentative de restauration de l’honneur du père, moins classique. Marcus est très vite grièvement blessé lors d’une action héroïque et en reste fortement handicapé : sa carrière militaire est brisée et son rêve, rentrer vite au pays pour y acheter une petite ferme, est anéanti. Un militaire handicapé et rêvant de paix, c’est original. Aussi, tout au long du roman on trouve un éloge permanent des valeurs militaires (honneur, obéissance, courage, amour de la patrie), ce qui fait qu’on ne sait pas toujours si on entend un soldat romain ou  un pilote de la RAF. Les éditions Alsatia avaient publié un autre roman anglais sur le sujet, Trois de la neuvième légion (1960) dans la collection « Signe de piste », puis une BD (1971). Au passage, signalons qu’on sent venir dans les études en littérature de jeunesse, un regain d’intérêt pour le roman scout.
un pilote de la RAF. Les éditions Alsatia avaient publié un autre roman anglais sur le sujet, Trois de la neuvième légion (1960) dans la collection « Signe de piste », puis une BD (1971). Au passage, signalons qu’on sent venir dans les études en littérature de jeunesse, un regain d’intérêt pour le roman scout.
Les valeurs militaires sont tempérées par l’horizon auquel aspire le héros : la vie paisible dans une ferme avec sa famille, de bons amis et un chien. Ce chien idéal est ici un louveteau que Marcus élève, mais qu’il laisse à la maison lors de sa quête. C’est un autre point d’originalité et de déception pour un lecteur contemporain : on devine ce qu’un auteur moderne en aurait fait… Le militarisme est également tempéré par le fait que Marcus est en contact avec plusieurs personnes du camp « ennemi », celui des tribus révoltées contre Rome, et que leur cause apparaît juste. Il est accompagné par Esca, lui-même issu de ces tribus. L’idée d’Empire est très présente, avec des légions composées de soldats venus de toutes les provinces romaines (donc de toute l’Europe) et l’auteur exalte les vertus civilisatrices de Rome, tout en faisant un beau portrait des anciens Bretons. Ce n’est pas encore du politiquement correct, c’est du nationalisme aux vues larges.
Le personnage d’Esca illustre l’innocence des années 50 : prisonnier de guerre vendu comme esclave, gladiateur, il est racheté par Marcus qui le sauve ainsi de la mort. Vite affranchi, Esca devient son ami, son soutien, son alter ego. Cela évoque un autre « couple » célèbre de la littérature de jeunesse historique et antique de la même époque, celui d’Alix et Enak (la BD de J. Martin), mais ici l’auteur est une femme, née en 1920. Elle présente une relation très étroite entre deux jeunes gens de 20 ans qui dorment l’un contre l’autre pour se protéger du froid et sont presque tout l’un pour l’autre sans que rien ne frémisse. On est au temps de l’innocence, où la littérature de jeunesse pouvait quasiment tout oser sans que l’on « pense à mal ». Pas de fille, à part une toute jeune qui ne compte pas mais que le héros épousera à la fin. Autre amour, le louveteau : si les héros ont autour de 20 ans, ils ont un âge affectif de 11 ans.
L’âge du lecteur est ici problématique : les longueurs, le caractère déceptif et rude fait imaginer un lecteur plus vieux que les 11 ans proposés par Gallimard jeunesse. Cet âge cible est sans doute dicté par un souci de vente : il s’agit de capter le public des lecteurs de cycle 3 et de 6e, comme le suggère le cercle Gallimard de l’enseignement. http://www.cercle-enseignement.com/Ouvrages/Gallimard-Jeunesse/Folio-Junior/L-Aigle-de-la-9e-legion
 La couverture de l’édition Folio propose une image lumineuse et enfantine qui contraste fortement avec celle du grand format qui sort en ce moment. Sur la première, le héros semble avoir 12 ans, sur la deuxième, il en a plus de 20, ce qui est une vision plus juste. Cette photo du film est d’ailleurs proposée sur la jaquette ajoutée à l’édition folio. De l’une à l’autre, on voit tout le chemin que peut parcourir un roman historique pour la jeunesse, du public scolaire au grand public et le poids du marketing dans sa diffusion.
La couverture de l’édition Folio propose une image lumineuse et enfantine qui contraste fortement avec celle du grand format qui sort en ce moment. Sur la première, le héros semble avoir 12 ans, sur la deuxième, il en a plus de 20, ce qui est une vision plus juste. Cette photo du film est d’ailleurs proposée sur la jaquette ajoutée à l’édition folio. De l’une à l’autre, on voit tout le chemin que peut parcourir un roman historique pour la jeunesse, du public scolaire au grand public et le poids du marketing dans sa diffusion.
Le deuxième volume de la série, L’Honneur du centurion, est sorti dans la même collection, on en parlera prochainement. On y retrouvera la famille de Marcus, plusieurs générations plus tard, au moment où l’Empire se délite… (A suivre !)
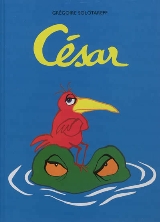 César propose une histoire simple, dans la veine des fables où un petit devient l’ami d’un grand après l’avoir vaincu. Petit oiseau en cage, César écoute son père lui raconter l’histoire de l’empereur des crocodiles; l’album est dédié à André François pour Les Larmes de crocodile (Delpire, 1956 ou 1955 : voir l’article de Michel Defourny) et on peut trouver quelques liens ténus.
César propose une histoire simple, dans la veine des fables où un petit devient l’ami d’un grand après l’avoir vaincu. Petit oiseau en cage, César écoute son père lui raconter l’histoire de l’empereur des crocodiles; l’album est dédié à André François pour Les Larmes de crocodile (Delpire, 1956 ou 1955 : voir l’article de Michel Defourny) et on peut trouver quelques liens ténus.
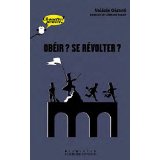
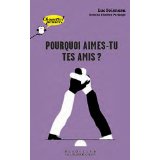





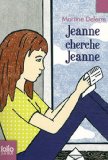

 Pour une fois, nous suivons l’actualité de près, la devançons même un peu, tout en plongeant dans l’Antiquité : le Péplum est de retour, et il est romano-Breton. Après le film Centurion de Marshal (2010) qui relatait la guerre des Romains contre les Pictes et le massacre de la 9e légion romaine, L’Aigle de la 9e légion, tiré du roman que nous évoquons ici prend son essor demain, 4 mai 2011, sur les écrans des cinémas français après avoir été un succès dans sa version originale.
Pour une fois, nous suivons l’actualité de près, la devançons même un peu, tout en plongeant dans l’Antiquité : le Péplum est de retour, et il est romano-Breton. Après le film Centurion de Marshal (2010) qui relatait la guerre des Romains contre les Pictes et le massacre de la 9e légion romaine, L’Aigle de la 9e légion, tiré du roman que nous évoquons ici prend son essor demain, 4 mai 2011, sur les écrans des cinémas français après avoir été un succès dans sa version originale. Avant de creuser un peu cela, deux mots de l’histoire. Elle se caractérise par son caractère déceptif, dès le titre : cet aigle n’est pas un oiseau, ce n’est pas non plus la désignation du héros, c’est un objet, une aigle romaine qui guidait une légion. La 9e légion est pour les Anglais une légion mythique puisque, dit-on (mais d’autres disent que tout cela est faux…), elle disparut corps et biens au moment où les Romains, contraints d’abandonner la Caledonia, se replièrent derrière le mur d’Hadrien. Corps et biens ? Pas dans le roman, car dans cette histoire qui se passe une dizaine d’années plus tard, Marcus le romain et Esca le breton
Avant de creuser un peu cela, deux mots de l’histoire. Elle se caractérise par son caractère déceptif, dès le titre : cet aigle n’est pas un oiseau, ce n’est pas non plus la désignation du héros, c’est un objet, une aigle romaine qui guidait une légion. La 9e légion est pour les Anglais une légion mythique puisque, dit-on (mais d’autres disent que tout cela est faux…), elle disparut corps et biens au moment où les Romains, contraints d’abandonner la Caledonia, se replièrent derrière le mur d’Hadrien. Corps et biens ? Pas dans le roman, car dans cette histoire qui se passe une dizaine d’années plus tard, Marcus le romain et Esca le breton  un pilote de la RAF. Les éditions Alsatia avaient publié un autre roman anglais sur le sujet, Trois de la neuvième légion (1960)
un pilote de la RAF. Les éditions Alsatia avaient publié un autre roman anglais sur le sujet, Trois de la neuvième légion (1960) La couverture de l’édition Folio propose une image lumineuse et enfantine qui contraste fortement avec celle du grand format qui sort en ce moment. Sur la première, le héros semble avoir 12 ans, sur la deuxième, il en a plus de 20, ce qui est une vision plus juste. Cette photo du film est d’ailleurs proposée sur la jaquette ajoutée à l’édition folio. De l’une à l’autre, on voit tout le chemin que peut parcourir un roman historique pour la jeunesse, du public scolaire au grand public et le poids du marketing dans sa diffusion.
La couverture de l’édition Folio propose une image lumineuse et enfantine qui contraste fortement avec celle du grand format qui sort en ce moment. Sur la première, le héros semble avoir 12 ans, sur la deuxième, il en a plus de 20, ce qui est une vision plus juste. Cette photo du film est d’ailleurs proposée sur la jaquette ajoutée à l’édition folio. De l’une à l’autre, on voit tout le chemin que peut parcourir un roman historique pour la jeunesse, du public scolaire au grand public et le poids du marketing dans sa diffusion.