Nouvelle Sparte
Erik L’Homme
Gallimard jeunesse (grand format) 2017
L’antique, une utopie futuriste
Par Anne-Marie Mercier
 Enfin une utopie ! Une vraie, qui ose dire son espoir et sa fragilité et qui puise aux sources les plus discutées de nos démocraties. Erik L’Homme propose l’idée, sinon le modèle, d’une Sparte projetée dans le futur, fondée par des Européens fuyant un monde dévasté. Après la période des « Grands bouleversements » des survivants se sont installés en Baïkalie (donc vers le lac Baïkal, au sud de la Sibérie) et ont voulu fonder une « cité guerrière et forte, capable de résister à l’agonie violente du Monde-d’avant », centre d’une Fédération (écho de Star Wars ?) incluant les populations autochtones. D’autres ont fondé des empires nommés Occidie, Darislam (on reconnaitra la projection de l’Amérique du nord et du monde musulman) une autre se situe derrière la muraille de Chine. C’est donc un monde très polarisé, très schématique aussi, construit sur de nombreux stéréotypes.
Enfin une utopie ! Une vraie, qui ose dire son espoir et sa fragilité et qui puise aux sources les plus discutées de nos démocraties. Erik L’Homme propose l’idée, sinon le modèle, d’une Sparte projetée dans le futur, fondée par des Européens fuyant un monde dévasté. Après la période des « Grands bouleversements » des survivants se sont installés en Baïkalie (donc vers le lac Baïkal, au sud de la Sibérie) et ont voulu fonder une « cité guerrière et forte, capable de résister à l’agonie violente du Monde-d’avant », centre d’une Fédération (écho de Star Wars ?) incluant les populations autochtones. D’autres ont fondé des empires nommés Occidie, Darislam (on reconnaitra la projection de l’Amérique du nord et du monde musulman) une autre se situe derrière la muraille de Chine. C’est donc un monde très polarisé, très schématique aussi, construit sur de nombreux stéréotypes.
La ville est construite en double : la ville du dessus et celle du dessous : chaque famille a une espace pour l’été et un autre, semblable, pour l’hiver glacial : éclairé de puits de lumière, chauffé par une cheminée… La société de la Nouvelle Sparte a été organisée sur le modèle des deux cités antiques, Sparte et Athènes, en prenant ce que chacune avait de meilleur, d’après un philosophe nommé Goas (image de Boas ?). La religion polythéiste de l’ancien monde grec a été réinventée : on invoque Zeus et Héra, Dionysos et Mars – et on y croit. Les héros font des réflexions sur l’amour (libre dans ce monde) en évoquant Eros, Aphrodite, Héra, Hestia… La philosophie est construite sur une distinction entre le « je-suis », le « je fais », le « nous-ensemble », trois manières d’exister. A Sparte, personne n’est pauvre, les biens sont partagés, chacun reçoit selon ses besoins. On aura reconnu des échos de l’ancien système communiste. D’autant plus que « l’hubris (excès dans sa conduite) [est] sanctionné par un séjour remis-des-idées-en-place dans la steppe kourykane ». Mais la distinction repose sur le fait que « la fédération met au même niveau les trois plans d’existence, alors que le communisme ne retient que le troisième ». Enfin, elle prétend être une vraie démocratie, dirigée par plusieurs Assemblées. La vertu et la droiture sont les valeurs suprêmes, mais tout cela est mis en danger au moment où une vague d’attentats faisant de nombreuses victimes terrorise la population et les héros qui en sont spectateurs, de très près : qui est à l’origine de ceux-ci ? on soupçonne le Darislam… Il est question de suspendre un instant les lois de la démocratie…
Les héros sont des adolescents pris au moment de leur initiation. Elle les plonge dans une nature rude avant de les projeter vers le début de la vie adulte et le choix d’un métier. Leur vie est remplie par de nombreuses occupations sérieuses : arts guerriers, sports, poésie, philosophie… et des rencontres autour d’un verre de « stellaire ». Valère aime Alexia mais très vite il doit la quitter pour partir en mission en Occidie, se faisant passer pour un transfuge rejoignant son oncle, riche personnalité de l’ouest (il est en effet un « métis », né de mère occidienne). Le récit de son séjour est digne des romans d’espionnage du temps de la guerre froide : l’Occidie est un monde ou l’extrême richesse se déploie en vase clos dans un océan de très grande pauvreté. La corruption et la violence des rapports humains, la fausseté des sentiments, tout cela en fait un contre modèle. Valère découvre dans le Darislam – l’ennemi présumé de son peuple et le commanditaire de l’assassinat de son père – à travers la rencontre de la famille de l’ambassadeur et il tombe des nues ; loin d’y voir sectarisme et violence, il découvre son, raffinement, son goût pour les arts, l’importance de la religion (il y a des débats savoureux sur les mérites de l’une et de l’autre, avec un éloge vibrant du polythéisme)… Peut-on attribuer les attentats à cet état, ou cela relève-t-il du complot ? On peut rester perplexe devant ce scenario et s’interroger sur sa pertinence dans le contexte actuel – mais on peut supposer aussi que les lecteurs d’Erik L’Homme ne sont pas de ceux qui dédouaneront tout un monde en diabolisant l’autre.
On ne résumera pas les péripéties du séjour de Valère, pris entre la fascination pour le monde des milliardaires, la fidélité à ses origines et à ses amis, le dégoût puis la compréhension du monde des pauvres, et balloté d’une idée à l’autre, totalement perdu. On ne racontera pas non plus comment il découvre qui est à l’origine de ce complot et le but poursuivi. Le récit est dense, prenant, et la réflexion s’intègre bien à l’action. Une légère touche de fantastique à l’antique (les Dieux existent donc ?) complexifie encore l’ensemble. Roman d’aventures, roman politique, roman d’espionnage, sentimental… il y a un peu de tout dans ce livre, qui garde sa cohérence. Seul bémol, la partie aventure manque un peu de crédibilité car les héros déjouent les système de sécurité avec une facilité déconcertante. Certes, ils sont doués en informatique… et il faut bien que l’histoire avance.
Enfin, Erik L’Homme développe un nouveau langage, qui cherche l’idée juste ou la formule choc en accolant des substantifs (« hommages-silence aux étoiles », « les citoyens colère ») ou par des périphrases (les « pousse-à-l’ivresse »), des néologismes (« s’entre-cacher ») ou des archaïsmes ; on s’y fait vite, cela donne une souplesse étonnante au récit qui s’écartèle entre le passé de la langue et ce qui pourrait être son futur.
 Emile Zola raconte une campagne électorale à travers 5 tableaux ou comédies ou reportages dans cinq endroits de France :
Emile Zola raconte une campagne électorale à travers 5 tableaux ou comédies ou reportages dans cinq endroits de France :

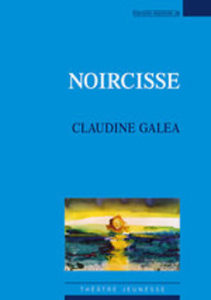


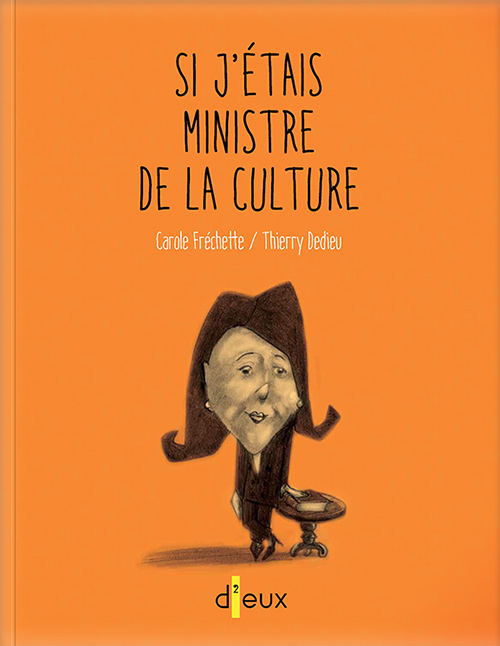


 Anne Lecap nous fait revivre le printemps 36 à travers les yeux d’Emilie, jeune Ardéchoise venue travailler dans les grandes usines du Teil. Emilie y découvre le travail harassant des ateliers d’emballage, la camaraderie, la vulgarité et la brutalité des chefs d’ateliers et des patrons. Elle vit l’espoir formidable soulevé par les accords de Matignon, qui instaurent deux semaines de congé payé par an et la semaine de 48 heures. Elle participe à la grève de son usine pour les faire appliquer.
Anne Lecap nous fait revivre le printemps 36 à travers les yeux d’Emilie, jeune Ardéchoise venue travailler dans les grandes usines du Teil. Emilie y découvre le travail harassant des ateliers d’emballage, la camaraderie, la vulgarité et la brutalité des chefs d’ateliers et des patrons. Elle vit l’espoir formidable soulevé par les accords de Matignon, qui instaurent deux semaines de congé payé par an et la semaine de 48 heures. Elle participe à la grève de son usine pour les faire appliquer. 