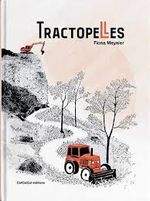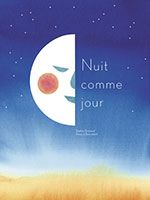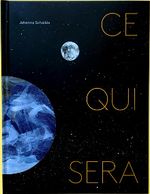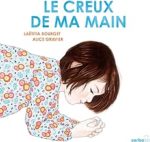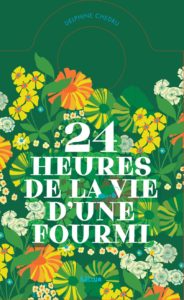Le Cadeau de Minuit
Hong Soon-mi
L’élan vert 2025
Des couleurs et des ombres…
Par Michel Driol
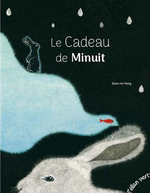 Ils sont cinq lapinous, Aurore, Matin, Midi, Soir et Minuit, fils de Jour et Nuit, petits fils de grand-mère Temps. Cette dernière offre à chacun d’eaux un cadeau : bleu pâle pour Aurore, bleu pour Matin, jaune pour Midi, rose, orange et rouge pour Soir, mais, dans le noir de la nuit, Minuit ne voit rien, et pleure. Pourtant grand-mère Temps veille sur lui, et invite ses frères et sœurs à lui offrir quelque chose. Nuage de brume, brise, confettis de soleil, couleurs du ciel. Et Minuit de tendre à chacun un petit bout de lui-même pour faire naitre les ombres…
Ils sont cinq lapinous, Aurore, Matin, Midi, Soir et Minuit, fils de Jour et Nuit, petits fils de grand-mère Temps. Cette dernière offre à chacun d’eaux un cadeau : bleu pâle pour Aurore, bleu pour Matin, jaune pour Midi, rose, orange et rouge pour Soir, mais, dans le noir de la nuit, Minuit ne voit rien, et pleure. Pourtant grand-mère Temps veille sur lui, et invite ses frères et sœurs à lui offrir quelque chose. Nuage de brume, brise, confettis de soleil, couleurs du ciel. Et Minuit de tendre à chacun un petit bout de lui-même pour faire naitre les ombres…
Voici la réédition d’un album paru en 2020, un album plein de douceur et de poésie. Douceur et poésie des illustrations, pleines de la sérénité de la nature à différents moments de la journée, habitée par cette fratrie de lapins représentés de façon si touchante… Des petits lapins que l’on voit côtoyer d’autres animaux, poissons, oiseaux, papillons, écureuils… autant de vie et de couleurs qui s’opposent à la nuit noire de Minuit juste peuplée d’une lune et d’étoiles qui sont plutôt ses larmes… Douceur des lapins, des nuages, des formes diverses représentées de façon duveteuse, cotonneuse, comme de gigantesques doudous moelleux…
C’est dans cet univers que le texte dépoile une mythologie bien loin d’un Chonos dévorant ses propres enfants. Dans cette cosmogonie, on en laisse personne de côté, et les plus anciens veillent sur les plus jeunes, afin de s’assurer une parfaite égalité des dons reçus. Dans ce conte en randonnée, il est question de la beauté originale de chacun des instants de la journée, pleine de sensibilité, de vie, avec sa couleur propre. Et, dans ce jeu, si les lapins de jour apportent à Minuit de quoi rêver, lui leur offre les ombres, comme une façon de donner de l’épaisseur aux choses. De cet échange nait un univers plus complet, les rêves étant le lieu de toutes les couleurs, façon de dire le pouvoir de l’imagination, de la poésie et de la création.
Un album poétique et philosophique à destination des plus jeunes, les invitant à profiter pleinement de chaque moment de la journée, et à prendre soin les uns des autres, au delà des différences.